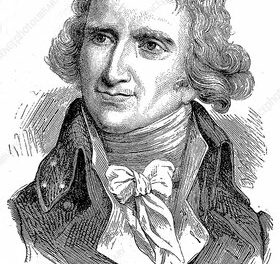L’entretien de l’Aumônier et d’Orou
« Dans la division que les Otaïtiens se firent de l’équipage de Bougainville, l’aumônier devint le partage d’Orou. L’aumônier et l’Otaïtien étaient à peu près du même âge, trente-cinq à trente-six ans. Orou n’avait alors que sa femme et trois filles appelées Asto, Palli et Thia. Elles le déshabillèrent, lui lavèrent le visage, les mains et les pieds, et lui servirent un repas sain et frugal. Lorsqu’il fut sur le point de se coucher, Orou, qui s’était absenté avec sa famille, reparut, lui présenta sa femme et ses trois filles nues et lui dit :
– Tu as soupé, tu es jeune, tu te portes bien ; si tu dors seul, tu dormiras mal : l’homme a besoin, la nuit, d’une compagne à son côté. Voilà ma femme, voilà mes filles, choisis celle qui te convient ; mais si tu veux m’obliger, tu donneras la préférence à la plus jeune de mes filles qui n’a point encore eu d’enfants. La mère ajouta : Hélas ! je n’ai pas à m’en plaindre, la pauvre Thia ! ce n’est pas sa faute.
L’aumônier répondit que sa religion, son état, les bonnes mœurs et l’honnêteté ne lui permettaient pas d’accepter ses offres.
Orou répliqua :
– Je ne sais ce que c’est que la chose que tu appelles religion mais je ne puis qu’en penser mal, puisqu’elle t’empêche de goûter un plaisir innocent auquel nature, la souveraine maîtresse, nous invite tous ; de donner l’existence à un de tes semblables ; de rendre un service que le père, la mère et les enfants te demandent ; de t’acquitter envers un hôte qui t’a fait un bon accueil, et d’enrichir une nation en l’accroissant d’un sujet de plus. Je ne sais ce que c’est que la chose que tu appelles état ; mais ton premier devoir est d’être homme et d’être reconnaissant. Je ne te propose pas de porter dans ton pays les mœurs d’Orou, mais Orou, ton hôte et ton ami, te supplie de te prêter aux mœurs d’Otaïti. Les mœurs d’Otaïti sont-elles meilleures ou plus mauvaises que les vôtres ? c’est une question facile à décider. La terre où tu es né a-t-elle plus d’hommes qu’elle n’en peut nourrir ? en ce cas tes mœurs ne sont ni pires ni meilleures que les nôtres. En peut-elle nourrir plus qu’elle n’en a ? nos mœurs sont meilleures que les tiennes. Quant à l’honnêteté que tu m’objectes, je te comprends : j’avoue que j’ai tort et je t’en demande pardon. Je n’exige pas que tu nuises à ta santé ; si tu es fatigué, il faut que tu te reposes, mais j’espère que tu ne continueras pas à nous contrister. Vois le souci que tu as répandu sur tous ces visages. Elles craignent que tu n’aies remarqué en elles quelques défauts qui leur attirent ton dédain. Mais quand cela serait, le plaisir d’honorer une de mes filles entre ses compagnes et ses sœurs et de faire une bonne action ne te suffirait-il pas ? Sois généreux.
L’AUMONIER – Ce n’est pas cela ; elles sont toutes quatre également belles. Mais ma religion ! mais mon état !
OROU – Elles m’appartiennent et je te les offre ; elles sont à elles et elles se donnent à toi. Quelle que soit la pureté de conscience que la chose religion et la chose état te prescrivent, tu peux les accepter sans scrupule. Je n’abuse point de mon autorité, et sois sûr que je connais et que je respecte les droits des personnes.
Ici le véridique aumônier convient que jamais la Providence ne l’avait exposé à une aussi pressante tentation. Il était jeune ; il s’agitait, il se tourmentait ; il détournait ses regards des aimables suppliantes, il les ramenait sur elles ; il levait ses yeux et ses mains au ciel. Thia, la plus jeune, embrassait ses genoux et lui disait : « Étranger, n’afflige pas mon père, n’afflige pas ma mère, ne m’afflige pas. Honore-moi dans la cabane et parmi les miens ; élève-moi au rang de mes sœurs qui se moquent de moi. Asto, l’aînée, a déjà trois enfants ; Palli, la seconde, en a deux, et Thia n’en a point. Étranger, honnête étranger, ne me rebute pas ; rends-moi mère : fais-moi un enfant que je puisse un jour promener par la main, à côté de moi, dans Otaïti, qu’on voie dans neuf mois attaché à mon sein, dont je sois fière, et qui fasse une partie de ma dot lorsque je passerai de la cabane de mon père dans une autre. Je serai peut-être plus chanceuse avec toi qu’avec nos jeunes Otaïtiens. Si tu m’accordes cette faveur, je ne t’oublierai plus ; je te bénirai toute ma vie ; j’écrirai ton nom sur mon bras et sur celui de ton fils, nous le prononcerons sans cesse avec joie ; et lorsque tu quitteras ce rivage, mes souhaits t’accompagneront sur les mers jusqu’à ce que tu sois arrivé dans ton pays. »
Le naïf aumônier dit qu’elle lui serrait les mains, qu’elle attachait sur ses yeux des regards si expressifs et si touchants, qu’elle pleurait, que son père, sa mère et ses sœurs s’éloignèrent, qu’il resta seul avec elle, et qu’en disant, « Mais ma religion ! mais mon état ! » il se trouva le lendemain couché à côté de cette jeune fille qui l’accablait de caresses, et qui invitait son père, sa mère et ses sœurs, lorsqu’ils s’approchèrent de son lit le matin, à joindre leur reconnaissance à la sienne. Asto et Palli qui s’étaient éloignées rentrèrent avec les mets du pays, des boissons et des fruits. Elles embrassaient leur sœur et faisaient des vœux sur elle ; ils déjeunèrent tous ensemble, ensuite Orou, demeuré seul avec l’aumônier, lui dit :
Je vois que ma fille est contente de toi, et je te remercie. Mais pourrais-tu m’apprendre ce que c’est que le mot religion que tu as prononcé tant de fois et avec tant de douleur ?
L’AUMONIER – Qui est-ce qui a fait ta cabane et les ustensiles qui la meublent ?
OROU – C’est moi.
L’AUMONIER – Eh bien, nous croyons que ce monde et ce qu’il renferme est l’ouvrage d’un ouvrier.
OROU – Il a donc des pieds, des mains, une tête ?
L’AUMONIER – Non.
OROU – Où fait-il sa demeure ?
L’AUMONIER – Partout.
OROU – Ici-même ?
L’AUMONIER – Ici.
OROU – Nous ne l’avons jamais vu.
L’AUMONIER – On ne le voit pas.
OROU – Voilà un père bien indifférent. Il doit être vieux, car il a du moins l’âge de son ouvrage.
L’AUMONIER – Il ne vieillit point. Il a parlé à nos ancêtres, il leur a donné des lois, il leur a prescrit la manière dont il voulait être honoré ; il leur a ordonné certaines actions comme bonnes, il leur en a défendu d’autres comme mauvaises.
OROU – J’entends, et une de ces actions qu’il leur a défendues comme mauvaises, c’est de coucher avec une femme ou une fille. Pourquoi donc a-t-il fait deux sexes ?
L’AUMONIER – Pour s’unir, mais à certaines conditions requises, après certaines cérémonies préalables, en conséquence desquelles un homme appartient à une femme et n’appartient qu’à elle, une femme appartient à un homme et n’appartient qu’à lui.
OROU – Pour toute leur vie ?
L’AUMONIER – Pour toute leur vie.
OROU – En sorte que s’il arrivait à une femme de coucher avec un autre que son mari, ou à un mari de coucher avec une autre que sa femme… Mais cela n’arrive point, car puisqu’il est là et que cela lui déplaît, il sait les en empêcher.
L’AUMONIER – Non, il les laisse faire, et ils pèchent contre la loi de Dieu, car c’est ainsi que nous appelons le grand ouvrier ; contre la loi du pays, et nous commettons un crime.
OROU – Je serais fâché de t’offenser par mes discours, mais si tu le permettais, je te dirais mon avis.
L’AUMONIER – Parle.
OROU – Ces préceptes singuliers, je les trouve opposés à la nature, contraires à la raison, faits pour multiplier les crimes, et fâcher à tout moment le vieil ouvrier qui a tout fait sans tête, sans mains et sans outils ; qui est partout et qu’on ne voit nulle part ; qui dure aujourd’hui et demain et qui n’a pas un jour de plus ; qui commande et qui n’est pas obéi ; qui peut empêcher et qui n’empêche pas. Contraires à la nature, parce qu’ils supposent qu’un être sentant, pensant et libre peut être la propriété d’un être semblable à lui. Sur quoi ce droit serait-il fondé ? Ne vois-tu pas qu’on a confondu dans ton pays la chose qui n’a ni sensibilité, ni pensée, ni désir, ni volonté, qu’on quitte, qu’on prend, qu’on garde, qu’on échange, sans qu’elle souffre et sans qu’elle se plaigne, avec la chose qui ne s’échange point, qui ne s’acquiert point, qui a liberté, volonté, désir, qui peut se donner ou se refuser pour un moment, se donner ou se refuser pour toujours, qui se plaint et qui souffre, et qui ne saurait devenir un effet de commerce sans qu’on oublie son caractère et qu’on fasse violence à la nature ? Contraires à la loi générale des êtres; rien en effet te paraît-il plus insensé qu’un précepte qui proscrit le changement qui est en nous, qui commande une constance qui n’y peut être, et qui viole la nature et la liberté du mâle et de la femelle en les enchaînant pour jamais l’un à l’autre ; qu’une fidélité qui borne la plus capricieuse des jouissances à un même individu ; qu’un serment d’immutabilité de deux êtres de chair, à la face d’un ciel qui n’est pas un instant le même, sous des antres qui menacent ruine, au bas d’une roche qui tombe en poudre, au pied d’un arbre qui se gerce, sur une pierre qui s’ébranle ? Crois-moi, vous avez rendu la condition de l’homme pire que celle de l’animal. Je ne sais ce que c’est que ton grand ouvrier, mais je me réjouis qu’il n’ait point parlé à nos pères, et je souhaite qu’il ne parle point à nos enfants, car il pourrait par hasard leur dire les mêmes sottises, et ils feraient peut-être celle de les croire. Hier, en soupant, tu nous as entretenus de magistrats et de prêtres, Je ne sais quels sont ces personnages que tu appelles magistrats et prêtres, dont l’autorité règle votre conduite ; mais, dis-moi, sont-ils maîtres du bien et du mal ? Peuvent-ils faire que ce qui est juste soit injuste, et que ce qui est injuste soit juste ? Dépend-il d’eux d’attacher le bien à des actions nuisibles et le mal à des actions innocentes ou utiles ? Tu ne saurais le penser, car à ce compte il n’y aurait ni vrai ni faux, ni bon ni mauvais, ni beau ni laid, du moins que ce qu’il plairait à ton grand ouvrier, à tes magistrats, à tes prêtres de prononcer tel et d’un moment à l’autre tu serais obligé de changer d’idées et de conduite. Un jour on te dirait de la part de l’un de tes trois maîtres, Tue, et tu serais obligé en conscience de tuer ; un autre jour, Vole, et tu serais tenu de voler ; ou Ne mange pas de ce fruit, et tu n’oserais en manger ; Je te défends ce légume ou cet animal, et tu te garderais d’y toucher. Il n’y a point de bonté qu’on ne pût t’interdire, point de méchanceté qu’on ne pût t’ordonner ; et où en serais-tu réduit, si tes trois maîtres, peu d’accord entre eux, s’avisaient de te permettre, de t’enjoindre et de te défendre la même chose, comme je pense qu’il arrive souvent ? Alors pour plaire au prêtre, il faudra que tu te brouilles avec le magistrat ; pour satisfaire le magistrat, il faudra que tu mécontentes le grand ouvrier, et pour te rendre agréable au grand ouvrier, il faudra que tu renonces à la nature. Et sais-tu ce qui en arrivera ? c’est que tu les mépriseras tous les trois, et que tu ne seras ni homme, ni citoyen, ni pieux, que tu ne seras rien ; que tu seras mal avec toutes les sortes d’autorité, mal avec toi-même, méchant, tourmenté par ton cœur, persécuté par tes maîtres insensés, et malheureux, comme je te vis hier au soir lorsque je te présentai mes filles et que tu t’écriais : « Mais ma religion ! mais mon état ! » Veux-tu savoir en tout temps et en tout lieu ce qui est bon et mauvais ? attache-toi à la nature des choses et des actions, à tes rapports avec ton semblable, à l’influence de ta conduite sur ton utilité particulière et le bien général. Tu es en délire, si tu crois qu’il y ait rien, soit en haut, soit en bas, dans l’univers qui puisse ajouter ou retrancher aux lois de la nature. Sa volonté éternelle est que le bien soit préféré au mal et le bien général au bien particulier. Tu ordonneras le contraire, mais tu ne seras pas obéi. Tu multiplieras les malfaiteurs et les malheureux par la crainte, par le châtiment et par les remords ; tu dépraveras les consciences, tu corrompras les esprits : ils ne sauront plus ce qu’ils ont à faire ou à éviter ; troublés dans l’état d’innocence, tranquilles dans le forfait, ils auront perdu de vue l’étoile polaire de leur chemin. Réponds-moi sincèrement ; en dépit des ordres exprès de tes trois législateurs, un jeune homme dans ton pays ne couche-t-il jamais sans leur permission avec une jeune fille ?
L’AUMONIER – Je mentirais, si je te l’assurais.
OROU – La femme qui a juré de n’appartenir qu’à son mari, ne se donne-t-elle point à un autre ?
L’AUMONIER – Rien n’est plus commun.
OROU – Tes législateurs sévissent ou ne sévissent pas. S’ils sévissent, ce sont des bêtes féroces qui battent la nature. S’ils ne sévissent pas, ce sont des imbéciles qui ont exposé au mépris leur autorité par une défense inutile. »
Denis Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, http://www.ebooksgratuits.com/, avril 2004 (1772), ch III, p. 22-28
Voir aussi [->4823]
et le témoignage de Bougainville sur [->4733]