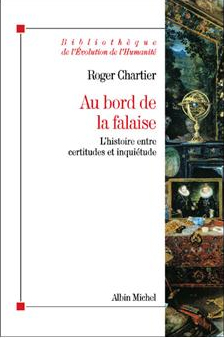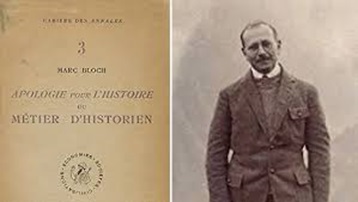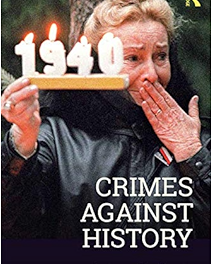__________________________________________________________
L’histoire entre récit et connaissance
« Temps d’incertitude », « crise épistémologique », « tournant critique » : tels sont les diagnostics, généralement inquiets, portés en ces dernières années sur l’histoire. Qu’il me suffise de rappeler deux constats qui ont ouvert la voie à une large réflexion collective. D’un côté, celui proposé par l’éditorial du numéro des Annales de mars-avril 1988 qui affirmait : « Aujourd’hui, 1e temps semble venu des incertitudes. Le reclassement des disciplines transforme le paysage scientifique, remet en cause des primautés établies, affecte les voies traditionnelles par lesquelles circulait l’innovation. Les paradigmes dominants, que l on allait chercher dans les marxismes ou dans les structuralismes aussi bien que dans les usages confiants de la quantification, perdent de leurs capacités structurantes […] L’histoire qui avait établi une bonne part de son dynamisme sur une ambition fédératrice, n’est pas épargnée par cette crise générale des sciences sociales. » Second constat, tout différent dans ses raisons mais semblable en ses conclusions : celui porté en 1989 par David Harlan dans un article de l’American Historical Review qui a suscité une discussion qui dure encore : ”Le retour à la littérature a plongé l’histoire dans une grave crise épistémologique. Il a mis en question notre croyance en un passé fixe et déterminable, il a compromis la possibilité de la représentation historique elle-même, et il a miné notre capacité à nous situer le temps.”
Qu’indiquent de tels diagnostics qui semblent avoir quelque chose de paradoxal en un temps où l’édition d’histoire démontre une belle vitalité et une inventivité maintenue, traduites dans la continuation des grandes oeuvres collectives, le lancement de collections européennes, l’accroissement du nombre des traductions, l’écho intellectuel rencontré par quelques livres majeurs ? Ils désignent, je crois, cette mutation majeure qu’est l’effacement des modèles de compréhension, des principes d’intelligibilité qui avaient été communément acceptés par les historiens (ou, du moins, la majeure partie d’entre eux) depuis les années soixante. L’histoire conquérante reposait alors sur deux projets. D’abord, l’application à l’étude des sociétés anciennes ou contemporaines du paradigme structuraliste, ouvertement revendiqué ou implicitement pratiqué. Il s’agissait avant tout d’identifier les structures et les relations qui, indépendamment des perceptions et des intentions des individus, commandent les mécanismes économiques, organisent les rapports sociaux, engendrent les formes du discours. De là, l’affirmation d’une radicale séparation entre l’objet de la connaissance historique et la conscience subjective des acteurs.
Seconde exigence : soumettre 1’histoire aux procédures du nombre et de la série ou, pour mieux dire, l’inscrire dans un paradigme du savoir que Carlo Ginzburg, dans un article célèbre, a désigné comme «galiléen ». Il s agissait là, grâce à la quantification des phénomènes, à la construction de séries et aux traitements statistiques, de formuler rigoureusement les relations structurales qui étaient l’objet même de l’histoire. […]
Les certitudes ébranlées
Dans les dix dernières années, ce sont ces certitudes, longtemps partagées très largement, qui ont vacillé. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord sensibles à de nouvelles approches anthropologiques ou sociologiques, les historiens ont voulu restaurer le rôle des individus dans la construction des liens sociaux. […]
Une seconde raison, plus profonde, a ébranlé les certitudes anciennes : la prise de conscience par les historiens que leur discours, quelle qu’en soit la forme, est toujours un récit. [….] Le constat n’allait pas de soi pour ceux qui, en rejetant l’histoire événementielle au profit d’une histoire structurale et quantifiée, pensaient en avoir fini avec les faux semblants de la narration et avec la trop longue et fort douteuse proximité entre l’histoire et la fable. […]
Dans Temps et récit, Paul Ricoeur a montré combien était illusoire cette césure proclamée. En effet, toute histoire, même la moins narrative, même la plus structurale, est toujours construite à partir des formules qui gouvernent la production des récits. Les entités que manient les historiens (société, classes, mentalités, etc.) sont des « quasi-personnages », dotés implicitement des propriétés qui sont celles des héros singuliers et des individus ordinaires qui composent les collectivités que désignent ces catégories abstraites. D’autre part, les temporalités historiques maintiennent une forte dépendance par rapport au temps subjectif : dans des pages superbes, Ricoeur montre comment La Méditerranée au temps de Philippe II de Braudel repose, au fond, sur une analogie entre le temps de la mer et celui du roi et comment la longue durée y est une modalité particulière, dérivée, de la mise en intrigue de l’événement. […]
Toutefois, il n’est pas, ou plus possible de penser le savoir historique, installé dans l’ordre du vrai, dans les catégories du « paradigme galiléen », mathématique et déductif. Le chemin est donc forcément étroit pour qui entend refuser, en même temps, la réduction de l’histoire à une activité littéraire de simple curiosité, libre et aléatoire, et la définition de sa scientificité à partir du seul modèle de la connaissance du monde physique. Dans un texte auquel il faut toujours revenir, Michel de Certeau avait formulé cette tension fondamentale de l’histoire. Elle est une pratique « scientifique », productrice de connaissances, mais une pratique dont les modalités dépendent des variations de ses procédures techniques, des contraintes que lui imposent le lieu social et l’institution de savoir où elle est exercée, ou encore des règles qui nécessairement commandent son écriture. Ce qui peut également s’énoncer à l’inverse : l’histoire est un discours qui met en oeuvre des constructions, des compositions, des figures qui sont celles de toute écriture narrative, donc aussi de la fable, mais qui, en même temps, produit un corps d’énoncés « scientifiques » si on entend par-là « la possibilité d’établir un ensemble de règles permettant de ”contrôler” des opérations proportionnées à la production d’objets déterminés ».
Ce que Michel de Certeau nous invite ici à penser est le propre de la compréhension historique. A quelles conditions peut-on tenir pour cohérents, plausibles, explicatifs, les rapports institués entre, d’une part, les indices, les séries ou les énoncés que construit l’opération historiographique et, d’autre part, la réalité référentielle qu’ils entendent « représenter » adéquatement ? La réponse n’est pas aisée, mais il est sûr que l‘historien a pour tâche spécifique de donner une connaissance appropriée, contrôlée, de cette « population de morts – personnage, mentalités, prix » qui sont son objet. Abandonner cette intention de vérité, peut-être démesurée mais sûrement fondatrice, serait laisser le champ libre à toutes les falsifications, à tous les faussaires qui, parce qu’ils trahissent la connaissance, blessent la mémoire. Aux historiens, en faisant leur métier, d être vigilants.
Roger Chartier : Au bord de la falaise, Paris, A. Michel, 1998, p.87-92 et 104-105