Sommaire
L’histoire est une science humaine
Charles Seignobos : Il n’y a de faits historiques que par position
Qu’est-ce qu’un fait historique ?
« N’importe quoi peut servir de source »
Fernand Braudel – les trois niveaux de l’histoire
La biographie
Contre tout déterminisme historique
Mémoire et Histoire
Discours, mémoire, vérité
C. A. Bayly : l’Histoire est relative.
TEXTES sur l’historiographie du XIXe au XXIe siècles

L’histoire est une science humaine
par Jean-Claude Favez, Professeur au Département d’histoire générale de l’ Université de Genève, retraité depuis 2001.
« L’histoire est une science humaine. Science, non parce qu’elle observerait des phénomènes et pourrait en dégager des conclusions répétitives en forme de loi ; mais science parce que ses méthodes de travail sont rigoureuses sans être forcément quantitatives. Humaine parce qu’elle cherche à comprendre ce qui se passe parmi les hommes et que cette interrogation n’est pas faite de Sirius, mais qu’elle est à son tour dans l’histoire. L’histoire, étude et connaissance du passé des hommes, est donc uen démarche qui sans cesse renvoie du présent au passé et inversément. »
in Etudes et carrières, No 39, 1982 (revue d’information professionnelle universitaire, service de l’orientation – oofp – Genève), p. 6
« Aujourd’hui, les historiens sont plus prudents et plus modestes. Ils ne pensent plus, en général, que l’histoire fournit des leçons de morale, de nationalisme ou de science. En revanche, avec l’ensemble des sciences sociales, ils sont convaincus que l’homme est dans l’espèce un être social, doué de mémoire. L’histoire n’apprend rien, au sens où elle rendrait les hommes meilleurs et plus heureux, car il ne suffit pas de connaître les causes des erreurs pour ne pas les répéter. Mais l’histoire aide à comprendre l’origine des phénomènes auxquels nous sommes confrontés ; elle permet de comparer des situations analogues ; elle élargit le champ de la connaissance et de la réflexion. Pour être gratuit, son apport social ne se révèle donc pas moins essentiel, tout spécialement à notre époque. »
in Etudes et carrières, No 39, 1982 (revue d’information professionnelle universitaire, service de l’orientation – oofp – Genève), p. 9
Charles Seignobos : Il n’y a de faits historiques que par position
« Mais dès qu’on cherche à délimiter pratiquement le terrain de l’histoire, dès qu’on essaie de tracer les limites entre une science historique des faits humains du passé et une science actuelle des faits humains du présent, on s’aperçoit que cette limite ne peut pas être établie, parce qu’en réalité il n’y a pas de faits qui soient historiques par leur nature, comme il y a des faits physiologiques ou biologiques. Dans l’usage vulgaire le mot “historique” est pris encore dans le sens antique: digne d’être raconté; on dit en ce sens une “journée historique”, un “mot historique”. Mais cette notion de l’histoire est abandonnée; tout incident passé fait partie de l’histoire, aussi bien le costume porté par un paysan du XVIIIe siècle que la prise de la Bastille; et les motifs qui font paraître un fait digne de mention sont infiniment variables. L’histoire embrasse l’étude de tous les faits passés, politiques, intellectuels, économiques, dont la plupart ont passé inaperçus. Il semblerait donc que les faits historiques puissent être définis: les “faits passés”, par opposition aux faits actuels qui sont l’objet des sciences descriptives de l’humanité. C’est précisément cette opposition qu’il est impossible de maintenir en pratique. Être présent ou passé n’est pas une différence de caractère interne, tenant à la nature d’un fait; ce n’est qu’une différence de position par rapport à un observateur donné. La Révolution de 1830 est un fait passé pour nous, présent pour les gens qui l’ont faite. Et de même la séance d’hier à la Chambre est déjà un fait passé.
Il n’y a donc pas de faits historiques par leur nature; il n’y a de faits historiques que par position. Est historique tout fait qu’on ne peut plus observer directement parce qu’il a cessé d’exister. Il n’y a pas de caractère historiquement inhérent aux faits, il n’y a d’historique que la façon de les connaître. L’histoire n’est pas une science, elle est procédé de connaissance.
(…) Si les actes qu’il s’agit de connaître n’avaient laissé aucune trace, aucune connaissance n’en serait possible. Mais souvent les faits disparus ont laissé des traces, quelques fois directement sous forme d’objets matériels, le plus souvent indirectement sous la forme d’écrits rédigés par des gens qui ont eux-mêmes vu ces faits. Ces traces, ce sont les documents, et la méthode historique consiste à examiner les document pour arriver à déterminer les faits anciens dont ces documents sont les traces. Elle prend pour point de départ le document observé directement; de là elle remonte, par une série de raisonnements compliqués, jusqu’au fait ancien qu’il s’agit de connaître. Elle diffère donc radicalement de toutes les méthodes des autres sciences. Au lieu d’observer directement des faits, elle opère indirectement en raisonnant sur des documents. Toute connaissance historique étant indirecte, l’histoire est essentiellement une science de raisonnement. Sa méthode est une méthode indirecte, par raisonnement. »
Seignobos, La Méthode historique appliquée aux sciences sociales, Alcan, 1901, pp. 2-5.
Tiré de Antoine Prost, 12 leçons sur l’histoire, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points histoire », 1996, 330 p.
Qu’est-ce qu’un fait historique ?
« Qu’est qu’un fait historique ? C’est là une question fondamentale, qu’il nous faut examiner de plus près. Selon l’opinion courante, il y a certains faits de base qui sont les mêmes pour tous les historiens et qui forment, pour ainsi dire, l’épine dorsale de l’histoire – par exemple, le fait que la bataille de Hastings s’est livrée en 1066. Mais cette opinion attire deux observations. La première, c’est que les données de ce genre ne sont pas ce qui intéresse primordialement l’historien. Bien entendu, il est important de savoir que cette grande bataille fut livrée en 1066 et non en 1065 ou 1067, et qu’elle eut lieu non à Eastbourne ou Brighton, mais à Hastings. Ce sont des points sur lesquels l’historien se doit d’être exact. Cependant, en pareil cas je songe à la réflexion de J. E. Housman : « L’exactitude est un devoir, non une vertu. » Faire mérite à l’historien de son exactitude équivaut à faire mérite à l’architecte d’employer dans ses constructions du bois d’œuvre bien sec ou du béton correctement malaxé. Si l’historien se doit nécessairement d’être exact, là n’est pas sa fonction essentielle. C’est précisément pour cela qu’il s’appuie sur ce qu’on appelle les « sciences auxiliaires » de l’histoire : archéologie, épigraphie, numismatique, chronologie etc. On n’attend pas de l’historien qu’il soit compétent pour déterminer savamment l’origine et l’époque d’un tesson de poterie ou d’un fragment de marbre, pour déchiffrer une inscription obscure ou procéder à des calculs astronomiques complexes afin de fixer précisément une date. Les faits, les données de base, qui sont les mêmes pour tous les historiens, entrent dans la catégorie des matériaux de l’historien plutôt que dans l’histoire proprement dite.
La seconde observation, c’est que la nécessité d’établir ces faits de base ne repose pas sur leur caractère intrinsèque, mais sur une décision a priori de l’historien. En dépit de la maxime de C. P. Scott, tout journaliste sait aujourd’hui que la meilleure technique pour influencer l’opinion consiste dans le choix et la présentation. On a longtemps répété que les faits parlent d’eux-mêmes. A l’évidence, c’est faux. Ils ne parlent qu’à l’invitation de l’historien : c’est lui qui décide de ceux auxquels il donnera la parole, et dans quelle succession ou dans quel contexte. Si je ne me trompe pas, Pirandello fait dire à l’un des ses personnages qu’un fait est comme un sac : pour qu’il tienne en position verticale, il faut mettre quelque chose dedans. La seule raison pour laquelle il nous intéresse de savoir que la bataille fut livrée à Hastings en 1066, c’est parce que les historiens la considèrent comme un événement historique capital. C’est l’historien qui a décidé, pour des raisons lui appartenant, que le franchissement du Rubicon par César est un fait historique, alors que le passage antérieur ou postérieur de ce ruisseau par des millions d’autres gens n’intéresse personne. (…) L’historien est nécessairement sélectif. L’idée qu’il existe un noyau dur de faits existant objectivement et indépendamment de l’interprétation de l’historien est fausse et absurde, mais très difficile à extirper.
(…) On avait fait fausse route quelque part. La fausse route, c’était de croire que l’histoire se fonde sur l’accumulation inlassable et infinie de faits bruts, de croire que les faits parlent d’eux-mêmes et que nous n’en avons jamais de trop, idée tellement admise à l’époque que peu d’historiens jugeaient nécessaire – et quelques-uns n’en voient toujours pas l’utilité – de se poser à eux-mêmes la question : « Qu’est-ce que l’histoire ? »
Extrait de Edward Hallet Carr, Qu’est-ce que l’histoire ?, La Découverte, Paris, 1988, pp. 55-62.
« N’importe quoi peut servir de source »
« Les données d’un côté, et les principes d’interprétation de l’autre, sont les deux éléments de toute pensée historique. Mais ils n’existent pas séparément pour se combiner ensuite. Ils existent ensemble ou pas du tout. L’historien ne peut pas récolter les données dans un premier temps et les interpréter dans un second. C’est seulement quand il a un problème en tête qu’il peut se mettre à la recherche de données qui s’y rapportent. N’importe quoi n’importe où peut lui servir de données s’il est capable de trouver comment l’interpréter. Les données de l’historien sont la totalité du présent.
Le commencement de la recherche historique n’est donc pas la collecte ou la contemplation de faits bruts non encore interprétés, mais le fait de poser une question qui mette à la recherche de faits qui puissent aider à y répondre. Toute recherche historique est focalisée de cette façon sur quelque question ou problème particulier qui définit son sujet. Et l’on ne doit poser la question qu’avec quelques raisons de penser qu’on sera capable de lui apporter une réponse, et une réponse qui soit un raisonnement authentiquement historique, autrement elle ne mène nulle part, c’est au mieux une curiosité oisive, mais ni le centre ni même un élément d’un travail historique. Ce que nous exprimons en disant qu’une question « se pose » ou « ne se pose pas ». Dire qu’une question se pose, c’est dire qu’elle entretient un lien logique avec nos pensées antérieures, que nous avons une raison pour la poser et que nous ne sommes pas animés par une simple curiosité capricieuse. »
in Robin G. Collingwood, « N’importe quoi peut servir de source », (Essays in) the Philosophy of History, (ouvrage posthume, 1965) p. 14
Fernand Braudel – les trois niveaux de l’histoire
Finalement l’historien doit être familier de ces trois « visages » de l’histoire.
Extrait de la Préface :
« Ce livre se divise en trois parties, chacune étant en soi un essai d’explication.
La première met en cause une histoire quasi immobile, celle de l’homme dans ses rapports avec le milieu qui l’entoure ; une histoire lente à couler et à se transformer, faite bien souvent de retours insistants, de cycles sans fin recommencés. Je n’ai pas voulu négliger cette histoire-là, presque hors du temps, au contact des choses inanimées, ni me contenter, à son sujet, de ces traditionnelles introductions géographiques à l’histoire, inutilement placées au seuil de tant de livres, avec leurs paysages minéraux, leurs labours et leurs fleurs qu’on montre rapidement et dont ensuite il n’est plus jamais question, comme si les fleurs ne revenaient pas avec chaque printemps, comme si les troupeaux s’arrêtaient dans leurs déplacements, comme si les navires n’avaient pas à voguer sur une mer réelle, qui change avec les saisons.
Au-dessus de cette histoire immobile, une histoire lentement rythmée, on dirait volontiers, si l’expression n’avait pas été détournée de son sens plein, une histoire sociale, celle des groupes et des groupements. Comment ces vagues de fond soulèvent-elles l’ensemble de la vie méditerranéenne ? Voilà ce que je me suis demandé dans la seconde partie de mon livre, en étudiant successivement les économies et les Etats, les sociétés, les civilisations, en essayant enfin, pour mieux éclairer ma conception de l’histoire, de montrer comment toutes ces forces de profondeur sont à l’œuvre dans le domaine complexe de la guerre. Car la guerre, nous le savons, n’est pas un pur domaine de responsabilités individuelles.
Troisième partie enfin, celle de l’histoire traditionnelle, si l’on veut de l’histoire à la dimension non de l’homme, mais de l’individu, l’histoire événementielle de François Simiand : une agitation de surface, les vagues que les marées soulèvent sur leur puissant mouvement. Une histoire à oscillations brèves, rapides, nerveuses. Ultra-sensible par définition, le moindre pas met en alerte tous ses instruments de mesure. Mais telle quelle, c’est la plus passionnante, la plus riche en humanité, la plus dangereuse aussi. Méfions-nous de cette histoire brûlante encore, telle que les contemporains l’ont sentie, décrite, vécue, au rythme de leur vie, brève comme la nôtre. Elle a la dimension de leurs colères, de leurs rêves et de leurs illusions. Au XVIe siècle, après la vraie Renaissance, viendra la Renaissance des pauvres, des humbles, acharnés à écrire, à se raconter et à parler des autres. Toute cette précieuse paperasse est assez déformante, elle envahit abusivement ce temps perdu, y prend une place hors de vérité. C’est dans un monde bizarre, auquel manquerait une dimension, que se trouve transporté l’historien lecteur des papiers de Philippe II, comme assis en ses lieu et place ; un monde de vives passions assurément ; un monde aveugle, comme tout monde vivant, comme le nôtre, insouciant des histoires de profondeur, de ces eaux vives sur lesquelles notre barque file comme le plus ivre des bateaux. Un monde dangereux, disions-nous, mais dont nous aurons conjuré les sortilèges et les maléfices en ayant, au préalable, fixé ces grands courants sous-jacents, souvent silencieux, et dont le sens ne se révèle que si l’on embrasse de larges périodes du temps. Les événements retentissants ne sont souvent que des instants, que des manifestations de ces larges destins et ne s’expliquent que par eux.
Ainsi sommes-nous arrivés à une décomposition de l’histoire en plans étagés. Ou, si l’on veut, à la distinction, dans le temps de l’histoire, d’un temps géographique, d’un temps social, d’un temps individuel. Ou si l’on préfère encore, à la décomposition de l’homme en un cortège de personnages.
(…) L’histoire n’est peut-être pas condamnée à n’étudier que des jardins bien clos de murs. Sinon ne faillirait-elle pas à l’une de ses tâches présentes, qui est aussi de répondre aux angoissants problèmes de l’heure, de se maintenir en liaison avec les sciences si jeunes, mais si impérialistes de l’homme ? »
Source : Fernand Braudel, « La Méditerrannée et le monde méditerrannéen à l’époque de Philippe II », in Ecrits sur l’histoire, Flammarion, Paris, 1969, pp. 11-13.
La biographie
« La biographie confronte aujourd’hui l’historien avec les problèmes essentiels – mais classiques – de son métier d’une façon particulièrement aiguë et complexe. Toutefois, elle le fait dans un registre qui a souvent cessé de nous être accoutumé.
Car il y a eu – particulièrement sensible dans le mouvement issu des Annales – une éclipse de la biographie historique au cœur du XXe siècle, malgré quelques exceptions éclatantes. Les historiens ont plus ou moins abandonné le genre aux romanciers – leurs vieux concurrents en ce domaine. Marc Bloch le constatait – sans le mépris qu’on a prétendu pour cette forme historiographique, avec regret au contraire –, probablement avec le sentiment que la biographie, comme l’histoire politique, n’était pas prête à accueillir les renouvellements de la pensée et de la pratique historienne. A propos de la définition que donnait Fustel de Coulanges, l’un des pères de la nouvelle histoire, au XXe siècle : « L’histoire est la science des sociétés humaines », il observait : « C’est peut être réduire à l’excès, dans l’histoire, la part de l’individu. »
Aujourd’hui où l’histoire, avec les sciences sociales, connaît une période d’intense révision critique de ses certitudes, au sein de la crise de mutation générale des sociétés occidentales, la biographie me semble en partie libérée des blocages où de faux problèmes la maintenaient. Elle peut même devenir un observatoire privilégié pour réfléchir utilement sur les conventions et sur les ambitions du métier d’historien, sur les limites de ses acquis, sur les redéfinitions dont il a besoin.
C’est pourquoi, en présentant ce livre, en définissant ce que j’ai cherché à faire, il me faut exposer ce que ne doit pas être une biographie historique aujourd’hui. Car ce sont ces refus qui m’ont fait retrouver, sur un terrain particulièrement difficile, mes façons de faire de l’histoire, en mutation, plus visiblement peut être ici qu’ailleurs. »
Extrait de Jacques Le Goff. Saint Louis. Bibliothèque des Histoires, Gallimard, 1996. Page 15.
« Louis – François Pinagot a existé. L’état civil en témoigne. Il est né le 2 messidor an VI (20 juin 1798) « sur les trois heures du soir ». Il est mort à son domicile, le 31 janvier 1876. Puis il a sombré dans un oubli total. Jamais il n’a pris la parole au nom de ses semblables. Sans doute n’y a-t-il pas même songé ; d’autant qu’il était analphabète. Il n’a été mêlé à aucune affaire d’importance. Il ne figure sur aucun des documents judiciaires qui ont échappé à la destruction. Il n’a jamais fait l’objet d’une surveillance particulière de la part des autorités. Aucun ethnologue n’a observé ses manières de dire ou de faire. En bref, il est bien celui que je cherchais.
Il s’agit, en effet, d’inverser les procédures de l’histoire sociale du XIXe siècle. Celle du « peuple », sinon celle des élites, se fonde sur l’étude d’une gamme restreinte d’individus au destin exceptionnel ; lesquels, par le seul fait de prendre la plume, se sont extirpés du milieu qu’ils évoquent. Ils ont voulu porter témoignage ou se constituer en exemples ; d’où ces études présentées comme autant d’analyses de la « parole ouvrière », de la « parole des femmes » ou celle des « exclus ». Ces travaux ont fait le bonheur des éditeurs depuis la fin des années 1960. On ne s’est guère interrogé sur ce que les membres de cet être collectif, qui ne cesse d’advenir au cours du siècle et que l’on baptise « peuple », pouvaient alors penser de ces témoignages militants.
Il arrive, certes, qu’un évènement fortuit jette une brutale et brève lumière sur le grouillement des disparus ; qu’un individu anonyme fasse l’objet d’une enquête précise à la suite d’une catastrophe, d’une émeute ou d’un crime. Mais tout cela relève de l’exceptionnel, du paroxysme qui ouvre sur les profondeurs, sans nous décrire l’atonie des existences ordinaires.
Mon but est, ici, d’opérer un rassemblement, puis d’effectuer un assemblage de traces dont aucune n’a été produite par le désir de construire l’existence de Louis – François Pinagot en destin, ni même de la désigner comme individu susceptible d’en avoir un. En bref, il s’agit de recomposer un puzzle à partir d’éléments initialement dispersés ; et, ce faisant, d’écrire sur les engloutis, les effacés, sans pour autant prétendre porter témoignage. Cette méditation sur la disparition vise à faire exister une seconde fois un être dont le souvenir, auquel aucun lien affectif ne me rattache ; avec lequel je ne partage, a priori, aucune croyance, aucune mission, aucun engagement. Il s’agit de le re-créer, de lui offrir une seconde chance – assez solide dans l’immédiat – d’entrer dans la mémoire de son siècle. »
Extrait de Alain Corbin. Le monde retrouvé de Louis – François Pinagot, sur les traces d’un inconnu (1798 – 1876). Champs Flammarion, 1998.
Contre tout déterminisme historique
A propos de la « Modernité de Calvin ? », Yves Krumenacker s’oppose aux relations simplistes de cause à conséquence entre des « événements » artificiellement isolés de la « totalité du réel ».
« L’anachronisme consiste à considérer que Calvin s’est posé les problèmes d’autres temps que le sien et s’est donné les moyens de les résoudre. Le déterminisme n’est pas moins grave. Il se fonde sur un principe scolastique : post hoc, propter hoc, ce qui vient après un événement s’explique par cet événement. On est dans un rapport de causalité très simple, la succession des faits établis postule des relations de cause à effet : que l’après s’explique par l’avant amène à penser que l’avant détermine nécessairement l’après. Ainsi, qu’un pays calviniste soit moderne ne peut que s’expliquer par la modernité des idées de Calvin.
Ce schéma est évidemment tellement simple qu’il en est faux. Si tout événement dépend, au moins en partie, du passé, il n’est pas vrai que le passé engendre mécaniquement le présent. La difficulté de l’historien est qu’il connaît la suite de l’histoire, il sait ce qui suit le passé. Mais tout événement, l’expérience quotidienne le montre, est susceptible d’une infinité de conséquences. A proprement parler, un événement, comme un fait, n’existe même pas, il est découpé par l’observateur dans la réalité, en fonction de ses centres d’intérêt. Personne ne peut atteindre le tout d’une époque, ni même d’une vie ; on ne retient que ce qui nous paraît important, significatif, en fonction de critères que l’on veut objectifs, mais qui sont éminemment criticables : il n’est qu’à voir l’insatisfaction ressentie face aux écrits des historiens anciens qui, pourtant, faisaient honnêtement leur métier… Les événements, ces découpages plus ou moins habiles, ne peuvent donc être extraits de la totalité du réel que par une opération intellectuelle. Mais leurs conséquences dépendent de cette totalité bien plus que des liens que cherchent à tisser les historiens avec d’autres faits.
De Calvin pouvaient donc naître de multiples possibles, en fonction de la manière dont sa personne, ses idées, ses institutions ont été reçues, ont évolué sous le jeu d’autres circonstances, sous l’effet du hasard aussi sans doute. Les reconstructions a posteriori qui rendent logique la longue durée historique caricaturent, travestissent, risquent de faire oublier cette part de contingences qui détermine le déroulement des événements. Elles n’en permettent pas moins de comprendre l’évolution de l’histoire. Ce qui importe n’est pas de déterminer ce à quoi Calvin devait mener, ce serait se lancer dans une impasse anachronique. Mais on peut se demander quelles potentialités de sa vie, de son oeuvre, ont été mises en oeuvre par d’autres, et comment cela a été rendu possible. Autrement dit, la question n’est pas celle de la modernité de Calvin, mais de savoir ce que la modernité a pris, ou cru prendre à Calvin. Ce n’est qu’ainsi qu’on peut rendre compte de son importance historique sans en faire pour autant le père de tout le monde moderne. Le refuser, c’est s’enfermer dans la singularité d’une biographie particulière qui ne nous apprendrait rien, ou ne faire d’un destin individuel qu’une illustration significative d’une dynamique historique qui aurait, seule, une importance véritable. »
in Yves Krumenacker, Calvin. Au-delà des légendes. édition Bayard, 2009, pp. 519-520
Mémoire et Histoire
« Mémoire, histoire : loin d’être synonymes, nous prenons conscience que tout les oppose. La mémoire est la vie, toujours portée par des groupes vivants et, à ce titre, elle est en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir ou de l’amnésie, inconsciente de ses déformations successives, vulnérable à toutes les utilisations et manipulations, susceptibles de longues latences et de soudaines revitalisations. L’histoire est la reconstruction toujours problématique et incomplète de ce qui n’est plus. La mémoire est un phénomène toujours actuel, un lien vécu au présent éternel ; l’histoire une représentation du passé. Parce qu’elle est affective et magique, la mémoire ne s’accommode que des détails qui la confortent ; elle se nourrit de souvenirs flous, télescopants, globaux ou flottants, particuliers ou symboliques, sensibles à tous transferts, censures, écrans ou projections. L’histoire, parce que opération intellectuelle laïcisante, appelle analyse et discours critique. La mémoire installe le souvenir dans le sacré, l’histoire l’en débusque, elle prosaïse toujours. La mémoire sourd d’un groupe qu’elle soude, ce qui revient à dire, comme Halbwachs l’a fait, qu’il y a autant de mémoires que de groupes ; qu’elle est par nature, multiple et démultipliée, collective, plurielle et individualisée. L’histoire, au contraire, appartient à tous et à personne, ce qui lui donne vocation à l’universel. La mémoire s’enracine dans le concret, dans l’espace, le geste, l’image et l’objet. L’histoire ne s’attache qu’aux continuités temporelles, aux évolutions, et aux rapports des choses. La mémoire est un absolu et l’histoire ne connaît que le relatif.
Au cœur de l’histoire, travaille un criticisme destructeur de mémoire spontanée. La mémoire est toujours suspecte à l’histoire dont la mission vraie est de la détruire et de la refouler… Une société qui vivrait intégralement sous le signe de l’histoire ne connaîtrait, en fin de compte, pas plus qu’une société traditionnelle, de lieux où ancrer sa mémoire. »
Extrait de Pierre Nora. Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux. Les lieux de mémoire, I, Gallimard, 1984. pages XIX-XX.
Discours, mémoire, vérité
« Nous vivons l’éclatement de l’histoire. » La formule figure au dos des livres d’une célèbre collection qui s’intitule précisément Bibliothèque historique. Parmi les transformations qui, effectivement, semblent mettre en cause l’unité du genre lui-même, figure au premier rang l’attention portée au discours, non seulement aux « pratiques discursives », telles qu’elles se succèdent au long des siècles, dans l’entreprise qui fut celle de Michel Foucault, mais au discours de celui qui se présentait comme l’intouchable donneur de vérité, l’historien lui-même. Quand le Grec Hérodote décrit les barbares, que décrit-il en réalité, sinon des Grecs, des Grecs transformés, des Grecs inversés ? L’Autre est construit à partir du Même. On croit lire les usages et les lois des Perses et des Scythes, découvrir leurs visages, et l’on se trouve devant un tableau analogue à ceux du peintre baroque Arcimboldo qui construisait ses portraits avec des légumes, des fruits et des fleurs.
L’historien écrit, il produit le lieu et le temps, mais il est lui-même dans un lieu et dans un temps, au centre d’une nation, par exemple, ce qui entraîne l’élimination des autres nations. Ecrivant, il ne se confia longtemps qu’aux textes écrits, ce qui entraîna, dans le même temps, l’élimination de ce qui ne s’exprime que par l’oral ou par le geste que recueille l’ethnologue.
L’historien écrit, et cette écriture n’est ni neutre ni transparente. Elle se modèle sur les formes littéraires, voire sur les figures de rhétorique. Le recul permet de découvrir les unes et les autres. Ainsi, au XIXe siècle, Michelet est-il un réaliste romancer, Ranke, un réaliste comique, Tocqueville, un réaliste tragique, et J. Burckhardt, un réaliste praticien de la satire. Quant à Marx, il est un philosophe-apologiste de l’histoire, sur le mode de la métonymie et de la synecdoque. Que l’historien ait perdu son innocence, qu’il se laisse prendre comme objet, qu’il se prenne lui-même comme objet, qui le regrettera ? Reste que si le discours historique ne se rattachait pas, par autant d’intermédiaires qu’on le voudra, à ce que l’on appellera, faute de mieux, le réel, nous serions toujours dans le discours, mais ce discours cesserait d’être historique.
L’écriture n’est pas le seul mode de l’histoire. Pourquoi Shoah est-il une grande œuvre d’histoire, et non, par exemple, un recueil de contes ? Il ne s’agit ni d’une reconstitution romanesque comme Holocauste, ni d’un film documentaire – un seul document de l’époque y est lu, concernant les camions de Chelmno -, mais d’un film où des hommes d’aujourd’hui parlent de ce qui fut hier. Survivants juifs s’exprimant dans un espace qui fut jadis celui de la mort, tandis que roulent des trains qui ne conduisent plus aux chambres à gaz, anciens nazis délimitant ce que furent leurs exploits, les témoins reconstruisent un passé qui ne fut que trop réel ; les témoignages se recoupent et se confirment les uns les autres, dans la nudité de la parole et de la voix. Que l’historien soit aussi un artiste, nous en avons là la preuve absolue. »
Extrait de Pierre Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire, La Découverte, Paris, 1987, pp. 147-149.
C. A. Bayly : l’Histoire est relative.
« Les historiens sauvegardent leur emploi en procédant à peu près une fois par génération au rejet de toutes les idées précédemment acquises. C’est là quelque chose d’assez facile à faire car toute analyse historique est tributaire de ce sur quoi l’on choisit de mettre l’accent. »
C. A. Bayly, La naissance du monde moderne, 1780 – 1914, Editions de l’Atelier, Paris, 2007, p. 643.

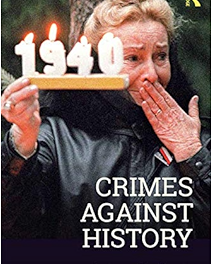
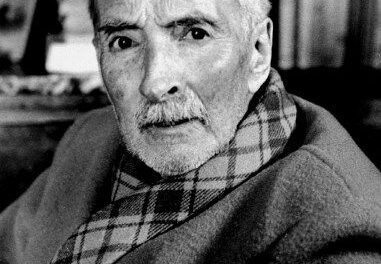
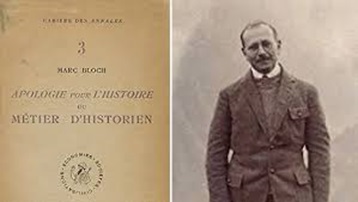









Trackbacks / Pingbacks