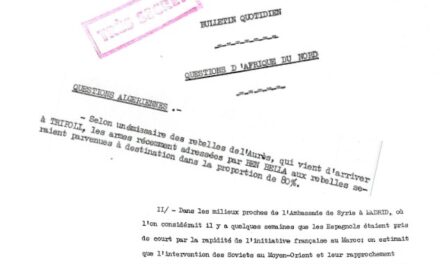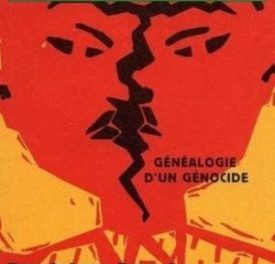La persécution antichrétienne en Annam en 1848
« La religion de Gia To (Jésus-Christ), déjà proscrite par les rois Minh Mang [1820-1841] et Thieu Tri [1841-1847], est évidemment une religion perverse car, dans cette religion, on ne rend pas le culte à ses parents morts, on arrache les yeux des mourants pour en faire une eau magique dont on se sert pour fasciner le peuple. De plus, on y commet beaucoup d’autres actes superstitieux et abominables. En conséquence, les maîtres européens, qui sont les plus coupables, seront jetés à la mer avec un pierre au cou. (…)
Les maîtres annamites sont moins coupables que les premiers. On les mettra à la question pour voir s’ils veulent renoncer à leurs erreurs. S’ils refusent, ils seront marqués au visage et exilés dans les endroits les plus malsains de l’Empire.
Les gens du peuple qui suivent cette religion perverse et qui ne voudraient pas y renoncer sont de pauvres idiots et de misérables imbéciles séduits par les prêtres. Il convient d’en avoir pitié. C’est pourquoi le roi, dans son grand amour, ordonne qu’ils ne seront plus punis de mort, d’exil ou de prison. Les mandarins se contenteront de les corriger sévèrement, puis on les renverra dans leurs familles. »
Édit du roi Tu Duc, août 1848.
La convention imposée au roi du Cambodge, 1884
« Entre S. M. Norodom Ier, roi du Cambodge ; d’une part, et M. Charles Thomson, gouverneur de la Cochinchine, agissant au nom du gouvernement de la République française, en vertu des pleins pouvoirs qui lui ont été conférés, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er. – S. M. le roi du Cambodge accepte toutes les réformes administratives, judiciaires, financières et commerciales, auxquelles le gouvernement de la République française jugera, à l’avenir, utile de procéder pour l’accomplissement de son protectorat.
Art. 2. – S. M. le roi du Cambodge continuera, comme par le passé, à gouverner ses États et à diriger leur administration, sauf les restrictions qui résultent de la présente convention.
Art. 3. – Les fonctionnaires cambodgiens continueront, sous le contrôle des autorités françaises, à administrer les provinces, sauf en ce qui concerne l’établissement et la perception des impôts, les douanes, les contributions indirectes, les travaux publics et, en général, les services qui exigent une direction unique et l’emploi d’ingénieurs ou d’agents européens. (…)
Art. 6. – Les dépenses d’administration du royaume et celles du protectorat seront à la charge du Cambodge. (…)
Art. 8. – L’esclavage est aboli sur tout le territoire du Cambodge.
Art. 9. – Le sol du royaume, jusqu’à ce jour propriété exclusive de la couronne, cessera d’être inaliénable. Il sera procédé par les autorités françaises et cambodgiennes à la constitution de la propriété au Cambodge. (…)
Fait à Phnom Penh, le 17 juin 1884, Charles Thomson. Norodom. »
Repris dans le Recueil des actes du gouvernement cambodgien. Saigon, 1920, pp. 63-5.
Les horreurs de la conquête du Tonkin (1884)
« (…) Sous le beau prétexte de civiliser et de pacifier, nous avons mis une contrée entière, dans ces belles plaines du delta ; à feu et à sang (…). Tout le long de notre marche rapide, les villages flambaient, d’immenses colonnes de fumée noire s’élevaient dans les airs. On pouvait voir les champs dévastés par les courses folles des hommes et des bestiaux, boeufs et cochons fuyant, éperdus, à la vue des flammes. Parfois des cadavres d’Annamites jonchaient les chemins. (…)
Devant chaque village – et combien on en a rencontré dans ce pays de population grouillante – le spectacle était le même. Jamais un coup de fusil dirigé contre nous, toujours, ou presque toujours, un silence morne nous révélant que la population s’était enfuie. (…) Dans les villages déserts, alors les sections, les escouades de transformaient en bandes de pillards. Chacun furetait pour son compte (…). Le pillage une fois terminé, on laissait après soi l’incendie dévorant tout le reste. Pour tous les Annamites capturés, c’était la fusillade sans merci. (…) »
Frédéric GARCIN, Au Tonkin pendant la conquête. Lettres d’un sergent 1884-1885. Paris, Éd. Chapelot, 1903.
Les maladresses de la domination française (1889)
« (…) Ignorants des coutumes des Annamites et ne rendant pas compte des devoirs que leur impose le traité de 1884, beaucoup de résidents se considèrent comme les seuls maîtres des provinces et font subir aux autorités annamites des traitements qui blessent, non seulement les fonctionnaires qui en sont l’objet, mais encore leurs subordonnés. Nous éloignons ainsi de nous les mandarins, dont le concours nous est cependant indispensable, puisqu’en vertu du traité ils conservent la gestion de toutes les affaires.
Nous blessons encore l’amour-propre et les intérêts des lettrés en choisissant en dehors de leurs rangs et dans une classe très inférieure et très ignorante de la société annamite, une partie des fonctionnaires plus élevés (…).
En faisant des choix aussi défectueux, nous obéissons à la politique traditionnelle des missionnaires, dont l’objectif est la destruction des lettrés ; mais nous allons contre nos intérêts politiques les plus directs en nous aliénant la partie la plus intelligente, la plus active et la seule influente du pays, celle que suivent aveuglément les ouvriers des villes et les cultivateurs des campagnes, celle qui représente, de l’aveu même des missionnaires, le parti national. (…)
Cette politique, en aliénant les hommes les plus riches et les plus précieux, nous [condamne] fatalement à la conquête et à l’annexion. (…) »
Jean-Louis de LANESSAN, L’Indo-Chine française, étude politique, économique et administrative sur la Cochinchine, le Cambodge, l’Annam et le Tonkin. Paris, Alcan, 1889, pp. 714-5.
Hanoi en 1897
« (…) Lorsque je vis Hanoi au commencement de mars 1897, elle était serrée autour de son petit lac qui séparait la ville française de la ville de la ville annamite. (…) Les quartiers annamites aux rues étroites, aux maisons basses avec leurs boutiques débordant sur la chaussée, grouillant de monde, étaient fort curieux. C’était là vraiment qu’était Hanoi. (…)
Et pourtant, en 1897, les gens avaient l’air misérable. Sous la fine et froide pluie, ils grelottaient, presque nus, sur les routes, mal protégés par un manteau étriqué, en paille, qu’ils tournaient du côté où la pluie fouettait leur corps. Leur vêtement, réduit le plus souvent à une grosse culotte s’arrêtant à la mi-cuisse, était de toile de coton grossière, d’une couleur brune semblable à celle de la terre et des eaux du fleuve. La robe des femmes était faite de la même étoffe (…). Le travail dans la boue des rizières, avec l’eau jusqu’aux genoux, paraissait autrement plus pénible, malsain même, dans le crachin et le froid, qu’au soleil chaud de la Cochinchine. (…)
L’impression qu’on ressentait, an arrivant au Tonkin, était pénible. C’était la pauvreté partout, malgré la richesse du sol ; c’était aussi l’insécurité. L’Annamite tonkinois nous regardait avec crainte ; on eût dit un pauvre animal battu qui a toujours à redouter la brutalité du maître. (…) »
Paul DOUMER, L’Indo-Chine française. Souvenirs. Paris, Vuibert, 1905 pp. 124, 134.
Une description de la société coloniale
(propos attribués à un gouverneur général)
« (…) Le Chinois est voleur et le Japonais assassin ; l’Annamite, l’un et l’autre. Cela posé, je reconnais hautement que les trois races ont des vertus que l’Europe ne connaît pas, et des civilisations plus avancées que nos civilisations occidentales. Il conviendrait donc à nous, maîtres de ces gens qui devraient être nos maîtres, de l’emporter au moins sur eux par notre moralité sociale. Il conviendrait que nous ne fussions, nous, les colonisateurs, ni assassins, ni voleurs. Mais cela est une utopie. (…)
Aux yeux unanimes de la nation française, les colonies ont la réputation d’être la dernière ressource et le suprême asile des déclassés de toutes les classes et de toutes les justices. (…) Nous hébergeons ici les malfaisants et les inutiles, les pique-assiettes et les vide-goussets. Ceux qui défrichent en Indo-Chine n’ont pas su labourer en France ; ceux qui trafiquent ont fait banqueroute ; ceux qui commandent aux mandarins lettrés sont fruits secs de collège ; et ceux qui jugent et qui condamnent ont été quelquefois jugés et condamnés. Après cela, il ne faut pas s’étonner qu’en ce pays l’Occidental soit moralement inférieur à l’Asiatique (…).
J’ai aperçu, parmi cette plèbe coloniale si méprisable, quelques individus supérieurs. À ceux-ci le milieu et le climat ont profité (…) Ils vivent en marge de notre vie trop conventionnelle (…). L’éclosion de pareils hommes n’est possible que dans cette Indo-Chine à la fois très vieille et très neuve (…). »
Claude FARRÈRE, Les civilisés. Paris, P. Ollendorff, 1906.
Un exemple de maladresse fiscale coloniale dans les années 1920
« (…) En dépit de maintes réclamations, les impôts du village de Kratéou ne rentraient pas. Un jour, Bardez reçoit de Phnom-Penh, à ce sujet, une note qu’il trouve désagréable. Bardez était le fonctionnaires du type « service-service », comme ont dit depuis la guerre ; au surplus, caractère assez roide et tempérament impulsif.
Vraiment ! il a assez entendu de ce sacré Kratéou : il ira, dès le lendemain, quérir lui-même les impôts ! C’étaient alors les fêtes du jour de l’an cambodgien. On le lui fait observer. Il part quand même ! Première erreur. Et, autre faute, pour une besogne où il a le tort de vouloir employer la force, il ne se fait accompagner que d’un seul milicien. ? N’apporte-il pas avec lui un sac plein de menottes ?…
En pleine fête, il arrive, fait sonner le gong… Imaginez un village breton, où le percepteur viendrait réclamer les contributions le jour de Noël… Des hommes de mauvais vouloir, lents, la face crispée, viennent peu à peu s’aligner devant l’Européen et son secrétaire-interprète :
– As-tu payé ton impôt ? Non ? Les menottes ! Et en prison !
Le milicien attache les poignets de ces hommes et, l’un après l’autre, les range derrière son chef. Eh, mais cela va tout seul ! Facilité de cauchemar… Le septième cambodgien était déjà en menottes, quand la femme se précipite, apportant l’argent.
– Trop tard, répond Bardez. En prison !
Protestations, cris. Le Blanc – trop tard, lui aussi – se rappelle qu’il n’est après tout qu’un homme, et qu’il est seul. Il rentre dans la case d’un notable, griffonne un billet à son adjoint, lui demandant main forte… Il n’est plus temps. La foule gronde. Un coupe-coupe se lève et abat le milicien. Bardez bondit par-dessus la balustrade de la case : il est saisi, assommé, mis en lambeaux. Tel fut l’acharnement de la foule que le refuge chez des bonzes n’arriva pas à sauver le secrétaire, réfugié dans une pagode pourtant inviolable. Seul, le chauffeur put se cacher à temps dans la forêt. Le lendemain, le village, épouvanté de son œuvre, était désert. On ne retrouva jamais les « vrais coupables ». Le principal, ce malheureux Bardez, n’avait que trop expié. (…) »
Luc DURTAIN, Dieux blancs, hommes jaunes. Paris, Flammarion, 1930.
Tract affiché au collège de Can Tho en 1929 par un élève vietnamien à l’adresse d’un surveillant d’étude vietnamien. L’élève sera exclu définitivement de l’enseignement public et de la fonction publique.
« A Monsieur T., surveillant d’études,
Vils et nuisibles Annamites [l’Annam désigne la partie centrale du Vietnam actuel]. Honte à vous, vous qui n’avez ni foi ni coeur, vous cherchez à vendre nos Terres, notre pays, toute la Cochinchine [désigne le sud du Vietnam actuel, le Tonkin étant le nord] aux Français. Nuisible à toute la race vietnamienne, vous cherchez à comploter avec les Français pour nous faire exclure. Il est bien regrettable que les gens instruits tels que vous, vous livrez à de telles bassesses : être du côté des Français ! Soyez certains que tôt ou tard, vous et Monsieur K. [l’instituteur] vous recevrez de nous de terribles vengeances. Les élèves ont déjà donné des coups au maître répétiteur T. H. l’année dernière, vous en souvenez-vous ? Tâchez de vous en repentir et ne soyez plus avec les Français. »
Cité par Trinh Van Thao, L’Ecole française en Indochine, Karthala, 1995.
Hô Chi Minh est le représentant de la délégation vietnamienne qui se rend à Tours en France en 1920. Il y fonde le Parti communiste vietnamien.
« Chers camarades, j’aimerais contribuer à la révolution mondiale, et c’est avec une grande tristesse que je viens ici comme membre du Parti socialiste dénoncer les crimes horribles perpétrés dans mon pays natal.
Camarades, vous savez que le capitalisme français a pénétré en Indochine il y a un demi-siècle ; pour faire du profit, il a usé des baïonnettes pour conquérir notre pays. Depuis, nous sommes non seulement opprimés et exploités de façon honteuse, mais torturés et empoisonnés sans pitié. Je ne peux en quelques minutes décrire toutes les atrocités que les prédateurs capitalistes ont infligées à l’Indochine. Les prisons, plus nombreuses que les écoles, sont sans cesse remplies de détenus. (…) Les colonialistes cherchent tous les moyens de nous empoisonner avec l’opium, de nous abrutir d’alcool. »
« Les malheureux paysans du Tonkin »
« Vous pouvez me croire, dit-il. J’ai vécu, moi, comme employé des plantations. A Kratié, là-bas, au Cambodge, à Thudaumot, à Phu-Quoc… J’ai vu ces malheureux paysans du Tonkin, si sobres, si vaillants, arriver joyeux sous la conduite de leurs bandits de cais, avec l’espoir de manger à leur faim, de rapporter quelques sous dans leurs villages. Au bout de trois ou quatre ans, ce ne sont plus que des loques : la malaria, le béribéri ! Ils essaient de marcher sur leurs jambes enflées d’oedèmes, rongées, traversées par une espèce de sale insecte, le san-quang ; leur rendement diminue-t’il avec leurs forces ou protestent-ils contre trop de misère ? Les cais les attachent à des troncs d’arbres, des piloris, où ils restent tout le jour à jeun, après avoir fait connaissance des rotins, des cadouilles, qui font saigner la peau flasque de leurs pauvres carcasses.
Le matin, à l’aube, quand la fatigue les tient collés à leur bat-flanc, où ils ont essayé de dormir malgdré les moustiques qui tuent, on vient les chasser des tanières où ils sont entassés, comme on ne chasse pas des troupeaux de l’étable.
A midi comme au soir, quand on leur distribue leur ration de riz souvent allégée du centaine de grammes, ils doivent d’abord préparer les repas des cais et, la dernière bouchée avalée, se remettre à la corvée, même couverts de plaies à mouches, même grelottants de fièvre. Tout cela pour 1 fr. 20 à 2 francs par jour qu’ils ne touchent jamais entièrement à cause des retenues, des amandes, des achats. (…) Leur correspondance est lue, traduite et souvent supprimée. Peu de nouvelles de leurs familles. La plupart ne la revoient jamais ou, s’ils regagnent leur village, ce sont de véritables épaves, sans argent et sans forces, qui reviennent pour mourir ; mais auparavant, ils sèment autour d’eux des germes de maladie, de révolte, de haine… C’est comme ça qu’on prépare les révolutions. »
Andrée Viollis, « Les malheureux paysans du Tonkin », in L’Histoire, octobre 1996, n°203, p. 29