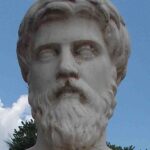La justice d’Ancien Régime est remise en question durant la Révolution française. En 1791, à l’occasion des débats constitutionnels et juridiques, le marquis de Saint-Fargeau [1760-1793] présente, lors de la séance du lundi 23 mai 1791, un très long rapport consacré au système répressif en France. Il trace plusieurs pistes pour rompre, en partie, avec les peines infligées sous l’Ancien Régime et marque ainsi le début d’une nouvelle ère, en rupture avec l’arbitraire royal.
Issu de la noblesse, ouvert aux idées des Lumières et fils d’un avocat général au parlement de Paris, Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau devient avocat du roi au Châtelet en 1777, puis en 1784, avocat général au parlement de Paris, et l’année suivante président à mortier. En mai 1789, il est élu député de la noblesse. Après avoir hésité, le marquis de Saint-Fargeau finit par embrasser la Révolution française et s’affirme comme un personnage central de l’Assemblée nationale constituante. Ses idées l’amènent en particulier à défendre une vision laïque et moderne de la société.
C’est dans ce contexte, qu’en 1791, il propose un projet de Code pénal contenant plusieurs axes issus de la réflexion des Lumières et de la pensée de Cesare Beccaria. Critique envers la peine de mort et opposé à l’emploi de la torture, il réfléchit également au moyen de remplacer les galères par une autre peine infamante. Pour cela, Saint-Fargeau, qui n’ignore rien du système pénal français de l’Ancien Régime, réfléchit à la notion d’enfermement, qui, sans être une norme, existe bel et bien dans le système judiciaire (l’embastillement en est un exemple), pour lui donner une nouvelle dimension. La plupart de ses propositions, contenues dans les extraits que nous vous proposons, se retrouvent quelques semaines plus tard dans le Code pénal promulgué le 6 octobre 1791. L’emprisonnement est alors nommé « la peine de fers ».
C’est ainsi que la prison fait son entrée dans le système judiciaire, en cohérence avec les idéaux affichés par la Révolution française.
Extrait n° 1 : réflexions sur les crimes et les peines
[…] Il existe deux sortes de crimes ; ceux qui sont l’effet du calcul et de la réflexion, et les crimes qui sont produits par l’impulsion subite d’une passion violente.
Une graduation exacte des peines opérera un effet moins efficace pour la répression de cette dernière sorte de crime parce que la passion ne voit que l’objet qui l’allume, et calcule peu les chances qu’elle court ; mais cette classe est la moins nombreuse.
Pour tous les autres la graduation des peines produit un effet certain.
Si une grande distance sépare la peine de tel crime d’avec la peine de tel autre crime, le méchant qui de sang-froid médite une mauvaise action, s’arrêtera là où commence pour lui un grand danger. La loi franchit-t-elle tous les degrés de la peine ; le méchant franchira aussi tous les degrés du crime. Il n’a point d’intérêt à s’arrêter ; nul calcul ne le retient.
C’était une grande absurdité de nos lois de punir le voleur sur le grand chemin, le serviteur qui dérobait quelques effets à son maître, l’homme qui en brisant des clôtures s’introduisait dans les maisons, de la même peine que l’assassin. La loi elle-même les invitait au meurtre, puisque le meurtre n’aggravait par la punition de leur crime, et pouvait en étouffer la preuve. […]
Il est un autre caractère que vos précédents décrets rendent inséparable de toute loi pénale : c’est d’établir pour chaque délit une peine fixe et déterminée. Telle est la conséquence nécessaire de la procédure par juré.
Les jurés jugent de la vérité du fait.
Le tribunal applique la loi.
Cette forme exclut tout arbitraire.
[…]
Mais si toute peine arbitraire au gré du juge doit être bannie de notre code, nous en écarterons bien plus soigneusement encore celles qui sont susceptibles d’être modifiées après le jugement. Toute peine qui par sa nature peut être ou aggravée ou atténuée suivant la disposition de celui qui l’a fait subir au condamné, est essentiellement mauvaise. Il faut qu’une peine soit et demeure ce que l’équité des lois l’a faite, et non ce que la rend la sévérité ou l’indulgence de l’exécuteur d’un jugement.
Les peines pour être répressives porteront encore trois caractères importants :
Le premier, d’être durables ;
Le second, d’être publiques ;
Le troisième, d’être toujours rapprochées du lieu où le crime a éclaté.
Je dis que les peines doivent être durables, et j’entends par cette expression qu’une suite prolongée de privations pénibles, en épargnant à l’humanité l’horreur des tortures, affecte beaucoup plus le coupable, qu’un instant passager de douleur trop souvent bravé par une sorte de courage et de philosophie. Les peines de cette nature sont encore plus efficaces pour l’exemple ; car bientôt l’impression du spectacle d’un jour est effacée ; mais une punition lente et de longs travaux renouvellent sans cesse aux yeux du peuple, qui en est témoin, le souvenir de lois vengeresses, et fait revivre à tous les moments une terreur salutaire.
J’ajoute que les peines doivent être publiques, c’est-à-dire que souvent, et à des temps marqués, la présence du peuple doit porter la honte sur le front du coupable, et la présence du coupable, dans l’état pénible où l’a réduit son crime, doit porter dans l’âme du peuple une instruction utile. […]
La peine de mort, emportant simple privation de la vie, peut paraître à quelques bons esprits devoir être conservée dans votre nouveau code. Mais ce que vous en bannirez sans doute, ce sont ces tortures dont la peine de mort était accompagnée d’après nos lois anciennes. Le feu, la roue, des supplices plus barbares encore, réservés pour les crimes de lèse-majesté ; toutes ces horreurs légales sont détestées par l’humanité et par l’opinion. […] Après la peine de mort, les galères sont le second degré des peines actuellement citées.
Les bases de cette punition sont les travaux publics, élément utile d’un bon système pénal. Mais il existe un vice radical dans ce mode de punir les condamnés ; leurs douleurs sont absolument perdues pour l’exemple. C’est dans un petit nombre de villes maritimes que les condamnés de tout l’Empire sont conduits ; il faut habiter Brest ou Toulon pour savoir quel est le sort d’un galérien ; et encore de quel spectacle sont témoins ceux qui considèrent de près cet établissement. Ils y voient des abus intolérables, des hommes frappés d’une condamnation semblable, et pourtant tout différemment traités : les uns, excédé de coups, de travail et de rigueur ; les autres ménagés, soignés, comblés de tous les adoucissements que comporte leur état ; et cela, selon la faveur ou la haine, la préférence ou la prévention, l’indulgence ou la sévérité d’un gardien, d’un conducteur ou d’un commandant ; peut-être aussi un peu selon l’industrie ou l’oisiveté, la bonne ou la mauvaise conduite du forçat ; mais qui toujours non pour juge que le caprice d’un seul homme. […]
Dans l’ordre des peines actuelles, l’hôpital ou la réclusion dans une maison de force, est pour les femmes ce que sont les galères pour les hommes.
Privation de liberté et travail, tels sont les éléments de cette peine : avec quelque modification elle est bonne et salutaire. La principale réforme que vous jugerez convenable d’y apporter, sera, sans doute, de ne plus confondre la prostitution avec le crime, et de séparer un établissement purement correctionnel, d’avec ceux qui seront formés pour recevoir les victimes dévouées par la loi aux souffrances et à l’infâmie des peines afflictives.
Je ne dirais qu’un mot sur la mutilation. Cette peine était rarement usitée ; mais les réflexions que je vous ai présentées relativement aux tortures, et relativement à la marque, s’appliquent aussi à ce genre de punition, et évidemment doivent le faire proscrire.
Il est une autre peine d’un usage bien plus fréquent, car elle s’applique aux délits les plus ordinaires ; je veux dire le bannissement, qui envoyait les condamnés d’un tel parlement dans la province voisine sous condition, et avec l’assurance de recevoir bientôt, réciproquement, les scélérats dont cet autre parlement purgeait son ressort : échange absurde et funeste, qui déplaçait le criminel sans réprimer ni punir le crime ! Toutes les opinions se réunissent depuis longtemps pour la suppression de cette peine ; dans les discussions polémiques, pas un écrivain n’a tenté de la défendre. […]
Extraits pages 322 – 324
Extrait numéro 2 : de l’intérêt d’emprisonner les individus
[…]Il n’est qu’un seul moyen d’adoucir la barbarie des peines, sans affaiblir le sentiment du salutaire effroi qu’elles doivent inspirer ; c’est de frapper l’esprit des hommes en renouvelant le système pénal dans sa totalité ; vous invitez par là l’évidence et l’inconvénient des rapprochements et des comparaisons ; vous inspirez certainement aux malfaiteurs un plus grand effroi, par l’établissement d’une peine, d’un exemple imposant jusqu’alors inusité ; vous produirez l’effet tout contraire en descendant visiblement la punition terrible d’une action atroce au degré moins rigoureux d’une peine bien connue qu’autrefois on appliquait à de moindres crimes. […]
Extrait page 326
[…] Voici, Messieurs, ce que nous vous proposons de substituer à la peine capitale.
Nous pensons qu’il est convenable d’établir une maison de peine dans chaque ville où siège un tribunal criminel, afin que l’exemple soit toujours rapproché du lieu du délit. C’est une maison par département.
Avant d’y être conduit, le condamné sera exposé pendant trois jours sur un échafaud dressé dans la place publique, il sera attaché à un poteau ; il paraîtra chargé des mêmes fers qu’il doit porter pendant la durée de sa peine. Son nom, son crime, son jugement, seront tracées sur un écriteau placé au-dessus de sa tête. Cet écriteau présentera également les détails de la punition qu’il doit subir.
Cette peine ne consiste pas en coups ni en tortures ; il sera fait, au contraire, les plus sévères défenses aux gardiens des condamnés d’exercer envers eux aucun acte de violence.
C’est dans les privations multipliées des jouissances, dont la nature a placé le désir dans le cœur de l’homme, que nous croyons convenable de chercher les moyens d’établir une peine efficace.
Un des plus ardents désirs de l’homme, c’est d’être libre : la perte de sa liberté sera le premier caractère de sa peine.
La vue du ciel et de la lumière est une de ses plus douces jouissances : le condamné sera détenu dans un cachot obscur.
La société le commerce de ses semblables sont nécessaires à son bonheur ; le condamné sera voué à une entière solitude.
Son corps et ses membres porteront des fers. Du pain, de l’eau, de la paille, lui fourniront pour sa nourriture et pour son pénible repos l’absolu nécessaire.
Messieurs, on prétend que la peine de mort est seule capable d’effrayer le crime ; l’état que nous venons de décrire serait pire que la mort la plus cruelle, si rien n’en adoucissait la rigueur : la pitié même dont vous êtes émus prouve que nous avons assez et trop fait pour l’exemple : nous avons donc une peine répressive.
Mais n’oublions pas que toute peine doit être humaine, et portons quelques consolations dans ce cachot de douleur.
Le premier et le principal adoucissement de cette peine, c’est de la rendre temporaire.
Le plus cruel état est supportable lorsqu’on aperçoit le terme de sa durée. Le mot à jamais est accablant ; il est inséparable du sentiment de désespoir. Nous avons pensé que, pour l’efficacité de l’exemple, la durée de cette peine devait être longue ; mais que, pour quelle ne fut pas barbare, il fallait qu’elle eût un terme. […]
Extrait page 327
Extrait n° 3 : les trois degrés d’emprisonnement : le cachot, la gêne et la prison
[…] Le cachot, la gêne, la prison ont pour principe commun d’exclure du système pénal toute espèce de coups et de tortures qui présentent à l’esprit cette repoussante image d’un homme frappant son semblable.
Ces trois peines ont pour élément commun de faire sortir de privations pénibles, tout l’effet de la punition.
Elles ont trois circonstances qui leur sont communes : la privation de liberté, l’infamie, l’admission du public une fois chaque mois dans les cachots, les lieux de gêne et la prison.
Enfin, dans toutes les trois, le travail est employé comme moyen d’amender les dispositions morales du condamné, d’adoucir la rigueur de ses privations pendant sa peine, et de lui préparer une ressource pour l’époque de sa liberté.
Quant aux caractères qui les distinguent les unes des autres, le premier c’est la durée.
La peine du cachot ne pourra être moindre de 12 années, celle de la gêne, de quatre années ; celle de la prison, de deux années.
La première ne pourra s’étendre au-delà de 24 années, la seconde, au-delà de 15 ans, la troisième, au-delà de six ans.
Vos comités ont pensé que ces peines devaient être graduées de telle manière, que la plus longue durée de l’une excède peu la moindre durée de celle qui lui est supérieure, afin qu’elles demeurent sans incertitudes et sans équivoque dans cet ordre de gravité ; d’abord le cachot, ensuite la gêne, et enfin la prison, autrement cet inconvenable problème aurait pu se présenter à résoudre : laquelle de ces peines est la plus sévère, de la gêne pendant 24 ans, ou du cachot pendant 12 ans ; de la prison pendant 12 ans, ou de la gêne pendant six années.
Indépendamment de la durée, le cachot est distingué des deux autres peines par ces circonstances : la privation de la lumière, les fers aux pieds et aux mains des condamnés, la solitude absolue, la consolation du travail réduit à deux jours par semaine pendant la première époque, et à trois pendant la deuxième.
La gêne est distinguée de la prison, outre la durée, par une ceinture et une chaîne de fer que porteront les condamnés, par la solitude absolue pendant cinq jours pendant la semaine, par la réunion à un travail commun de jours par semaine seulement.
La prison est distinguée des deux autres, sous ce rapport que les condamnés ne porteront point de fers, qu’il leur sera fourni un lit pour se coucher, tandis qu’au cachot et à la gêne il ne sera donné aux condamnés que de la paille ; enfin que le travail commun sera permis tous les jours.
À l’égard des peines infamantes, voici, Messieurs, les caractères que nous avons cru convenable de leur imprimer.[…]
Extrait pages 330-331
Source : Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 8-17, 19, 21-33. Assemblée nationale constituante. 26. Du 12 mai au 5 juin 1791, sous la direction de M. J. Mavidal / impr. par ordre du Sénat et de la Chambre des députés, Paris, P. Dupont P. Dupont, 1887, extraits de l’annexe à la séance de l’Assemblée nationale, lundi 23 mai 1791, rapport présenté par M. Lepeletier de Saint-Fargeau.