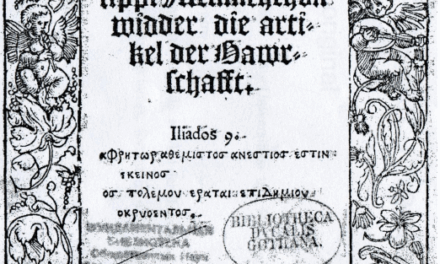Extraits des
Mémoires De Frédérique Sophie Wilhelmine Margrave De Bayreuth Soeur De Frédéric Le Grand Depuis L’Année 1706 Jusquà 1742 Écrits De Sa Main
(titre originel de la version française qui s’arrête en 1742 et est donc incomplète)

Elle eut beaucoup à souffrir, ainsi que son frère, dans sa jeunesse des violences du roi. Elle épousa en 1731 l’héritier du margraviat de Bayreuth et fut mère de Elisabeth Friederike Sophie de Brandenburg-Bayreuth (1732-1780), décrite par Giacomo Casanova comme la plus belle fille d’Allemagne, qui se maria à Karl Eugen de Württemberg en 1748.
Voltaire a écrit une Ode sur sa mort.
Elle a laissé des Mémoires (de 1700 à 1742), qui n’ont paru qu’en 1810 ; reimprimées à Paris, en 1845 ; ils offrent les plus intéressants détails sur l’intérieur de la cour de Prusse.
La Correspondance de cette princesse avec Frédéric II a été imprimée dans les Œuvres du roi (tome XXVII). »
Article Wilhelmine de Bayreuth , in :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelmine_de_Bayreuth (consulté le 20 mars 2007)
Pour plus de renseignements et de meilleurs, voyez la version anglaise de cet article : http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelmine_of_Bayreuth
Mon expérience m’a enseigné que la version anglaise de Wikipédia était bien meilleure que la version française (même sur de nombreux sujets de l’histoire de France) ! Généralement, la version anglaise est toujours plus développée avec plus de références. J’exige donc de mes élèves du lycée qu’ils contrôlent le contenu des articles en français sur Wikipédia par la lecture des articles sur les mêmes sujets en anglais.
Patrice Delpin
—-
Pierre le Grand rend visite à Frédéric-Guillaume de Prusse (orthographe d’époque)
« Ce prince [Pierre le Grand] qui se plaisoit beaucoup à voyager venoit de Hollande. Il avoit été obligé de s’arrêter au pays de Clèves, la Czarine y ayant fait une fausse couche. Comme il n’aimoit ni le monde, ni les cérémonies, il fit prier le roi de le loger dans une maison de plaisance de la reine qui étoit dans les faubourgs de Berlin. Cette princesse en fut fort fâchée, elle avoit fait bâtir une très-jolie maison qu’elle avoit pris soin d’orner magnifiquement. La galerie de porcelaine qu’on y voyait étoit superbe, aussi bien que toutes les chambres décorées de glaces, et comme cette maison étoit un vrai bijou, elle en portait le nom. Le jardin étoit très-joli et bordé par la rivière, ce qui lui donnoit un grand agrément.
La reine pour prévenir les désordres que Mrs. les Russes avoient faits dans tous les autres endroits où ils avoient demeuré, fit démeubler toute la maison en en fit emporter ce qu’il y avoit de plus fragile. Le Czar, son épouse et toute leur cour arrivèrent quelques jours après par eau à Mon-bijou. Le roi et la reine les reçurent au bord de la rivière. Le roi donne la main à la Czarine pour la conduire à terre. Dès que le Czar fut débarqué, il tendit la main au roi et lui dit : je suis bien aise de vous voir, mon frère Frédéric. Il s’approcha ensuite de la reine qu’il voulut embrasser, mais elle le repoussa. La Czarine débuta par baiser la main à la reine, ce qu’elle fit à plusieurs reprises. Elle lui présenta ensuite le duc et la duchesse de Mecklenbourg qui les avoient accompagnés et 400 soi-disantes dames qui étoient à sa suite. C’étoient pour la plupart des servantes allemandes, qui faisoient fonction de dames, de femmes de chambre, de cuisinières et de blanchisseuses. Presque toutes ces créatures portoient chacune un enfant richement vêtu sur les bras, et lorsqu’on leur demandoit si c’étoient les leurs, elles répondoient en faisant des salamalecs à la russe : le Czar m’a fait l’honneur de me faire cet enfant. La reine ne voulut pas saluer ces créatures. La Czarine en revanche traita avec beaucoup de hauteur les princesses du sang, et ce ne fut qu’avec beaucoup de peine, que le roi obtint d’elle qu’elle les saluât. Je vis toute cette cour le lendemain où le Czar et son épouse vinrent rendre visite à la reine. Cette princesse les reçut aux grands appartemens du château, et alla au devant d’eux jusqu’à la salle des gardes. La reine donna la main à la Czarine, lui laissant la droite et la conduisit dans sa chambre d’audience.
Le roi et le Czar les suivirent. Dès que ce prince me vit, il me reconnut, m’ayant vue cinq ans auparavant. Il me prit entre ses bras et m’écorcha tout le visage à force de me baiser. Je lui donnois des soufflets et me débattois tant que je pouvois, lui disant que je ne voulois point de ces familiarités et qu’il me déshonoroit. Il rit beaucoup de cette idée et s’entretint long-temps avec moi. On m’avoit fait ma leçon ; je lui parlai de sa flotte et de ses conquêtes, ce qui le charma si fort qu’il dit plusieurs fois à la Czarine que s’il pouvoit avoir un enfant comme moi, il céderoit volontiers une de ses provinces. La Czarine me fit aussi beaucoup de carresses. (…)
La Czarine étoit petite et ramassée, fort basanée et n’avoit ni air ni grâce. Il suffisoit de la voir pour deviner sa basse extraction. On l’auroit prise à son affublement pour une comédienne allemande. (…)
Le Czar en revanche étoit très-grand et assez bien fait, son visage étoit beau, mais sa physionomie avoit quelque chose de si rude qu’il faisoit peur. Il étoit vêtu à la matelote avec un habit tout uni. (…)
On se mit à table où le Czar se plaça à côté de la reine. Il est connu que ce prince avoit été empoisonné. Dans sa jeunesse le venin le plus subtile lui était tombé sur les nerfs, ce qui étoit cause qu’il prenoit très-souvent des espèces de convulsions, qu’il n’étoit pas en état d’empêcher. Cet accident lui prit à table, il faisoit plusieurs contorsions et comme il tenoit son couteau et qu’il en gesticuloit fort près de la reine, cette princesse eut peur et voulut se lever à plusieurs reprises. Le Czar la rassura, et la pria de se tranquilliser, parce qu’il ne lui feroit aucun mal : il lui prit en même temps la main qu’il serra avec tant de violence entre les siennes que la reine fut obligée de crier miséricorde, ce qui le fit rire de bon cœur, lui disant qu’elle avoit les os plus délicats que sa Catherine. On lui fit voir le jour suivant tout ce qu’il y avoit de remarquable à Berlin, et entr’autres le cabinet de médailles et de statues antiques. Il y en avoit une parmi ces dernières, à ce qu’on m’a dit, qui représentoit une divinité païennes dans une posture fort indécente : on se servoit du temps des anciens Romains de ce simulacre pour parer les chambres nuptiales. On regardoit cette pièce comme très-rare ; elle passait pour être une des plus belles qu’il y ait. Le Czar l’admira beaucoup et ordonna à la Czarine de la baiser. Elle voulut s’en défendre, il se fâcha et lui dit en allemand corrompu : Kop ab, ce qui signifie : je vous ferai décapiter si vous ne m’obéissez pas. La Czarine eut si peur qu’elle fit tout ce qu’il voulut. Il demanda sans façon cette statue et plusieurs autres au roi qui ne put les lui refuser. Il en fit de même d’un cabinet dont toute la boiserie étoit d’ambre. Ce cabinet étoit unique dans son espèce et avoit coûté des sommes immenses au roi Frédéric premier. Il eut le triste sort d’être conduit à Petersbourg au grand regret de tout le monde.
Cette cour barbare partit enfin deux jours après. La reine se rendit d’abord à Mon-bijou. La désolation de Jérusalem y régnoit ; je n’ai jamais rien vu de pareil, tout y étoit tellement ruiné que la reine fut obligée de faire rebâtir presque toute la maison. »
Extraits des Mémoires de la Margrave de Bayreuth. Paris, Mercure de France, 1967/2001, pp. 59 – 63.
—-
Frédéric-Guillaume Ier de Prusse, le roi sergent brutalise son fils, le futur Frédéric II
Wilhelmine, soeur de Frédéric II de Prusse, raconte dans ses Mémoires les multiples violences exercées par son père sur le futur roi.
» Mon frère commençait de même de recevoir ses caresses accoutumées de coups de canne et de poing. Nous cachions nos souffrances à la reine. Mon frère s’impatientait de plus en plus, et me disait qu’il était résolu de s’enfuir et qu’il n’en attendait que l’occasion. Son esprit était si aigri, qu’il n’écoutait plus mes exhortations et s’emportait même souvent contre moi. Un jour, que j’employais tous mes efforts pour l’apaiser, il me dit : « vous me prêchez toujours la patience, mais vous ne voulez jamais me mettre en ma place ; je suis le plus malheureux des hommes, environné depuis le matin jusqu’au soir d’espions, qui donnent des interprétations malignes à toutes mes paroles et actions; on me défend les récréations les plus innocentes : je n’ose lire, la musique m’est interdite, et je ne jouis de ces plaisirs qu’à ma dérobée et en tremblant. Mais ce qui a achevé de me désespérer est l’aventure qui m’est arrivée en dernier lieu à Potsdam, que je n’ai point voulu dire à la reine pour ne pas l’inquiéter. Comme j’entrai le matin dans la chambre du roi, il me saisit d’abord par les cheveux et me jeta par terre où, après avoir exercé la vigueur de ses bras sur mon pauvre corps, il me traîna malgré toute ma résistance, à une fenêtre prochaine ; (…) prenant la corde qui attachait le rideau, il me la passa autour du cou. J’avais eu par bonheur pour moi le temps de me relever, je lui saisis les deux mains et me mis à crier. Un valet de chambre vint aussitôt à mon secours et m’arracha de ses mains. »
Frédérique Sophie Wilhelmine, Margrave de BAYREUTH, Mémoires depuis l’année 1706 jusqu’à 1742, Paris, Mercure de France (Le temps retrouvé), 1967, pp.179-180.
—-
La cour du Margrave de Bayreuth en 1732 (orthographe d’époque)
Epouse de l’héritier de Bayreuth (qu’on écrit alors Bareith), la future margrave arrive dans sa nouvelle capitale en 1732. Elle décrit la réception qui lui est faite et l’appartement qui sera désormais le sien.
« J’y arrivai enfin le 22. de Janvier [1732] à six heures du soir. On sera peut-être curieux de savoir mon entrée ; la voici. A une portée de fusil de la ville, je fus haranguée de la part du Margrave par Mr. De Dobenek, grand-bailli de Bareith. C’était une grande figure tout d’une venue, affectant de parler un allemand épuré et possédant l’art déclamatoire des comédiens germaniques, d’ailleurs très-bon et honnête homme. Nous entrâmes peu après en ville au bruit d’une triple décharge de canon. Le carosse où étoient les Messieurs commença la marche ; puis suivoit le mien, attelé de six haridelles de poste ; ensuite mes dames ; après les gens de la chambre et enfin six ou sept chariots de bagages fermoient la marche. Je fus un peu piquée de cette réception, mais je n’en fis rien remarquer. Le Margrave et les deux princesses ses filles me reçurent au bas de l’escalier avec la cour ; il me conduisit d’abord à mon appartement. Il étoit si beau, qu’il mérite bien que je m’y arrête un moment. J’y fus introduite par un long corridor tapissé de toiles d’araignées et si crasseux, que cela faisoit mal au cœur. J’entrai dans une grande chambre, dont le plafond, quoique antique, faisoit le plus grand ornement ; la hautelice qui y étoit, avoit été, à ce que je crois, fort belle de son temps, pour lors elle étoit si vieille et si ternie, qu’on ne pouvoit deviner ce qu’elle représentoit qu’avec l’aide d’un microscope ; les figures en étoient en grand et les visages si troués et passés, qu’il sembloit que ce fussent des spectres. Le cabinet prochain étoit meublé d’une brocatelle couleur de crasse ; à côté de celui-ci on en trouvoit un second, dont l’ameublement de damas vert piqué faisoit un effet admirable ; je dis piqué, car il étoit en lambeaux, la toile paroissant partout. J’entrai dans ma chambre de lit, dont tout l’assortiment étoit de damas vert avec des aigles d’or éraillés. Mon lit était si beau et si neuf, qu’en quinze jours de temps il n’avoit plus de rideaux, car dès qu’on y touchoit ils se déchiroient. Cette magnificence à laquelle je nétois pas accoutumée, me surprit extrêmement. Le Margrave me fit donner un fauteuil ; nous nous assîmes tous pour faire la belle conversation, où Télémaque et Amelot ne furent point oubliés.
[Dans les lignes qui suivent, la future Margrave fait le portrait des notables qu’on lui présente.]
Je fus très-mal édifiée de cette cour, et encore plus de la mauvaise chère que nous fîmes ce soir-là ; c’étoient des ragoûts à la diable, assaisonnés de vin aigre, de gros raisins et d’ognons. Je me trouvai mal à la fin du repas et fut obligée de me retirer. On n’avoit pas eu les moindres attentions pour moi, mes appartemens n’avoient pas été chauffés, les fenêtres y étoient en pièces, ce qui causoit un froid insoutenable. Je fus malade à mourir toute la nuit, que je passai en souffrances et à faire de tristes réflexions sur ma situation. Je me trouvai dans un nouveau monde avec des gens plus semblables à des villageois qu’à des courtisans ; la pauvreté régnoit partout ; j’avois beau chercher ces richesses qu’on m’avoit tant vantées, je n’en voyois pas la moindre apparence. Le prince s’efforçoit de me consoler ; je l’aimois passionnément ; la conformité d’humeur et de caractère lie les cœurs ; elle se trouvoit en nous, et c’étoit l’unique soulagement que je trouvasse à mes peines.
Je tins appartement le lendemain. Je trouvai les dames aussi désagréables que les hommes. »
Extraits des Mémoires de la Margrave de Bayreuth. Paris 1967/2001, pp. 331 – 336.
—-
La mort de Frédéric-Guillaume de Prusse (1688 – 1740) (orthographe d’époque)
Fille de Frérédic-Guillaume Ier, le « Roi-Sergent », la Margrave de Bayreuth décrit la mort du roi à partir des lettres reçues de sa famille.
« Il avoit été mal toute la nuit. À sept heures du matin il se fit traîner sur son char roulant dans l’appartement de la reine, qui dormoit encore, ne le croyant pas si mal. Levez-vous, lui dit-il, je n’ai que quelques heures à vivre, j’aurai du moins la satisfaction de mourir dans vos bras. Il se fit mener ensuite chez mes frères, dont il prit tendrement congé, à la réserve du prince royal [le futur Frédéric II], auquel il ordonna de le suivre dans son appartement. Dès qu’il y fut, il y fit assembler les deux premiers ministres, le prince d’Anhalt et tous les généraux et colonels qui se trouvoient à Potsdam. Après leur avoir fait un petit discours, pour les remercier de leurs services passés, et les avoir exhortés à conserver pour le prince royal, comme son unique héritier, la fidélité qu’ils avoient eue pour lui, il fit la cérémonie de l’abdication et remit toute son autorité à son fils, auquel il fit une très-belle exhortation sur les devoirs des princes envers leurs sujets, et lui recommanda le soin de l’armée et surtout des généraux et officiers qui étoient présens. Se tournant ensuite du côté du prince d’Anhalt : vous êtes le plus ancien de mes généraux, lui dit-il, il est juste que je vous donne le meilleur de mes chevaux. Il ordonna en même temps qu’on le lui menât ; et voyant le prince attendri : c’est le sort de l’homme, lui dit-il, il faut qu’ils payent tous le tribut à la nature. Mais craignant de voir sa constance ébranlée par les pleurs et les lamentations de tous qui étoient présens, il leur signifia de se retirer, ordonnant à tous les domestiques de mettre une nouvelle livrée qu’il avoit fait faire, et à son régiment de mettre un nouvel uniforme. La reine entra sur ces entrefaites. À peine fut-elle un quart d’heure dans cette chambre, que le roi tomba en foiblesse. On le mit aussitôt au lit, où, à force de soins on le fit revenir. Regardant alors autour de lui et voyant les domestiques en neuf : vanités des vanités, dit-il, tout est vanité. S’adressant à son premier médecin, il lui demanda si sa fin étoit prochaine. Le médecin lui ayant répondu, qu’il avoit encore une demi-heure à vivre, il demanda un miroir, et s’y étant miré, il sourit et dit : je suis bien changé, je ferai une vilaine grimace en mourant. Il réitéra encore la même question aux médecins, et sur la réponse qu’ils lui firent, qu’il s’étoit déjà écoulé un quart d’heure et que son pouls montoit : tant mieux, leur répondit-il, je rentrerai bientôt dans mon néant. On voulut faire entrer deux ecclésiastiques, pour lui faire la prière, mais il leur dit, qu’il savoit tout ce qu’ils avoient à lui dire, qu’ainsi ils pouvoient se retirer. Les foiblesses étant devenues plus fréquentes, il expira enfin à midi. Le nouveau roi conduisit d’abord la reine dans son appartement, où il y eut beaucoup de larmes versées. Je ne sais si elles étoient fausses ou sincères. »
Extraits des Mémoires de la Margrave de Bayreuth. Paris, Mercure de France, 1967/2001, pp.556 – 557.