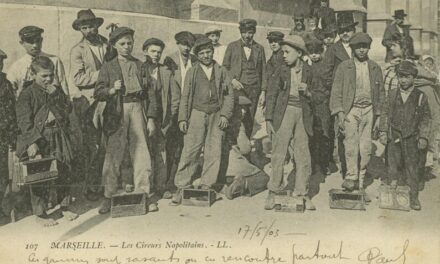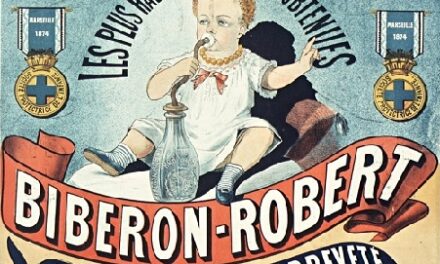Loin de calmer les manifestants, la mort d’Antoine Nuger provoque un regain de manifestations dans le Quartier Latin, manifestations qui se doublent de nouvelles violences, les jours suivants. Rapidement, l’escalade a lieu. Les 3, 4 et 5 juillet, le quartier est vandalisé tandis que la préfecture de police est assiégée par les manifestants, comme le rapporte largement la presse. Mais, parallèlement à celles liées à la mort d’Antoine Nuger, d’autres manifestations éclatent, liées cette fois-ci à la fermeture autoritaire de la Bourse du Travail, provoquant la colère de la classe ouvrière. Une convergence des luttes et des manifestations s’opère.
Cependant, c’est l’irruption de la police à l’Hôtel Dieu, hôpital (re)construit à la fin des années 1870 sur l’île de la Cité, à proximité de Notre-Dame, le point d’orgue des violences policières qui provoque un véritable scandale. Ce dernier est alors tel que le député Camille Dreyfus interpelle Charles Dupuy, alors président du Conseil et Ministre de l’Intérieur sur les événements, lors de la séance du 8 juillet.
Extrait n° 1 : la poursuite des violences
Les manifestations tumultueuses d’avant-hier ont dégénéré hier en de véritables émeutes d’autant plus menaçantes que le gouvernement semble se refuser à comprendre son devoir.
La situation s’est, en effet, complètement modifiée depuis deux jours : il ne s’agit plus de démonstrations très contestables d’ailleurs contre un arrêt bienveillant que de futurs magistrats auraient pu respecter; il ne s’agit plus de protestations fort compréhensibles contre les brigades centrales, dont la rudesse avait occasionné une mort.
La police a été menacée dans ses postes, assiégée dans sa propre préfecture où elle s’était retranchée ; l’armée, appelée à son aide, a été conspuée, les kiosques du boulevard Saint-Michel ont été brûlés, des omnibus et des tramways ont été renversés, des rues barricadées ; et les vrais étudiants, effrayés des actes de vandalisme et de niaiserie que l’on commettait en leur nom, voyaient se presser dans la rue, sous leur bannière, se mêlant aux badauds stupides, les cochers des dernières grèves, les inévitables pâtissiers, boulangers et ouvriers sans travail, les anarchistes en quête d’échauffourée, enfin tous les éléments révolutionnaires qui viennent, on ne sait d’où, aux jours troublés.
Certes, rien n’est perdu et les journaux étrangers auraient tort de triompher de ces désordres passagers dont ils vont chercher à exagérer l’importance et la portée. Mais une leçon se dégage de ces douloureux incidents : le gouvernement a manqué au premier de ses devoirs qui était de protéger la rue.
Par ses tergiversations, ses timidités, son manque de décision et d’énergie, le ministère Dupuy n’a pas su sauver la paix publique ; sa police, qui s’était montrée trop violente samedi devant une gaminerie, a été, hier et avant-hier, trop hésitante devant l’émeute. Elle n’a pas su la réprimer assez vigoureusement. Le Parisien, qui tient à vaquer en toute tranquillité à ses occupations quotidiennes, voire à ses plaisirs, est donc fort justement irrité contre un gouvernement qui laisse se dresser ainsi des barricades pour le bon plaisir de quelques farceurs, et il réclame avec quelque raison une volonté plus ferme et une protection plus réelle.
Voici, heure par heure, le récit détaillé des divers incidents qui ont rappelé si malheureusement la physionomie, depuis longtemps oubliée, des soirées de la Commune :L’incendie des Kiosques
A une heure du matin, mardi, la manifestation semblait terminée. Les étudiants rentraient chez eux. Les cafés fermaient.
Tout à coup, un certain nombre d’individus en bourgeron, en blouse, en casquette de soie, sales, dépenaillés, qui s’étaient déjà signalés à l’assaut de la préfecture de police, se mettent à briser tous les kiosques. Un d’entre eux est arrêté par les étudiants eux-mêmes et conduit au poste du Panthéon. Mais les autres continuent. Un kiosque, au coin du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel, est renversé et on y met le feu… On fait de même à un second au bout du pont Saint-Michel.
Les pompiers, dont l’état-major touche à la préfecture, sortent avec une pompe à bras et se mettent à éteindre l’incendie. Les manifestants qui, à ce moment-là, ne sont plus, nous le répétons, des étudiants, mais d’ignobles voyous, veulent les en empêcher et coupent les tuyaux. La garde municipale à cheval sort et les incendiaires s’enfuient.
Ils reviennent dès que les soldats se retirent et se sauvent à la moindre alerte. C’est la légendaire manoeuvre de tous les rassemblements parisiens.
Cela dure jusqu’à deux heures du matin. A ce moment, sur la place de la Sorbonne, des agents qui conduisaient au poste un individu arrêté ont été assaillis par une bande qui leur a lancé des morceaux de fonte. Des coups de revolver ont été échangés. Deux blessés, un avocat et un étudiant en médecine ont été conduits à la pharmacie Durozier et, après pansement, ont pu regagner leurs domiciles.
Vers deux heures et demie les derniers manifestants sont cernés entre deux troupes de gardiens de la paix. C’est la dernière bagarre de la nuit. […]
Le Figaro, 5 juillet 1893, page 1 extrait
Extrait n° 2 : l’Hôtel Dieu envahi par la police
[…] Un fait d’une gravité exceptionnelle, dont nous ne voulions parler qu’après une enquête des plus sérieuses, s’est produit mardi soir à l’Hôtel-Dieu. A la suite d’un commissaire de police, une trentaine d’agents ont envahi l’hôpital, sabre au poing, pourchassant dans les couloirs et jusque dans les salles de garde les internes et les infirmiers. Cette bagarre aurait eu les conséquences les plus graves si M. Lozé, préfet de police, accouru tout d’abord pour appuyer de son autorité morale ses subordonnés, n’avait enfin compris l’énormité de l’acte accompli par ceux-ci et donné les ordres nécessaires pour que l’incident n’ait pas de suites.
Voici d’ailleurs, dans tous ses détails, le récit de ce qui s’est passé avant-hier soir à l’Hôtel-Dieu :
Vers sept heures et demie, plusieurs étudiants assistaient d’une fenêtre de l’hôpital aux phases de la bagarre, lorsqu’ils virent dans la cour de la caserne de la Cité, – que leur fenêtre dominait, – les agents se précipiter en masse sur un prisonnier que l’on amenait et le frapper à qui mieux mieux. Le malheureux, tombé sous les coups de poing, était littéralement piétiné à coups de bottes. Justement indignés par ce spectacle, deux des internes, MM. Saget et Couturieux, s’écrièrent en s’adressant aux agents : « Que faites-vous là, malheureux ? C’est une infamie ! arrêtez ! nous sommes témoins! »
Pour toute réponse, un monsieur en bourgeois, qui paraissait donner des ordres dans la cour de la caserne, cria, aux internes en leur montrant le poing : « Fermez la fenêtre et cachez-vous, ou je vous fais tirer dessus !»
Les internes se retirèrent. Mais les agents ne devaient pas tarder, comme on va le voir, à se venger de l’indiscrétion des internes.
A neuf heures, tandis qu’un escadron de cuirassiers passait sur le parvis Notre-Dame et que des escouades d’agents sortaient de la caserne de la Cité pour se rendre au quartier Latin, la foule assez nombreuse massée contre les murs de l’Hôtel-Dieu fît- entendre quelques sifflets. Aussitôt, une charge d’agents fut ordonnée pour balayer le parvis.
A ce moment, la grande porte de l’Hôtel-Dieu était ouverte pour permettre l’accès plus facile aux blessés qu’on amenait de minute en minute. Devant cette porte, les internes, en tenue de travail, et quelques infirmiers prenaient l’air après leur dîner. Certes, les agents ne pouvaient avoir aucune raison de prendre ce petit groupe pour un groupe de manifestants. Sur les six internes présents, un seul était de garde et les autres étaient restés volontairement à l’Hôtel-Dieu, sachant bien que leur camarade ne pourrait faire face au surcroît de travail amené par les bagarres du quartier Latin. Loin de prendre parti pour les manifestants ou pour la police, ces jeunes gens n’étaient là que par dévouement, par esprit d’humanité. Et les agents le savaient mieux peut-être que d’autres, car ils ne pouvaient ignorer avec quelle sollicitude les jeunes médecins avaient soigné leurs camarades blessés.
Les agents, disons-nous, chargeaient la foule sur le parvis. Derrière eux, les excitant de la voix, un homme en redingote, ceint de l’écharpe tricolore, M. Dhers, commissaire de police, donnait les signes de l’exaltation la plus grande.
En apercevant, sur le seuil de l’Hôtel-Dieu, les internes et les infirmiers, M. Dhers se précipita vers eux, suivi d’agents en bourgeois et de gardiens en tenue : «Tenez, dit-il à ses hommes, les voilà ceux qui ont sifflé, ce sont les internes, arrêtez-les tous, tous ! »
Les agents se ruèrent. En vain les infirmiers tentèrent de leur barrer le chemin. Commissaire et agents forcent la porte de l’hôpital et une bagarre s’engage dans le vestibule, dans la première cour et jusque dans la salle de garde. Les coups pleuvent sur les internes, et comme l’un d’eux, M. Diriart, proteste avec énergie contre l’envahissement de l’Hôtel-Dieu, M. Dhers, dont l’exaltation va croissant, le désigne plus particulièrement à deux agents qui se précipitent sur le jeune homme et l’empoignent au collet.
Le commissaire de police, hors de lui, va comme un fou d’un groupe à l’autre en criant: « Qui a sifflé ? »
– C’est celui-là, je le reconnais, répond un inspecteur en bourgeois, en désignant un interne, M. Marie.
« Emmenez-le aussi ; emmenez-les tous ! » hurle M. Dhers.
Mais, aux cris des internes, au bruit de la bagarre, tout le personnel des infirmiers est descendu.
On refuse de laisser entraîner les internes ; la porte est fermée et gardée.
Les agents engagent une nouvelle lutte au cours de laquelle un interne en pharmacie, M. Couturieux, tombe à terre, frappé d’un formidable coup de poing derrière la tête. Le concierge de l’hôpital, saisi à la gorge, est à moitié étranglé et plusieurs infirmiers se trouvent dans la nécessité de fuir devant des agents qui ont dégainé.Attiré par tout ce tapage, M. Joret, directeur de l’Hôtel-Dieu, paraît à son tour dans le vestibule. C’est une victime de plus. Les agents commencent à le malmener, lorsque des coups répétés ébranlent la porte d’entrée : « Ouvrez ! crie une voix, je suis le préfet de police ! » C’est en effet M. Lozé. On lui ouvre.
Le préfet de police pénètre avec les internes et le haut personnel de l’hôpital dans la salle de garde. Un journal du soir a dit que l’explication qui avait suivi, entre les internes et M. Lozé, avait été conciliante. C’est là une erreur. Les internes et cela se comprend étaient dans un état de vive surexcitation. Les poings tendus vers le préfet de police très décontenancé , ils lui criaient : « Monsieur! c’est un crime qui vient d’être commis là ; vous avez violé un hôpital. C’est la première fois qu’un acte aussi abominable s’accomplit et vous en porterez la responsabilité. »
M. Lozé a parlé d’un « malentendu regrettable », exprimant avec un visible embarras tous les regrets qu’il éprouvait en face de l’inqualifiable invasion de ses subordonnés.
Et comme le préfet de police cherchait une excuse pour M. Dhers dans le fait que plusieurs internes auraient sifflé, d’une fenêtre de l’Hôtel-Dieu, à l’angle de la rue de la Cité et du parvis, lors du passage d’un escadron de cuirassiers, l’un des internes mis en cause, le propriétaire de la chambre ainsi désignée, a protesté avec indignation : « Je donne ma parole d’honneur, a-t-il dit, que ni mes camarades ni moi n’avons sifflé l’armée. Comment peut-on nous accuser d’un acte pareil, nous qui avons l’honneur de porter l’uniforme des officiers français ! »
M. Lozé n’avait pas à insister davantage. Il donna immédiatement à M. Dhers et à ses agents l’ordre de se retirer et regagna la Préfecture avec M. Gaillot, chef de la police municipale, qui l’avait accompagné jusqu’à l’Hôtel-Dieu.
Mais les internes n’en avaient pas fini avec les agents. Vers dix heures, tandis que la plupart d’entre eux étaient occupés à soigner les blessés qui leur arrivaient en grand nombre, deux de leurs camarades, MM. Landowski et Soudrille, étaient appelés, avec le directeur de l’hôpital, à la caserne de la Cité, pour donner les premiers soins à un brigadier frappé d’un coup de couteau. Devant la porte de la caserne, une double haie de gardiens, les reconnaissant à leur tenue de travail, les insultent et les menacent. Un mauvais parti leur aurait été fait s’ils ne s’étaient empressés de dire : « Nous venons donner nos soins à l’un des vôtres. » Là, il fut donné à ces internes, une fois leur pansement terminé, d’assister à une scène odieuse de « passage à tabac » : trente ou quarante agents se précipitant à coups de pied et à coups de poing sur un jeune homme, presque un enfant, qu’on venait d’arrêter. […]
« Lendemain d’émeutes » Le Figaro, 6 juillet 1893, page 1 extrait
Extrait n° 3 : le député Camille Dreyfus interpelle Charles Dupuy à la Chambre des députés sur les violences policières commises à l’Hôtel Dieu
Les faits auxquels ont donné lieu ces manifestations, je ne veux en retenir que quelques-uns. Ils ont, comme attestation, non pas des racontars de journaux, mais la signature rendue publique d’hommes qui comptent dans la science contemporaine.
Ces faits, ils sont inouïs ; ils étaient inconnus jusqu’ici dans l’histoire de nos troubles civils. C’est d’abord l’envahissement des hôpitaux, de l’Hôtel-Dieu ! (Applaudissements à l’extrême gauche et sur divers bancs à droite.)
M. Bourgeois (Vendée). C’est abominable!
M. de Baudry d’Asson. C’est un scandale !
M. Camille Dreyfus. Messieurs, aux jours les plus douloureux, en juin 1848, en mai 1871, quand la répression sévissait dans les rues de Paris, il y avait un asile devant lequel on s’arrêtait, c’était l’hôpital, dans lequel gisaient les blessés qui avaient combattu d’un côté et de l’autre de la barricade et qui, arrivés là, oubliaient la lutte du dehors. Or, ceux qui ont violé l’hôpital ce ne sont pas les insurgés, ce sont vos agents, monsieur le ministre de l’intérieur ! (Applaudissements à gauche.)
Ceux qui ont violé l’asile des blessés, ce sont les agents de la force publique, qui auraient dû, les premiers, le défendre contre l’invasion de l’émeute !Ces faits n’ont pas pu ne pas vous émouvoir ; ils ont été au fond de votre conscience, et ils ont dû vous inspirer de douloureuses réflexions sur les incidents de ces derniers jours.
Je ne veux pas porter tous les documents à la tribune ; je ne veux pas vous lire une protestation dès internes, médecins et chirurgiens de l’Hôtel-Dieu. Mais, messieurs, un de leurs maîtres, des hommes éminents parmi ceux dont les noms comptent dans la science contemporaine, M. le professeur Germain Sée et M. le professeur Villejean, ont protesté énergiquement et ont déclaré que depuis quarante ans, qu’ils exercent la médecine, qu’ils professent dans les hôpitaux, jamais pareil fait ne s’était produit, jamais pareil attentat contre les malades ne s’était exercé, et, circonstance aggravante, non pas par l’émeute, mais par les agents de la force publique.
Ajouterai-je à cette protestation celle des internes de la Charité, qui déclarent que, sous leurs yeux, le 4 juillet, dans la rue Jacob, on a chargé une foule inoffensive, qu’un officier de paix a donné à ses agents l’ordre de mettre sabre au clair, de charger la foule, les femmes et les enfants, sur ce point de Paris qui est un des quartiers les plus tranquilles, un des quartiers qui ne sont pas occupés par des républicains puisque ses représentants siègent à la droite du conseil municipal. Ce n’est donc pas dans ce quartier qu’on peut trouver des pépinières de révolutionnaires et d’émeutiers professionnels : c’est cependant dans ce quartier que la police a exercé ses sévices sur des femmes et des enfants.
Et ce ne sont pas des racontars de journaux, des récits de reporters, des exagérations de journalistes : ces faits abominables sont certifiés sous la signature, sous l’affirmation de ces jeunes gens qui occupent dans nos hôpitaux les premières places et qui seront un jour les maîtres de notre science médicale. (Très bien! très bien ! à gauche.) Puis, ce sont de simples passants, un officier de l’armée active qui ont été roués de coups, et comme, quand la police s’en mêle, le comique se joint souvent au tragique, il n’y a pas jusqu’aux commissaires de police eux-mêmes qui n’aient été frappés par leurs propres agents !
Ces faits montrent à quel degré d’exaspération, de brutalité on est arrivé. Je sais fort bien à quelle besogne difficile sont parfois exposés les agents de la force publique ; je me rends très bien compte que lorsqu’ils se trouvent en présence de certaines provocations populaires, il se produit une excitation à laquelle il leur est difficile de résister. Mais j’ai le droit de demander que les chefs, les hommes intelligents qui mènent ces soldats fassent preuve de sang-froid, et je les invite à imiter la conduite de cet officier de paix du septième arrondissement qui, alors que les portes de la Chambre étaient envahies par la foule, s’est interposé entre les agents et la foule et a ainsi évité un conflit qui pouvait être dangereux et qui eût été, dans tous les cas, regrettable devant les portes du Palais Bourbon.
Ce que cet officier de paix a fait, ses collègues ne l’ont même pas tenté ; ils ont excité leurs agents contre la foule et ils se sont rendus largement responsables des violences qui ont été commises.
Puis, après ces faits, au moment où l’émotion qu’ils avaient créée commençait à se calmer, au moment où, pour employer l’expression de M. le président du conseil, l’opération était presque terminée.
M. Pajot. L’opération césarienne !
M. Camille Dreyfus … par je ne sais quelle aberration, par je ne sais quel besoin d’agitation qui ne semble pas le fait d’un gouvernement, on a fait naître d’autres incidents. Ils étaient calmés au quartier latin ; on les a rouverts. […]
Chambre des députés, séance du 8 juillet 1893, extrait