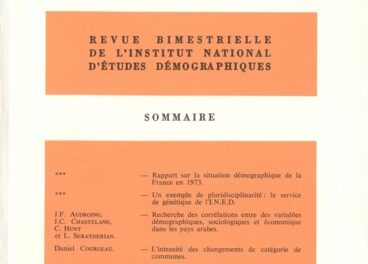La monarchie absolue : une construction
Le serment à Charlemagne
« Serment par lequel je promets d’être fidèle à monseigneur Charles, le très pieux empereur, fils du roi Pépin et de Berthe, comme un vassal par droit doit l’être à son seigneur, pour le maintien de son royaume et son droit. Et je garderai et je veux garder ce serment que j’ai juré, dans la mesure où je sais et comprends, dorénavant à partir d’aujourd’hui, si m’aident Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et ces reliques des saints.»
Les premiers agents royaux : les baillis de Philippe-Auguste (1190)
« Nous décidons que nos baillis fixeront dans leurs bailliages, chaque mois, un jour qui sera appelé le jour des assises. Là, tous ceux qui auront une plainte à formuler recevront du bailli droit et justice sans délai.
En outre, nous voulons et prescrivons que notre mère très chère, la reine Adèle, d’accord avec notre oncle très cher et fidèle, Guillaume, archevêque de Reims, fixe tous les quatre mois un jour où, à Paris, ils écouteront les plaintes des hommes de notre royaume et y donneront solution selon l’honneur de Dieu et l’intérêt du royaume De plus, nous prescrivons qu’en ce jour d’audience viennent aussi devant eux de chacune de nos villes les baillis qui tiendront assises, afin d’exposer, en leur présence, les affaires de notre domaine.
Mais si l’un de nos baillis a commis une faute, qui ne soit ni meurtre, ni rapt, ni homicide, ni trahison, et que le fait soit reconnu par l’Archevêque, par la Reine et par les gens présents à l’audience des plaintes contre les forfaits de nos baillis, nous prescrivons que la chose nous soit signalée par lettre, trois fois chaque année, aux jours susdits ‘ l’on nous fera connaître le nom du bailli coupable, ce qu’il aura fait, ce qu’il aura reçu, et de qui, soit en argent, soit en cadeau, soit en service, à l’occasion de quoi nos hommes auraient perdu leur droit et nous le nôtre.»
—-
Vers l’absolutisme
Un ambassadeur de Venise explique, au début du XVIe siècle, comment le roi de France est considéré par ses sujets.
« Habitués depuis si longtemps à être gouvernés par leurs rois, les Français ne désirent pas d’autre gouvernement; ils savent que leur condition est d’obéir et de servir leur roi, et ils servent volontiers celui qui est né exprès pour les commander, celui qui pour parvenir au trône n’a dû user ni de ruse ni de violence. Ce qui augmente leur dévouement, c’est leur utilité personnelle. Le roi est le distributeur d’un nombre infini de places, de dignités, de charges, de biens ecclésiastiques, d’appointements et de présents et d’autres émoluments et honneurs dont ce pays abonde plus que tout autre. Le roi étant aimé et servi de la sorte, il a sur tout son royaume une entière et suprême autorité : tout dépend de lui seul, la paix et la guerre, les impôts, le gouvernement et l’administration de tout le royaume. Bref, le roi est le maître absolu : nul conseil, nul magistrat ne peut limiter son pouvoir; nul prince, nul seigneur n’oserait lui résister, ainsi qu’il arrive en d’autres pays […] Le roi a bien plus de part qu’il en avait auparavant à la distribution des dignités ecclésiastiques; il nomme à 10 archevêchés, à 83 évêchés, à 527 abbayes et à un nombre infini de prieurés et de canonicats. Ce droit lui assure l’obéissance et la fidélité du clergé […]
Le roi donnait autrefois les charges [offices] de judicature. Maintenant on les vend à vie, au prix de 3 à 30000 francs chacune. Puisque le marché est ouvert, il n’y a rien d’honteux à les vendre aussi cher que possible. »
Notice bibliographique : Rapport de l’ambassadeur de Venise Michel Suriano en France, en 1561, Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au XVIe siècle, Recueillies et traduites par P.N. Tommaseo, Tome 1, Imprimerie royale, Paris, 1838, p. 511 ; dans J. Dupâquier et M. Lachiver, Les Temps modernes, 4e, Bordas, Paris, 1970, p. 71.
Notice biographique de l’auteur du texte : Michel Suriano fut ambassadeur vénitien en France. Il décrivit comment la France était gouvernée par ses rois depuis Louis XI, la grandeur et la puissance de certains et le manque de compétences d’autres, comme Charles IX, roi qui était sur le trône lors de son voyage.
Autre citation du même
Le pouvoir royal vu par un ambassadeur vénitien (1546)
« Quant à l’autorité de celui qui gouverne, je vous dirai que ce royaume si grand si peuplé, à abondant en commodités et en richesses dépend uniquement de la volonté suprême du roi, qui est aimé et servi par son peuple et qui possède une autorité absolue. Le roi de France est prince par droit naturel, puisque cette forme de gouvernement dure dans ce pays depuis mille ans. Il ne succède pas à la couronne par l’élection des peuples, aussi n’est-il pas forcé de briguer leur faveur. Il n’y arrive pas non plus par la force, ce qui le dispense d’être cruel et tyran. La succession royale est dévolue selon les lois de la nature du père au fils aîné, ou bien au plus proche parent à l’exclusion des enfants naturels ainsi que des femmes. Le royaume ne se divise pas et appartient à un seul…
Tout cela sert de fondement à l’amour et à l’obéissance des Français pour leurs rois. Habitués depuis si longtemps à être gouvernés par eux, ils ne désirent pas d’autre gouvernement, ils savent que leur condition est d’obéir et de servir leur roi, et ils servent volontiers celui qui est né exprès pour les commander, celui qui pour pouvoir parvenir au trône n’a dû user ni de ruse ni de violence. »
—-
L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539)
Les ordonnances étaient des règlements promulgués par les rois pour l’ensemble du territoire. Voici quelques articles de l’une des plus importantes :
« ARTICLE 50 : Des sépultures des personnes tenant bénéfices, sera fait registre qui fera foi pour la preuve du temps de la mort, duquel temps sera fait expresse mention ès dits registres.
ARTICLE 51 : Aussi sera fait registre en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de la nativité, et par l’extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité, et fera pleine foi à cette fin.
ARTICLE 111 : Et pour ce que des doutes sont souvent advenus sur l’intelligence des mots latins contenus auxdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous les arrêts, ensemble toutes les autres procédures, registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement…»
Dans Jacques Dupâquier et Marcel Lachiver, op. cit., p. 70.
Ibid., citation adaptée
« Article 50 – Les sépultures doivent être enregistrées par les prêtres qui doivent mentionner la date du décès.
Article 51 – Aussi sera fait registre, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de la nativité, et par l’extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité, et fera pleine foi à cette fin.
Article 52 – Et afin qu’il n’y ait faute aux dits registres, il est ordonné qu’ils seront signés d’un notaire […]
Article 111 – Nous voulons que désormais tous les arrêts soient prononcés, enregistrés et délivrés en langage maternel français et non autrement…»
Ibid., citation originale
« Article 110 : Afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence des arrêts de nos cours souveraines, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ni lieu à demander interprétation.
Article 111 : Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus aux dits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement…»
—-
Au début du XVIe, Machiavel avance une explication de la puissance des rois de France
« La Couronne, étant héréditaire par droit du sang, s’est enrichie ; car chaque fois qu’un roi meurt sans enfant mâle ou sans aucun parent qui puisse lui succéder dans son patrimoine, ses biens et propriétés sont réunis à la couronne.
Il y a une autre raison, très forte, de la grandeur du roi : le royaume se trouvait autrefois partagé entre de puissants barons qui n’hésitaient pas à engager des guerres contre leur suzerain. Mais ils sont tous aujourd’hui parfaitement soumis à son autorité, qui s’est trouvée renforcée.
Il y a encore une autre raison : les barons les plus riches et les plus puissants sont de sang royal et de même lignée, en sorte que les héritiers les plus proches venant à manquer, la couronne peut leur échoir. Dès lors, chacun soutient le trône, dans l’espoir que lui-même ou l’un de ses enfants pourra y monter un jour, et dans la crainte qu’un geste de rébellion ou d’inimitié ne leur fasse du tort. »
Dans J. Meyer, La France moderne, Fayard, 1985.
Sur Cliotexte, il y a d’autres extraits de Machiavel .
—-
La tyrannie ( 1548 publié en 1574)
« Celui qui vous méprise tant, n’a que deux yeux, n’a que deux mains, n’a qu’un corps, et n’a autre chose que ce qu’a le moindre homme du grand nombre infini de vos villes ; sinon qu’il a plus que vous tous l’avantage que vous lui faites, pour vous détruire […] Vous semez vos fruits, afin qu’il en fasse le dégât. Vous meublez et remplissez vos maisons pour fournir à ses voleries, vous nourrissez vos filles, afin qu’il ait de quoi saouler sa luxure ; vous nourrissez vos enfants, afin qu’il les mène pour le mieux qu’il leur fasse, en ses guerres ; qu’il les mène à la boucherie; qu’il les fasse les ministres de ses convoitises et les exécuteurs de ses vengeances, vous rompez à la peine vos personnes, afin qu’il se puisse mignarder en ses délices et se vautrer dans les sales et vilains plaisirs. Vous vous affaiblissez, afin de le faire plus fort et roide, à vous tenir plus courte la bride ; et de tant d’indignités, que les bêtes mêmes, ou ne sentiraient point, ou n’endureraient point, vous pouvez vous en délivrer, si vous essayez, non pas de vous en délivrer, mais seulement de le vouloir faire. Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres.»
Dans La Boëtie, Discours de la servitude volontaire ou Contr’Un, 1548.
Théodore de Bèze contre l’autorité absolue du prince
Orthographe originale
« Je di donc que les peuples ne sont point issus des magistrats, ains [mais] que les peuples auxquels il a pleu de se laisser gouverner ou par un prince ou par quelques seigneurs choisis, sont plus anciens que leurs magistrats [princes, seigneurs etc.], et par conséquent que les peuples ne sont pas créez pour les magistrats, mais au contraire les magistrats pour les peuples; comme le tuteur est pour le pupille et non le pupille pour le tuteur, et le berger pour le troupeau et non le troupeau pour le berger. »
Théodore de Bèze, Du droit des magistrats sur leurs sujets, 1574.
—-
L’autorité royale (1576)
« La souveraineté n’est limitée ni en puissance, ni en charge, ni à certain temps. Il faut que ceux-là qui sont souverains ne soient aucunement sujets aux commandements d’autrui, et qu’ils puissent donner loi aux sujets, et casser ou anéantir les lois inutiles pour en faire d’autres : ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois, ou à ceux qui ont commandement sur lui. C’est pourquoi la loi dit que le prince est délié de la puissance des lois. »
D’après Jean Bodin, Les Six livres de la République, 1576.
—-
Les principes de l’absolutisme
La manière de gouverner d’Henri IV se révèle dans cette réprimande au Parlement de Paris qui, en 1599, refuse encore d’enregistrer l’édit de Nantes.
« Vous me devez obéir quand il n’y aurait considération que de ma qualité et obligation que m’ont mes sujets et particulièrement vous de mon Parlement. Si l’obéissance était due à mes prédécesseurs, il m’est dû autant ou plus de dévotion, parce que j’ai rétabli l’État, Dieu m’ayant choisi pour me mettre au royaume, qui est mien par héritage et acquisition. Les gens de mon Parlement ne seraient en leurs sièges sans moi. Je couperai la racine à toutes factions et à toutes les prédications séditieuses faisant accourcir tous ceux qui les suscitent. J’ai sauté sur des murailles de villes, je sauterai bien sur des barricades.
A la vérité les gens de justice sont mon bras droit, mais si la gangrène se met au bras droit il faut que le gauche le coupe. Quand mes régiments ne me servent pas, je les casse. Que gagnerez-vous quand vous ne me vérifiez pas mon dit édit ? »
Henri IV, Lettres missives.
—-
Deux extraits du fameux Édit de Nantes (1598)
1)
« Et pour l’assurance que Sa Majesté [Henri IV] a de leur fidélité et sincère affection à son service, avec plusieurs autres considérations importantes au bien et au repos de cet État, Sadite Majesté […] leur a accordé [à ses sujets de la religion prétendue réformée] et promis que toutes les places, villes et châteaux qu’ils tenaient jusqu’à la fin du mois d’août dernier dans lesquelles il y aura garnisons, par l’état qui en sera dressé et signé par Sa Majesté, demeureront en leur garde sous l’autorité et obéissance de Sadite Majesté par l’espace de huit ans, à compter du jour de la publication dudit Édit. Et pour les autres qu’ils tiennent où il n’y aura point de garnisons, n’y sera point changé ni innové […]
Et pour l’entretien des garnisons qui devront être entretenues dans ces villes, places et châteaux, Sa Majesté leur a accordé jusqu’à la somme de cent quatre-vingt mille écus […]
Et s’il arrive vacation de gouverneurs et capitaines desdites places, Sadite Majesté leur promet aussi et accorde qu’elle n’en fournira aucun qui ne soit de ladite religion prétendue réformée et qu’il n’ait attestation […] qu’il soit de ladite religion, et homme de bien […] »
2)
« [Sa Majesté Henri IV] déclare que son intention est […] de gratifier ceux de ladite religion [réformée] et leur faire part des charges, gouvernements et autres honneurs qu’elle aura à distribuer […] indifféremment et sans aucune exception selon la qualité et mérite des personnes, comme à ses autres sujets catholiques […]
Ceux de ladite religion ont supplié Sa Majesté de leur vouloir faire entendre ce qu’il lui a plu d’ordonner pour l’exercice de celle-ci en la ville de Metz, d’autant que cela n’est assez donné clairement à entendre et compris en son Édit et Articles secrets, Sa Majesté déclare […] qu’il leur sera donné un lieu commode dans l’enclos de la ville où ils pourront faire ledit exercice public sans qu’il soit nécessaire de l’exprimer par son édit. Accorde aussi Sa Majesté que, en dépit de la défense faite de l’exercice de ladite religion à la Cour […], les ducs, pairs de France, officiers de la couronne, marquis, comtes, gouverneurs et lieutenants généraux, maréchaux de camp et capitaines de gardes de Sadite Majesté qui seront à sa suite ne seront recherchés de ce qu’ils feront à leur logis, pourvu que ce soit en leur famille particulière tant seulement à portes closes et sans prier à haute voix, ni rien faire qui puisse donner à connaître que ce soit exercice public de ladite religion. »
Les deux textes sont inspirés du second brevet de l’Édit de Nantes (1598), cf.
http://palissy.humana.univ-nantes.fr/CETE/TXT/EDN/Intro.html
La vénalité et l’hérédité des offices.
« La plupart des malheurs qui affligent maintenant tout le corps de l’État n’ont pris leur origine que de cette vénalité générale des offices, sans qu’aucun en soit exempté. C’est d’elle qu’est venue Ici cherté de la justice, la longueur des procès, la multitude des officiers… Mais ce qui a comblé la mesure de tous ces désastres, c’est l’invention du droit annuel qui a ôté au roi le choix des magistrats qui devraient entièrement dépendre de son autorité. »
Dans C. Lebret, Œuvres, c. 1630.
Richelieu et le redressement de l’autorité royale
V.M. = Votre Majesté (Louis XIII)
Conseils = réunions des ministres avec le roi
Huguenots = Protestants
« Lorsque V. M. se résolut de me donner en même temps et l’entrée de ses Conseils, et grande part en sa confiance pour la direction de ses affaires, je puis dire avec vérité que les Huguenots partageaient l’État avec Elle, que les Grands se conduisaient comme s’ils n’eussent pas été ses sujets, et les plus puissants Gouverneurs des Provinces, comme s’ils eussent été souverains en leurs charges […]
Je puis dire que chacun mesurait son mérite par son audace, qu’au lieu d’estimer les bienfaits qu’ils recevaient de V. M. par leur propre prix, ils n’en faisaient cas qu’autant qu’ils étaient proportionnés au dérèglement de leur fantaisie, et que les plus entreprenants étaient les plus estimés et les plus sages, et se trouvaient souvent les plus heureux […]
Nonobstant toutes les difficultés, que je présentai à V. M., connaissant ce que peuvent les Rois lorsqu’ils usent bien de leur puissance, j’osai vous promettre, sans témérité à mon avis, que vous trouveriez remède au désordre de votre État, et que votre prudence, votre force, et la bénédiction de Dieu donneraient dans peu de temps une nouvelle face à ce Royaume.
Je lui promis d’employer toute mon industrie et toute l’autorité qu’il lui plaisait me donner pour ruiner le parti huguenot, rabaisser les grands, réduire tous ses sujets en leur devoir, et relever son nom dans les nations étrangères au point où il devait être. »
Cardinal de Richelieu, Testament politique (peu avant 1642).
« Il faut considérer la noblesse comme un des principaux nerfs de l’État, capable de contribuer beaucoup à sa conservation et à son établissement. Elle a été depuis quelque temps si rabaissée par le grand nombre des officiers, que le malheur du siècle a levé à son préjudice, qu’elle a grand besoin d’être soutenue contre les entreprises de telles gens. L’opulence et l’orgueil des uns accablent la nécessité des autres, qui ne sont riches qu’en courage, ce qui les porte à employer librement leur vie pour l’État dont les officiers tirent la substance…
La noblesse ayant témoigné en la guerre heureusement terminée par la paix qu’elle était héritière de la vertu de ses ancêtres, ce qui donna lieu à César de la préférer à toute autre, il est besoin de la discipliner en sorte qu’elle puisse acquérir de nouveau et conserver sa première réputation et que l’État en soit utilement servi.
Comme les gentilshommes méritent d’être bien traités lorsqu’ils font du bien, il faut leur être sévère s’ils manquent à ce à quoi leur naissance les oblige, et je ne fais aucune difficulté de dire que ceux qui, dégénérant de la vertu de leurs aïeux, manquent de servir la couronne de leurs épées et de leurs vies avec la constance et la fermeté que les lois de l’État requièrent, mériteraient d’être privés des avantages de leur naissance, et réduits à porter une partie du faix du peuple. »
Cardinal de Richelieu, Testament politique (peu avant 1642).
« La puissance étant une des choses la plus nécessaire à la grandeur des Rois et au bonheur de leur gouvernement, ceux qui ont la principale conduite d’un État sont obligés particulièrement de ne rien omettre qui puisse contribuer à rendre leur Maître si autorisé, qu’il soit, par ce moyen, considéré de tout le monde […]
Le prince doit être puissant par sa réputation, par un raisonnable nombre de gens de guerre continuellement entretenu, par un revenu suffisant pour le soutien de ses dépenses ordinaires et par une notable somme de deniers dans ses coffres pour subvenir à celles qui arrivent souvent, lorsqu’on y pense le moins, enfin, par la possession du cœur de ses sujets, comme nous le prouverons clairement […]
La réputation est d’autant plus nécessaire à un prince que celui duquel on a bonne opinion fait plus avec son seul nom que ceux qui ne sont pas estimés avec des armées.
Ils sont obligés d’en faire plus d’état que de leur propre vie et ils doivent plutôt hasarder leur fortune et leur grandeur que de souffrir qu’on y fasse aucune brèche, étant certain que le premier affaiblissement, qui arrive à la réputation d’un prince, est, pour léger qu’il soit, le pas de plus dangereuse conséquence qu’il puisse faire à sa ruine.
Je dis hardiment, en cette considération, que les princes ne doivent jamais estimer qu’aucun profit [ne] leur soit avantageux, s’ils intéressent tant soit peu leur honneur. Ils sont aveuglés ou insensibles à leurs vrais intérêts, s’ils en reçoivent de cette nature. En effet, l’histoire nous apprend qu’en tout temps et dans tous les États, les princes de grande réputation ont toujours plus fait que ceux qui, cédant en cette qualité, les ont surpassés en force, en richesse et en toute autre puissance […] »
Cardinal de Richelieu, Testament politique (peu avant 1642).
Richelieu expose ses principes de gouvernement
« Être rigoureux envers les particuliers qui font gloire de mépriser les lois et ordonnances d’un État, c’est être bon pour le public et on ne saurait faire un plus grand crime contre les intérêts publics qu’en se rendant indulgent envers ceux qui les violent. L’indulgence pratiquée jusqu’à présent en ce royaume l’a souvent mis en de très grandes et déplorables extrémités. En matière de crime d’État, il faut fermer la porte à la pitié. »
Cardinal de Richelieu, Testament politique (peu avant 1642).
Mazarin présente les intérêts de la France
« Je vous avais promis, Messieurs, de vous expliquer les raisons pour lesquelles nous pourrions retirer nos armes de Catalogne, pourvu que le roi d’Espagne nous cédât les Pays-Bas et la Franche-Comté, soit en faveur d’un mariage, ou par un échange.
L’acquisition des Pays-Bas serait pour Paris une protection invincible et la ville serait alors véritablement ce qu’on pourrait appeler le cœur de la France car elle serait placée dans l’endroit le plus sûr du royaume. Les frontières de notre pays seraient étendues jusqu’à la Hollande, et du côté de l’Allemagne, jusqu’au Rhin par la possession de la Lorraine et de l’Alsace, et par celle de la Franche-Comté. La puissance de la France se rendrait redoutable à tous ses voisins et particulièrement aux Anglais. »
D’après Mazarin, Mémoires aux plénipotentiaires français à Münster, 20 janvier 1646, dans Histoire-géographie, 4e, Nathan, 2006.
La domestication de la noblesse vue par Bernis
« On fait honneur au cardinal de Richelieu d’avoir attiré les seigneurs à la cour, et de leur avoir ôté un pouvoir dont ils avaient (il faut en convenir) souvent abusé. Il n’est pas vrai que le cardinal de Richelieu ait rendu au Roi l’autorité que les grands seigneurs s’étaient arrogée ; c’est Henri IV qui avait commencé et presque achevé ce grand ouvrage […]
On vit après la mort de Louis XIII, qui ne survécut guère à son ministre, que les grands seigneurs n’avaient point plié sous l’obéissance : c’est Henri IV qui a commencé cet ouvrage, c’est Louis XIV qui l’a fini. Au reste, je ne sais si d’avoir attiré les grands seigneurs à la cour est vraiment un si grand bien pour le Roi et pour le royaume : le revenu des terres, qui devrait circuler dans les provinces, vient se perdre dans le gouffre de la capitale ; la multiplication des courtisans multiplie aussi les intrigues, embarrasse et fatigue les ministres, et multiplie aux dépens du trésor royal, et par conséquent du peuple, les inobéissances, les exemptions de toute espèce, les grades, les distinctions et les grâces. »
Mémoires du cardinal de Bernis, Paris, Mercure de France, 1986, 2000, p. 143-145.
Louis XIV et l’avènement de l’absolutisme

« Que j’avais auprès de ma personne des serviteurs fort capables et d’une entière fidélité. Que c’était à moi de distinguer à quoi chacun d’eux est propre, pour les employer selon leurs talents.
Que je devais bien prendre garde que chacun soit bien persuadé que je suis le maître ; qu’on ne doit attendre les grâces que de moi seul et surtout de ne les distribuer qu’à ceux qui les méritent, par leur capacité, par leurs services, par leur attachement à ma personne.
Que je dois avoir soin que tous ceux de mon Conseil vivent en bonne intelligence entre eux, de peur que leur division ne préjudicie à mon service ; entendre leurs avis sur les occurrences ; chercher toujours le meilleur part parmi leurs différentes opinions ; prendre ma résolution de moi-même, et après cela la soutenir hautement, sans permettre qu’il soit donné la moindre atteinte à mon autorité. »
La prise du pouvoir de Louis XIV selon l’abbé de Choisy
« Le Roi donc, pour la première fois, tint le conseil avec ses trois ministres (Fouquet, Le Tellier et Lionne), Colbert n’y fut admis publiquement que longtemps après. Le conseil dura trois jours ; la Reine mère fut outrée de dépit de ce qu’on ne l’y appelait pas. Elle en parla assez haut : « Je m’en doutais bien, disait-elle, qu’il serait ingrat, et voudrait faire le capable. » La Beauvais, sa première femme de chambre, qu’elle aimait fort, et qu’elle ne nommait jamais que Catau, la reprit un peu plus aigrement qu’il ne lui convenait. Elle avait pris depuis longtemps ces sortes de familiarités avec sa maîtresse, et l’y avait accoutumée. Catau ne manquait ni d’esprit ni d’expérience ; et d’ailleurs elle avait ses raisons pour prendre le parti du Roi.
Après avoir tenu ce premier conseil avec ses trois ministres, le Roi en tint un autre le lendemain, où il fit appeler le chancelier Séguier et les secrétaires d’État, outre Fouquet, Le Tellier et Lionne. Il leur dit en maître qu’ayant perdu le cardinal Mazarin, sur qui il se reposait de tout, il avait résolu d’être à l’avenir son premier ministre, et qu’il ne voulait pas qu’aucun d’eux ne signât la moindre ordonnance, le moindre passeport, sans avoir reçu ses ordres. Chacun lui promit une obéissance entière, et pas un ne crut qu’il eût la force de faire tout ce qu’il disait : il commença néanmoins à tenir le conseil tous les jours avec les trois ministres.
Le lendemain de la mort du cardinal, l’archevêque de Rouen, qui a été depuis archevêque de Paris, vint trouver le Roi, et lui dit : « Sire, j’ai l’honneur de présider à l’assemblée du clergé de votre royaume. Votre Majesté m’avait ordonné de m’adresser à M. le cardinal pour toutes les affaires : le voilà mort ; à qui Sa Majesté veut-elle que je m’adresse à l’avenir ? – A moi M. l’archevêque, lui répondit le Roi ; et je vous expédierai bientôt. » En effet, j’ai ouï dire plusieurs fois à l’archevêque qu’il ne comprenait pas dans les commencements où le Roi avait pris toutes les connaissances qu’il avait. »
Abbé de Choisy, Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV, Paris, Mercure de France, 1966, 2000, p. 112-113.
Louis XIV a réuni ses ministres le lendemain de la mort de Mazarin (1661)
Loménie de Brienne était secrétaire d’État aux affaires étrangères.
Rôles = tâches
Conseil = réunion des ministres avec le roi
« Le Roi […] adressa la parole à M. le Chancelier : Monsieur, je vous ai fait assembler avec mes ministres et secrétaires d’ État pour vous dire que jusqu’à présent j’ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu M. le Cardinal; il est temps que je les gouverne moi-même. Vous m’aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai […]
Ensuite le Roi se tourna vers nous et nous dit : Et vous, mes secrétaires d’État, je vous défends de ne rien signer, pas une sauvegarde, pas un passeport, sans mon ordre, de me rendre compte chaque jour à moi-même et de ne favoriser personne dans vos rôles du mois […] Je ne répondis que de la tête et d’une petite inclinaison du corps. Puis le Roi ajouta : La face du théâtre change; j’aurai d’autres principes dans le gouvernement de mon État, dans la régie de mes finances et dans les négociations au dehors que n’avait feu M. Le Cardinal. Vous savez mes volontés; c’est à vous maintenant, Messieurs, à les exécuter. Plus n’en dit, et le Conseil se sépara …
Le Roi, après la mort du Cardinal, changea tout l’ordre des Conseils, ou pour mieux dire, rétablit le bon ordre, car ce n’avait été proprement que confusion sous le ministère du Cardinal … »
Loménie de Brienne, Mémoires.
La personnalité du monarque
Louis XIV est un souverain imbu de sa grandeur et de sa dignité. Il incarne parfaitement l’image que l’on se fait d’un roi, bien qu’il ne soit qu’un souverain absolu parmi d’autres.
« Une taille de héros, toute sa figure si naturellement imprégnée de la plus imposante majesté qu’elle se portait également dans les moindres gestes et dans les actions les plus communes, sans aucun air de fierté, mais de simple gravité; proportionné et fait à peindre et tel que sont les modèles que se proposent les sculpteurs; un visage parfait, avec la plus grande mine et le plus grand air qu’homme ait jamais eu. Il paraissait avec le même air de grandeur et de majesté en robe de chambre comme dans la parure des fêtes, ou à cheval à la tête de ses troupes. »
Saint-Simon, Mémoires, c. 1740-1750.
Le contrôle de la noblesse
Mémoires du duc de Saint-Simon, début XVIIIe
Équipages = suite de valets, chevaux, calèches, etc.
Nombrer = compter
« Ses ministres, ses généraux, ses courtisans s’aperçurent, bientôt après qu’il fut le maître, de son faible plutôt que de son goût pour la gloire. Ils le louèrent à l’envie et le gâtèrent. Les louanges, disons mieux, la flatterie lui plaisait à tel point, que les plus grossières étaient bien reçues, les plus basses encore mieux savourées…
Il aima en tout la splendeur, la magnificence, la profusion. Ce goût il le tourna en maxime par politique, et l’inspira en tout à sa cour. C’était lui plaire que de s’y jeter en tables, en habits, en équipages, en bâtiments, en jeu. C’était des occasions pour lui qu’il parlât aux gens. Le fond était qu’il tendait et parvint par là à épuiser tout le monde en mettant le luxe en honneur, et pour certaines parties en nécessité, et réduisit ainsi peu à peu tout le monde à dépendre entièrement de ses bienfaits pour subsister. Il y trouvait encore la satisfaction de son orgueil par une cour superbe en tout, et par une plus grande confusion …
Rien jusqu’à lui, n’a jamais approché du nombre et de la magnificence de ses équipages de chasse et de toutes ses autres sortes d’équipages. Ses bâtiments, qui les pourrait nombrer ? En même temps, qui n’en déplorera pas l’orgueil, le caprice, le mauvais goût ? »
Saint-Simon, op. cit.
Autre citation du même texte
« Le roi regardait à droite et à gauche, à son lever, à son coucher, à ses repas, en passant dans les appartements, dans les jardins de Versailles. Il y voyait et remarquait tout le monde, aucun ne lui échappait […] C’était un démérite, aux uns et à tout ce qu’il y avait de distingué, de ne pas faire de la Cour son séjour ordinaire, aux autres d’y venir rarement, et une disgrâce sûre pour qui n’y venait jamais. Quand il s’agissait de quelque chose pour eux : « Je ne le connais point », répondait-il fièrement. Sur ceux qui se présentaient rarement : « C’est un homme que je ne vois jamais ». Et ces arrêts étaient irrévocables […]
Il aima en tout la splendeur, la magnificence, la profusion. Ce goût, il le tourna en maxime par politique et l’inspira en tout à sa Cour. C’était lui plaire que de s’y jeter en tables, en habits, en équipage, en bâtiments, en jeu. C’étaient des occasions pour qu’il parlât aux gens. Le fait était qu’il tendait et parvint par là à épuiser tout le monde en mettant le luxe en honneur et réduisit ainsi peu à peu tout le monde à dépendre entièrement de ses bienfaits pour subsister. Il y trouvait encore la satisfaction de son orgueil par une Cour superbe en tout. »
Dans J.-M. Lambin (dir.), Histoire, Seconde, Hachette, 1996, p.153.
Ibid.
Le rôle politique de la Cour
« Les fêtes fréquentes, les promenades particulières à Versailles, les voyages furent des moyens que le roi saisit pour distinguer et pour mortifier en nommant les personnes qui à chaque fois en devaient être, et pour tenir chacun assidu et attentif à lui plaire […]
Non seulement il était sensible à la présence continuelle de ce qu’il y avait de distingué, mais il l’était aussi aux étages inférieurs. il regardait à droite et à gauche à son lever, à son coucher, à ses repas, en passant dans les appartements, dans ses jardins de Versailles où seulement les courtisans avaient la liberté de le suivre ; il voyait et remarquait tout le monde ; aucun ne lui échappait […]
Il distinguait très bien en lui-même les absences. C’était un démérite aux uns […], de ne faire pas de la Cour son séjour ordinaire, aux autres d’y venir rarement, et une disgrâce sûre pour qui n’y venait jamais […]
Quand il s’agissait de quelque chose pour eux: « Je ne le connais point », répondait-il fièrement ; sur ceux qui se présentaient rarement: « C’est un homme que je ne vois jamais, et ces arrêts-là étaient irrévocables. »
Duc de Saint-Simon (1675-1755), , op. cit.
Le contrôle du gouvernement
« J’eusse pu sans doute jeter les yeux sur des gens de plus haute considération. Mais les trois [ministres, dont Colbert] que je choisis me semblèrent suffisants pour exécuter sous moi les choses dont j’avais résolu de les charger.
Et, pour vous découvrir toute ma pensée, je crus qu’il n’était pas de mon intérêt de chercher des hommes d’une qualité plus éminente, parce qu’ayant besoin sur toutes choses d’établir ma propre réputation, il était important que le public connût, par le rang de ceux dont je me servais, que je n’étais pas en dessein de partager avec eux mon autorité, et qu’eux -mêmes, sachant ce qu’ils étaient, ne conçussent pas de plus hautes espérances que celles que je leur voudrais donner; précaution tellement nécessaire qu’avec cela même le monde fut encore assez longtemps sans me pouvoir bien connaître.
Beaucoup de gens se persuadaient que dans peu de temps quelqu’un de ceux qui m’approchaient s’emparerait de mon esprit et de mes affaires. La plupart considéraient l’assiduité de mon travail comme une chaleur qui devait bientôt se ralentir, et ceux qui voulaient en juger plus favorablement attendaient à se déterminer par la suite.
Mais le temps enfin leur fit voir ce qu’ils en devraient croire; car on me vit toujours marcher constamment par la même route, vouloir être informé de tout ce qui se faisait, écouter les prières et les plaintes de mes moindres sujets, savoir le nombre de mes troupes et l’état de mes places, traiter immédiatement [directement, sans intermédiaire] avec les ministres [ambassadeurs] étrangers, recevoir les dépêches, faire moi-même une partie des réponses, et donner à mes secrétaires la substance des autres; régler la recette et la dépense de mon état; me faire rendre compte à moi-même par ceux qui étaient dans les emplois les plus importants; tenir mes affaires secrètes, distribuer les grâces par mon propre choix, conserver en moi seul toute mon autorité, et tenir ceux qui me servaient le mieux dans une modestie fort éloignée de l’élévation des premiers ministres. »
Louis XIV, Mémoire pour l’Instruction du Dauphin, 1666.
Ibid, autre citation
Comment Louis XIV choisit ses collaborateurs
« Je résolus […] de ne point prendre de Premier ministre rien n’étant plus indigne que de voir d’un côté toutes les fonctions et de l’autre le seul titre de roi. Pour cela, il était nécessaire de partager ma confiance et l’exécution de mes ordres sans la donner tout entière à un seul, appliquant diverses personnes à diverses choses selon leurs divers talents […] Dans les intérêts les plus importants de l’État, et pour les affaires secrètes où le petit nombre de têtes est à désirer autant qu’autre chose […] ne voulant pas les confier à un seul ministre, les trois que je crus pouvoir y servir le plus utilement furent Le Tellier, Fouquet et Lionne (1) […] Pour découvrir toute ma pensée, il n’était pas de mon intérêt de prendre des hommes d’une qualité plus éminente. Il fallait avant toute chose établir ma propre réputation, et faire connaître au public, par le rang même d’où je les prenais, que mon intention n’était pas de partager mon autorité avec eux […] »
Louis XIV, Mémoire pour servir à l’instruction du dauphin, 1666.
(1) Secrétaire d’État, puis chancelier, Le Tellier est le père de Louvois ; Hugues de Lionne, secrétaire d’État aux Affaires étrangères ; Fouquet, surintendant des Finances.
—-
Lettres aux intendants
Colbert à M. Le Blanc, intendant de Rouen, 23 octobre 1680
« Je suis fâché que la pêche au hareng ne commence pas bien. Je vous prie de me faire savoir si elle réussira mieux vers la Toussaint, cette pêche étant d’une très grande conséquence, vu que les Hollandais en apportent une très grande quantité, par le moyen de laquelle ils tirent beaucoup d’argent du royaume. Il est bon que vous excitiez les marchands à augmenter leur pêche, et que vous vous informiez même s’ils vont sur les côtes de Yarmouth où cette pêche est plus important qu’en aucun autre lieu, et combien il y va de bateaux pêcheurs sur toutes les côtes de Normandie. »
Lettre circulaire du roi aux intendants (suite à la révocation de l’Édit de Nantes)
« Versailles, 3 mai 1686
Monsieur de M…, j’ai été informé que plusieurs nouveaux catholiques négligent d’envoyer leurs enfants aux écoles du lieu de leurs demeures, et aux instructions et catéchismes qui se font dans leurs paroisses ; en sorte qu’ils pourraient rester sans être instruits de leur religion, s’il n’y était pourvu ; ce qui m’oblige de vous écrire cette lettre, pour vous dire que mon intention est que vous fassiez savoir à mes sujets nouveaux catholiques, que je veux qu’ils envoient régulièrement leurs enfants aux écoles, et aux instructions et catéchismes qui se font dans leurs paroisses ; et en cas qu’ils y manquent, mon intention est que lesdits enfants soient mis, de l’ordonnance des juges des lieux, savoir les garçons dans les collèges et les filles dans les couvents, et que leur pension soit payée sur les biens de leurs pères et mères, et en cas qu’ils n’aient point de biens, qu’ils soient reçus dans les hôpitaux des lieux, ou les plus prochains, voulant que vous fassiez savoir à tous les juges de votre département mes intentions sur ce sujet, et que vous teniez la main à ce qu’elles soient exécutées. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait, Monsieur de M…, en sa sainte garde.
Louis. »
Une commission d’intendant signée par Louis XIV en 1653
« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à notre aimé et féal conseiller le sieur de Sarron Champigny, salut […] Nous vous commettons, ordonnons et députons par ces présentes signées de notre main, intendant de justice, police et finances en notre ville de Lyon, pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais, pour, en cette qualité, […] assister le gouverneur en ladite province de vos bons avis sur toutes affaires, […] ouïr et entendre les plaintes et doléances de nos sujets de notre dite ville et pays, leur pourvoir ou faire pourvoir par les juges ordinaires ainsi que vous verrez être nécessaire, vous enquérir soigneusement si la justice est bien sincèrement administrée à nos sujets, reconnaître si nos officiers font le devoir de leurs charges, […] vous enquérir aussi de l’ordre et état de la police et administration des affaires et deniers communs des villes et communautés […] avoir l’œil à la levée et administration de nos deniers et finances, […] vous informer de l’état de nos affaires et service en ladite province et tout ce qui concerne l’observation de nos édits, règlements et ordonnances […] Car tel est notre plaisir. »
Dans R. Frank (dir.), Histoire Seconde, Belin, 1987, p. 13.
—-
L’argent, nerf de la puissance : le mercantilisme selon Colbert
« Je crois que l’on demeurera facilement d’accord de ce principe, qu’il n’y a que l’abondance d’argent dans un État qui fasse la différence entre sa grandeur et sa puissance […] Le bon état des finances et l’augmentation des revenus de Votre Majesté consistent à augmenter par tous les moyens la quantité de monnaie qui roule continuellement dans le royaume. Trois voies permettent d’y arriver : attirer l’argent des pays d’où il vient, le conserver au-dedans du royaume, et empêcher qu’il n’en sorte […] Outre les grands avantages que produira l’entrée d’une plus grande quantité d’argent comptant dans le royaume, il est certain que, par les manufactures, un million de peuples qui languissent dans la fainéantise gagneront leur vie […] dans la navigation et sur les ports de mer. »
Jean-Baptiste Colbert, Mémoire sur le commerce, 1664 dans Colbert, Mémoire sur le commerce présenté au premier Conseil de commerce tenu par le Roy, le 3 août 1664, dans Lettres, instructions et mémoires de Colbert, vol. II, 1ère partie, 1863.
—-
Le droit divin
Louis XIV, Mémoires
« C’est à la tête seulement qu’il appartient de délibérer et de résoudre, et toutes les fonctions des autres membres ne consistent que dans l’exécution des commandements qui leur sont donnés. … Celui qui a donné des rois aux hommes (c’est-à-dire Dieu) a voulu qu’on les respectât comme ses lieutenants, se réservant à lui seul le droit d’examiner leur conduite. Sa volonté est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement … Cet assujettissement qui met le souverain dans la nécessité de prendre la loi de ses peuples est la dernière calamité où puisse tomber un homme de notre rang … Quelque mauvais que puisse être un prince, la révolte de ses sujets est toujours infiniment criminelle. »
Louis XIV, Mémoires pour servir à l’instruction du dauphin, 1666.
Autre citation du même texte
« C’est à la tête seulement qu’il appartient de délibérer et de résoudre, et toutes les fonctions des autres membres ne consistent que dans l’exécution des commandements qui leur sont donnés. Voilà pourquoi on me vit toujours vouloir être informé de tout ce qui se faisait, traiter immédiatement avec les ministres étrangers, recevoir les dépêches, faire moi-même une partie des réponses et donner à mes secrétaires la substance des autres, me faire rendre compte à moi-même par ceux qui étaient dans les emplois les plus importants, conserver en moi seul mon autorité. »
Dans J.M. Lambin (dir.), Histoire Seconde, Hachette, 1996, p. 145.
—-
La sacralité du roi
Politique tirée de l’écriture sainte, Bossuet, fin XVIIe
Bossuet : (1627-1704)
Né à Dijon, ordonné prêtre en 1652, puis évêque en 1669, il est choisi l’année suivante comme précepteur du Dauphin. Pendant onze ans (1670-1681) il se consacre avec ardeur à cette tâche, voulant initier son disciple au métier de roi. Il fut critiqué par les philosophes des Lumières pour avoir écrit un manuel d’histoire à l’intention du Dauphin, Le discours sur l’Histoire universelle (1681), dans lequel la Providence enchaîne les faits historiques pour conduire au triomphe final de Dieu et de son Église catholique (il fut un grand adversaire des protestants).
« Dieu est la sainteté même, la bonté même, la puissance même, la raison même. En ces choses est la majesté de Dieu. En l’image de ces choses est la majesté du Prince.
Elle est si grande, cette majesté qu’elle ne peut être dans le prince comme dans sa source; elle est empruntée de Dieu qui la lui donne pour le bien des peuples, à qui il est bon d’être contenus par une force supérieure.
Quelque chose de divin s’attache au prince et inspire la crainte aux peuples. Que le roi ne s’oublie pas pour cela même. Je l’ai dit, c’est Dieu qui parle; je l’ai dit: vous êtes des dieux, et vous êtes tous les enfants du Très-Haut, mais vous mourrez comme les hommes, et vous tomberez comme les grands. Je l’ai dit: vous êtes des dieux, c’est-à-dire vous avez dans votre autorité, vous portez sur votre front un caractère divin. Vous les enfants du Très-Haut: c’est lui qui a établi votre puissance pour le bien du genre humain. Mais, ô dieux de chair et de sang, ô dieux de boue et de poussière, vous mourrez comme les hommes, vous tomberez comme les grands! La grandeur sépare les hommes pour un peu de temps; une chute commune à la fin les égale tous.
O rois! Exercez donc hardiment votre puissance, car elle est divine et salutaire au genre humain; mais exercez-la avec humilité. Elle vous est appliquée par le dehors. Au fond, elle vous laisse faibles ; elle vous laisse mortels ; elle vous laisse pécheurs, et vous charge devant Dieu d’un plus grand compte. »
Le Prince, image de Dieu (ibid.)
« Dieu est infini, est tout. Le prince, en tant que prince, n’est pas regardé comme un homme particulier, c’est un personnage public; tout l’État est en lui ; la volonté de tout le peuple est renfermée dans la sienne. Comme en Dieu est réunie toute perfection et toute vertu, ainsi toute la puissance des particuliers est réunie en la personne du prince. Quelle grandeur qu’un seul homme en contienne tant ! La puissance de Dieu se fait sentir en un instant de l’extrémité du monde à l’autre : la puissance royale agit en même temps dans tout le royaume. Elle tient tout le royaume en état, comme Dieu y tient tout le monde. Que Dieu retire sa main, le monde retombera dans le néant ; que l’autorité cesse dans le royaume, tout sera en confusion. Considérez le prince dans son cabinet. De là, partent les ordres qui font aller de concert les magistrats et les capitaines, les citoyens et les soldats, les provinces et les armées par mer et par terre. C’est l’image de Dieu, qui, assis dans son trône au plus haut des cieux, fait aller toute la nature […]
Ô rois ! exercez donc hardiment votre puissance ; car elle est divine, et salutaire au genre humain ; mais exercez-la avec humilité. Elle vous est appliquée par le dehors. Au fond, elle vous laisse faibles ; elle vous laisse mortels ; elle vous laisse pécheurs, et vous charge devant Dieu d’un grand compte. »
Bossuet (1627-1704), Politique tirée des propres paroles de l’Écriture Sainte, 1709.
Autre extrait
« Ière Proposition : L’autorité royale est sacrée
Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples.[…] Les princes agissent comme ministres de Dieu, et ses lieutenants sur la terre. C’est par eux qu’il exerce son empire […] le trône royal n’est pas le trône d’un homme, mais le trône de Dieu même […]
IIe Proposition : La personne des rois est sacrée
Il paraît de tout cela que la personne des rois est sacrée et qu’attenter contre eux c’est un sacrilège. Dieu les fait oindre par ses prophètes d’une onction sacrée [lors du sacre, le roi est frotté avec une huile sainte], comme il fait oindre les pontifes [papes] et ses autels. Mais même sans l’application extérieure de cette onction, ils sont sacrés par leur charge, comme étant les représentants de la majesté divine, députés par la Providence à l’exécution de ses desseins […]
IIIe Proposition : On doit obéir au prince par principe de religion et de conscience
[…] saint Pierre dit : « Soyez donc soumis pour l’amour de Dieu à l’ordre qui est établi parmi les hommes; soyez soumis au roi comme à celui qui a la puissance suprême : et à ceux à qui il donne son autorité comme étant envoyés de lui pour la louange des bonnes actions et la punition des mauvaises »
Quant même ils ne s’acquitteroient pas de ce devoir, il faut respecter en eux leur charge et leur ministère. « Obéissez à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et modérés, mais encore à ceux qui sont fâcheux et injustes. » »
Extraits de Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, dans Œuvres complètes, t. 8, p. 357-358. Ce livre commencé en 1677, fut publié après sa mort en 1709. Bossuet fut précepteur du dauphin de 1670 à 1679.
Autre extrait du même passage
« Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples […] Les princes agissent donc comme ministres de Dieu, et ses lieutenants sur la Terre. C’est pour cela que nous avons vu que le trône royal n’est pas le trône d’un homme, mais le trône de Dieu même […] Il paraît de tout cela que la personne des rois est sacrée, et qu’attenter sur eux est un sacrilège […] On doit donc obéir au prince par principe de religion et de conscience […] Le service de Dieu et le respect pour les rois sont choses unies. Aussi Dieu a-t-il mis dans les princes quelque chose de divin. »
Cité dans R. Frank (dir.), Histoire, Seconde, Belin, 1987, p. 12.
« Vous êtes des dieux »
« Pour établir cette puissance qui représente Ici sienne, Dieu met sur le front des souverains et sur leur visage une marque de divinité, Vous êtes des dieux, dit David et vous êtes tous enfants du Très-Haut. Mais, ô dieux de chair et de sang, vous mourrez comme des hommes. N’importe, vous êtes des dieux encore que vous mouriez et votre autorité ne meurt pas, Cet esprit de royauté passe tout entier à vos successeurs. L’homme meurt, il est vrai, mais le roi ne meurt jamais, l’image de Dieu est immortelle. »
Bossuet, Sermon sur les devoirs des rois, 1662.
—-
La souveraineté selon les jésuites
L’article « Souverain » du Dictionnaire de Trévoux (édition de 1734) :
« Souverain, aine. Summus, supremus. Le premier Être, le Tout-Puissant ; qui ne voit rien au-dessus de lui […] Dieu seul a une majesté, une puissance souveraine et infinie : il est le souverain, maître de l’univers, L’Être souverain.
Souverain, à l’égard des hommes, se dit des rois ou des princes ou de ceux qui n’ont personne au-dessus d’eux ; qui sont absolus et indépendants ; qui ne relèvent que de Dieu et de leur épée […]
La puissance souveraine n’est bornée que par les lois de Dieu, les lois naturelles et les lois fondamentales de l’État. »
Dans Dictionnaire de Trévoux, t. 4, 1704-1771, p. 2145.
—-
La Fontaine, écrivain de cour, soutien de l’absolutisme
« Les membres et l’estomac
Je devais par la royauté
Avoir commencé mon ouvrage :
A la voir d’un certain côté,
Messer Gaster en est l’image ;
S’il a quelque besoin, tout le corps s’en ressent.
De travailler pour lui les Membres se lassant,
Chacun d’eux résolut de vivre en gentilhomme,
Sans rien faire, alléguant l’exemple de Gaster.
Il faudrait, disaient-ils, sans nous qu’il vécût d’air.
Nous suons, nous peinons, comme bêtes de somme ;
Et pour qui ? Pour lui seul ; nous n’en profitions pas ;
Notre soin n’aboutit qu’à fournir ses repas.
Chômons, c’est un métier qu’il veut nous faire apprendre.
Ainsi dit, ainsi fait. Les Mains cessent de prendre,
Les Bras d’agir, les Jambes de marcher :
Tous disent à Gaster qu’il en allât chercher.
Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent.
Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur ;
Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur ;
Chaque membre en souffrit ; les forces se perdirent.
Par ce moyen, les mutins virent
Que celui qu’ils croyaient oisif et paresseux,
A l’intérêt commun contribuait plus qu’eux.
Ceci peut s’appliquer à la grandeur royale.
Elle reçoit et donne, et la chose est égale.
Tout travaille pour elle, et réciproquement
Tout tire d’elle l’aliment.
Elle fait subsister l’artisan de ses peines,
Enrichit le marchand, gage le magistrat,
Maintient le laboureur, donne paie au soldat,
Distribue en cent lieux ses grâces souveraines,
Entretient seule tout l’État.
Ménénius (1) le sut bien dire.
La commune s’allait séparer du sénat.
Les mécontents disaient qu’il avait tout l’empire,
Le pouvoir, les trésors, l’honneur, la dignité ;
Au lieu que tout le mal était de leur côté,
Les tributs, les impôts, les fatigues de guerre.
Le peuple hors des murs était déjà posté,
La plupart s’en allaient chercher une autre terre,
Quand Ménénius leur fit voir
Qu’ils étaient aux Membres semblables,
Et par cet apologue, insigne entre les fables,
Les ramena dans leur devoir. »
Jean de La Fontaine, Fables, Livre III, 1668 (fable inspirée d’Ésope, L’estomac et les pieds).
(1) Il s’agit de Ménénius Agrippa (c. 493 av. J.C.) : épisode raconté par Tite-Live, Histoire romaine, II, XXXII.
© h-francais : texte donné sur la liste des Clionautes par Laurent Gayme <lgayme@club-internet.fr> le 25 septembre 2000 et reproduit avec son autorisation. Qu’il en soit remercié.
—-
Les mémoires de Valentin Jamerey-Duval, petit paysan bourguignon à la fin du règne du Roi-Soleil
« Comme j’avais entendu parler plus souvent de la puissance absolue du roi que de la grandeur et de la majesté de Dieu, je le croyais une espèce de divinité. Je m’informais même s’il était immortel, s’il était visible ou si on pouvait l’approcher […] Ayant appris que sa fonction était de rendre la justice à ses sujets, je conclus qu’il devait être d’une taille gigantesque et cela par ce que le Juge de notre village surpassait en hauteur de taille le reste des habitants. l’avais aussi remarqué que ce même juge avait la voix forte et sonore, c’en fut assez pour me figurer que, proportion gardée, celle du roi devait retentir comme le bruit du tonnerre, et que c’était ce qui le rendait si puissant et si redoutable. »
V. Jamerey-Duval, Mémoires, enfance et éducation d’un paysan au XVIIIe siècle, Paris, Le Sycomore, 1981, p. 117 dans Joël Cornette, « Louis XIV ou la religion royale », L’Histoire, n°289, juillet-août 2004, p. 30.
—-
Critiques de Fénelon
En 1694, Fénelon, observateur de la Cour et précepteur du Dauphin, adresse une lettre au roi :
« Tant de troubles affreux qui ont désolé toute l’Europe depuis plus de vingt ans, tant de sang répandu, tant de scandales commis, tant de provinces saccagées, tant de villes et de villages mis en cendres, sont les funestes suites de cette guerre de 1672, entreprise pour votre gloire […] Elle est encore la vraie source de tous les maux que la France souffre. Depuis cette guerre, vous avez toujours voulu donner la paix en maître, et imposer les conditions au lieu de les régler avec équité et modération. Voilà ce qui fait que la paix n’a pu durer […]
Cependant vos peuples, que vous devriez aimer comme vos enfants, et qui ont été jusqu’ici si passionnés pour vous, meurent de faim. La culture des terres est presque abandonnée, les villes et la campagne se dépeuplent ; tous les métiers languissent et ne nourrissent plus les ouvriers. Tout commerce est anéanti. Par conséquent vous avez détruit la moitié des forces réelles du dedans de votre État, pour faire et pour défendre de vaines conquêtes au dehors. Au lieu de tirer de l’argent de ce pauvre peuple, il faudrait lui faire l’aumône et le nourrir. La France entière n’est plus qu’un grand hôpital désolé et sans provision […]
Le peuple même (il faut tout dire), qui vous a tant aimé, qui a eu tant de confiance en vous, commence à perdre l’amitié, la confiance, et même le respect. Vos victoires et vos conquêtes ne le réjouissent plus ; il est plein d’aigreur et de désespoir […] Voilà, Sire, l’état où vous êtes. Vous vivez comme ayant un bandeau fatal sur les yeux; vous vous flattez sur les succès journaliers, qui ne décident rien, et vous n’envisagez point d’une vue générale le gros des affaires, qui tombe insensiblement sans ressource […]
Vous n ‘aimez que votre gloire et votre commodité. Vous rapportez tout à vous, comme si vous étiez le Dieu de la terre et que tout le reste n ‘eût été créé que pour vous être sacrifié. C’est, au contraire, vous que Dieu n’a mis au monde que pour votre peuple. Mais, hélas ! vous ne comprenez point ces vérités ; comment les goûteriez-vous ? Vous ne connaissez point Dieu, vous ne l’aimez point, vous ne le priez point du cour, et vous ne faites rien pour le connaître.
[…] La personne qui vous dit ces vérités, Sire, bien loin d’être contraire à vos intérêts, donnerait sa vie pour vous voir tel que Dieu vous veut, et elle ne cesse de prier pour vous.
Dans Maxime Leroy, Fénelon, Paris, 1928, p. 105-115 dans L’Histoire, n°186, mars 1995.
—-
Le Palatinat, occupé par la France doit supporter les persécutions religieuses.
Madame, belle-sœur du roi Louis XIV, est originaire du Palatinat, région d’Allemagne située au Nord de l’Alsace. Cette princesse a été obligée d’abjurer la religion protestante réformée pour épouser le frère du roi. Dans son cœur, elle n’a jamais été vraiment catholique et elle est pour la liberté de culte.
Saint-Cloud, le 21 octobre 1719,
« Les rois d’Angleterre et de Prusse ont résolu, à ce qu’on m’écrit, d’intervenir très sérieusement en faveur des réformés [du Palatinat] : les prêtres, de cette façon, n’oseront plus faire des leurs, ce dont je me réjouis du fond du cœur ; car je souhaite toute sorte de bien et de bonheur à nos bons et honnêtes compatriotes ; aux méchants prêtres qui les persécutent, je leur souhaite la potence qu’ils méritent bien pour leur fausseté, leurs tromperies… ils sont méchants et insolents, mais dès qu’on leur montre les dents, ils font patte de velours. »
Princesse Palatine, Lettres de Madame la Duchesse d’Orléans née Princesse Palatine, Paris, Mercure de France (Le temps retrouvé), 1981, 1985, p. 590.
—-
COMMISSION D’INTENDANT
Le 30 octobre 1718, le jeune Louis XV, « de l’avis de [son] très cher et très aimé oncle le duc d’Orléans régent », nomme Leclerc de Lesseville intendant de la généralité de Béarn et d’Auch. Une lettre de commission définit ses attributions.
« Louis par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre à notre amé féal conseiller en nos Conseils, maître des requêtes ordinaire de notre hôtel le sieur de Lesseville Salut, étant satisfait des services que vous nous avez rendus en qualité d’intendant de justice, police et finances en la Généralité de Limoges et désirant que vous nous les continuiez en la même qualité dans celles de Béarn et d’Auch, à la place du sieur Le Gendre aussi conseiller en nos Conseils […]
Nous vous avons commis et député, commettons et députons par ces présentes signées de notre main pour vous transporter dans lesdites généralités, avec pouvoir de vous trouver et assister aux Conseils qui seront tenus par nos Gouverneurs et nos Lieutenants en icelles pour nos plus importantes affaires, leur donner vos avis, conférer avec eux selon que le bien de notre service le requerra.
Informer de tous désordres, pratiques et menées secrètes qui se pourraient faire contre notredit service […]
Vous faire représenter les comptes de ceux qui ont eu le maniement des deniers communs […]
Décerner toutes ordonnances et même toutes contraintes nécessaires pour le recouvrement de nosdits deniers […]
Ouïr les plaintes et doléances de nos sujets.
Entrer et présider aux assemblées des villes lorsque besoin sera, même lors des élections des échevins et autres charges municipales pour y faire observer l’ordre requis […]
Informer de tous les abus qui se peuvent commettre en l’administration de la justice. »
—-
Lettres de cachet au temps de Louis XV
Contre Voltaire
« Monsieur de B. Je vous écris cette lettre de la main de mon oncle le Duc d’Orléans, Régent, pour vous dire que mon intention est que vous receviez, dans mon château de la Bastille, le Sieur Harrouët, et que vous l’y déteniez jusqu’à nouvel ordre. Je prie Dieu qu’il vous ait, Monsieur de B., dans sa sainte garde.
…écrit à Paris le 17 mai 1717.
Louis. »
—-
Contre Diderot
« Monsieur le Marquis du Châtelet, je vous fais cette lettre pour vous dire de recevoir en mon château de Vincennes le Sieur Diderot et de l’y retenir jusqu’à nouvel ordre de ma part. Je prie Dieu qu’il vous ait, Monsieur le Marquis du Châtelet, dans sa sainte garde.
…écrit à Compiègne, le 23 juillet 1749.
Louis. »
—-
Remontrances du Parlement de Paris (1718)
« En même temps, Sire, que nous reconnaissons que vous êtes le seul maître, seul législateur […] nous croyons de notre devoir de vous présenter qu’il y a des lois aussi anciennes que la Monarchie qui sont fixes et invariables, dont le dépôt vous a été transmis par la couronne ; vous promettez à votre sacre de les exécuter […] C’est à la stabilité de ces lois que nous sommes redevables de vous avoir pour maître. Louis le Grand, votre bisaïeul, a toujours regardé son parlement comme le principal dépositaire des lois fondamentales de l’État, si nécessaires pour la conservation des droits de la couronne […] [votre parlement] est le seul canal par lequel la voix de vos peuples ait pu parvenir jusqu’à vous depuis qu’il n’a point eu d’assemblée d’États généraux. »
—-
L’humour de Montesquieu
Un extrait des Lettres persanes (1721), fiction dans laquelle un Persan en voyage en Europe échange des lettres avec un ami resté au pays.
« Lettre XXIV. Rica à Ibben, à Smyrne
Le roi de France est le plus puissant prince de l’Europe. Il n’a point de mines d’or comme le roi d’Espagne son voisin ; mais il a plus de richesses que lui, parce qu’il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n’ayant d’autres fonds que des titres d’honneur à vendre, et, par un prodige de l’orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies, et ses flottes équipées.
D’ailleurs ce roi est un grand magicien : il exerce son empire sur l’esprit même de ses sujets ; il les fait penser comme il veut. S’il n’a qu’un million d’écus dans son trésor, et qu’il en ait besoin de deux, il n’a qu’à leur persuader qu’un écu en vaut deux, et ils le croient. S’il a une guerre difficile à soutenir, et qu’il n’ait point d’argent, il n’a qu’à leur mettre dans la tête qu’un morceau de papier est de l’argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu’à leur faire croire qu’il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu’il a sur les esprits. »
Montesquieu, Les lettres persanes.
sur eBooksFrance, www.ebooksfrance.com, 2000 (1721), p. 41.
—-
Un lit de justice
Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, les parlements s’opposent à de nombreuses reprises aux édits royaux en adressant au roi des remontrances. En 1765, les magistrats du parlement de Rennes vont jusqu’à démissionner. Ceux de Paris se solidarisent avec eux. Le 3 mars 1766, Louis XV se rend au parlement de Paris ; il y tient un « lit de justice » pour exiger l’enregistrement des édits.
La magistrature ne forme point un corps, ni un ordre séparé des trois ordres du royaume […] C’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, […] c’est de moi seul que mes cours tiennent leur justice et leur autorité ; […] c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans partage […] c’est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais à l’enregistrement, à la publication, à l’exécution de la loi […] l’ordre public tout entier émane de moi ; […] les droits et les intérêts de la Nation, dont on ose faire un corps séparé du monarque, sont nécessairement unis avec les miens, et ne reposent qu’en mes mains […]
Les remontrances seront toujours reçues favorablement, quand […] le secret en conservera la décence et l’utilité, et quand cette voie, si sagement établie, ne se trouvera pas transformée en libelles, où la soumission à ma volonté est présentée comme un crime, et l’accomplissement des devoirs que j’ai prescrits comme un sujet d’opprobre ; où l’on suppose que toute la Nation gémit de voir ses droits, sa liberté, sa sûreté prêts à périr sous la force d’un pouvoir terrible […] ; mais si […] j’ai persisté dans mes volontés [et si] les cours persévéraient dans le refus de s’y soumettre, […] le spectacle scandaleux d’une contradiction rivale de ma puissance souveraine me réduirait à la triste nécessité d’employer tout le pouvoir que j’ai reçu de Dieu pour préserver mes peuples des suites funestes de ces entreprises.
Discours cité par Léon Cahen, Les Querelles religieuses et parlementaires sous Louis XV, 1913.
Ibid., autre arrangement
Discours de Louis XV lors d’un lit de justice au Parlement de Paris le 3 mars 1766
« […] Comme s’il était permis d’oublier que c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine ; que c’est de moi seul que mes cours tiennent leur justice et leur autorité ; que la plénitude de cette autorité, qu’elles n’exercent qu’en mon nom, demeure toujours en moi, et que l’usage n’en peut jamais être tourné contre moi ; que c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage ; que c’est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais à l’enregistrement […] de la loi, et qu’il leur est permis de me remontrer ce qui est du devoir de bons et fidèles conseillers ; que l’ordre public tout entier émane de moi ; que j’en suis le gardien suprême ; que mon peuple n’est qu’un avec moi. »
Dans R. Frank (dir.), Histoire Seconde, Belin, 1987, 1987, p. 21.
Autre citation du même texte adaptée différemment
« C’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de raison. C’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage. L’ordre public tout entier émane de moi, j’en suis le gardien suprême, Mon peuple n’est qu’un avec moi. Les droits et les intérêts de la nation sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu’en mes mains. »
Louis XV, Discours prononcé devant le Parlement de Paris, 1766.
Idem plus long
« Je ne souffrirai pas qu’il se forme dans mon royaume une association qui fera dégénérer en une confédération de résistances le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations communes, ni qu’il s’introduise dans la monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu’en troubler l’harmonie : la magistrature ne forme point un corps séparé des trois ordres du royaume […] Comme s’il était permis d’oublier que c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine : que c’est de moi seul que mes cours tiennent leur justice et leur autorité ; que la plénitude de cette autorité, qu’elles n’exercent qu’en mon nom, demeure toujours en moi, et que l’usage n’en peut jamais être tourné contre moi ; que c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage ; que c’est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais à l’enregistrement, à la publication, à l’exécution de la loi, et qu’il leur est permis de me remontrer ce qui est du devoir de bons et fidèles conseillers ; que l’ordre public tout entier émane de moi ; que j’en suis le gardien suprême ; que mon peuple n’est qu’un avec moi et que les droits et les intérêts de la nation, dont on ose faire un corps séparé du monarque, sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu’en mes mains. »
—-
Le régicide
Ce que pensait le criminaliste français Muyart de Vouglans (1713-1781) d’un attentat commis contre la personne du roi Louis XV en 1757
« On ne peut douter que ce ne soit ici, de tous les crimes qui intéressent la société, le plus grave et le plus punissable, en ce que l’on ne peut le commettre sans violer en même temps toutes sortes de droits. D’abord le droit divin, qui recommande l’obéissance envers les souverains, comme étant l’image de la divinité sur la terre. En second lieu, le droit naturel, suivant lequel les souverains sont regardés comme les pères de leurs sujets. Enfin, le droit des gens, ou ce droit public, qui est attaché essentiellement à la constitution de chaque gouvernement, suivant lequel tous les sujets sont obligés non seulement d’obéir, et de porter bonheur à leur souverain, mais encore de veiller à la sûreté de leur personne et de leur Etat, dont dépend la leur propre. »
Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel, 1781.
—-
La mort de Louis XV
« Vers les premiers jours de mai 1774, Louis XV, annonçant par la force de sa constitution une existence encore assez longue, fut attaqué d’une petite vérole confluente des plus funestes. Mesdames (1) inspirèrent, à cette époque, à Madame la dauphine (2) un sentiment de respect et d’attachement, dont elle leur donna des preuves multiples, lorsqu’elle fut sur le trône. En effet, rien ne fut plus admirable et plus touchant que le courage avec lequel elles affrontèrent la maladie la plus horrible: l’air du palais était infecté; plus de cinquante personnes gagnèrent la petite vérole pour avoir seulement traversé la galerie de Versailles, et dix en moururent.
La fin de ce monarque approchait : son règne, assez paisible, avait conservé une force imprimée par la puissance de son prédécesseur (3) ; d’un autre côté, sa faiblesse avait de même préparé les malheurs de celui qui régnerait après lui. La scène allait changer : l’espoir, l’ambition, la joie, la douleur, tous les sentiments qui s’emparaient diversement des cœurs des courtisans, se déguisaient vainement sous un extérieur uniforme. Il était aisé de démêler les différents motifs qui leur faisaient, à chaque instant, répéter à tous cette phrase : « Comment va le roi? » Enfin, le 10 mai 1774, se termina la carrière de Louis XV.
La comtesse Du Barry (4) s’était retirée depuis quelques jours à Ruelle, chez le duc d’Aiguillon; douze ou quinze personnes de la cour crurent devoir y aller lui faire des visites ; leurs livrées furent remarquées ; et ce fut pendant longtemps un motif de défaveur. J’ai entendu, plus de six ans après la mort du roi, dire dans le cercle de la famille royale, en parlant d’une de ces personnes-là : « C’était une des quinze voitures de Ruelle. »
Toute la cour se rendit au château ; l’œil-de-bœuf (5) se remplit de courtisans, le palais de curieux. Le dauphin (6) avait décidé qu’il partirait avec la famille royale, au moment où le roi rendrait le dernier soupir. Mais, dans une semblable occasion, la bienséance ne permettait guère de faire passer de bouche en bouche les ordres positifs de départ. Les chefs des écuries étaient donc convenus avec les gens qui étaient dans la chambre du roi que ceux-ci placeraient une bougie allumée auprès d’une fenêtre et qu’à l’instant où le mourant cesserait de vivre, un d’eux éteindrait la bougie.
La bougie fut éteinte : à ce signal les gardes-du-corps, les pages, les écuyers montèrent à cheval, tout fut près pour le départ. Le dauphin était chez la dauphine. Ils attendaient ensemble la nouvelle de la mort de Louis XV. Un bruit terrible et absolument semblable à celui du tonnerre se fit entendre dans la première pièce de l’appartement : c’était la foule des courtisans qui désertaient l’antichambre du souverain expiré, pour venir saluer la nouvelle puissance de Louis XVI. A ce bruit étrange, Marie-Antoinette et son époux reconnurent qu’ils allaient régner, et, par un mouvement spontané qui remplit d’attendrissement ceux qui les entouraient, tous deux se jetèrent à genoux ; tous deux, en versant des larmes, s’écrièrent : « Mon Dieu, guidez-nous, protégez-nous, nous régnons trop jeunes (6). »
Mme la comtesse de Noailles (7) entra, la salua la première comme reine de France et demanda à Leurs Majestés de vouloir bien quitter les cabinets intérieurs pour venir dans la chambre recevoir les princes et tous les grands officiers qui désiraient offrir leurs hommages à leurs nouveaux souverains. Appuyée sur son époux, un mouchoir sur les yeux et dans l’attitude la plus touchante, Marie-Antoinette reçut ces premières visites : les voitures avancèrent, les gardes, les écuyers étaient à cheval. Le château resta désert ; tout le monde s’empressait de fuir une contagion qu’aucun intérêt ne donnait plus de courage de braver.
En sortant de la chambre de Louis XV, le duc de Villequier, premier gentilhomme de la chambre d’année, enjoignit à M. Andouillé, premier chirurgien du roi, d’ouvrir le corps et de l’embaumer. Le premier chirurgien devait nécessairement en mourir. « Je suis prêt », répliqua Andouillé ; « mais, pendant que j’opérerai, vous tiendrez la tête : votre charge vous l’ordonne. » Le duc s’en alla sans mot dire, et le corps ne fut ni ouvert, ni embaumé. Quelques serviteurs subalternes et de pauvres ouvriers restèrent près de ces restes pestiférés ; ils rendirent les derniers devoirs à leur maître ; les chirurgiens prescrivirent de verser de l’esprit-de-vin dans le cercueil. »
Mémoires de Mme Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, Paris, Mercure de France, 1988, 1999, p. 72-75.
Notes :
1. Titre donné aux filles du roi et à l’épouse de chacun de ses frères.
2. Il s’agit donc, pour quelques heures encore, de Marie-Antoinette, épouse de Louis, fils aîné du Grand Dauphin et dauphin lui-même depuis le décès de ce dernier, en 1765.
3. Louis XIV. A plusieurs reprises, Mme Campan souligne que Versailles ne vit plus, sous Louis XV et Louis XVI, que sur les souvenirs et quelques vestiges de la grandeur du règne du Roi Soleil. L’étiquette elle-même, toujours aussi complexe, n’est qu’une série de gestes et de rôles figés, vides de sens et de grandeur.
4. Maîtresse de Louis XV depuis 1768, elle a eu une telle influence sur celui-ci qu’on a pu la comparer à une reine. Un projet de mariage avec le roi n’aura cependant pas de suite : la différence de condition et le passé de la Du Barry rendaient une telle alliance impossible – enfant naturelle d’un ecclésiastique, sa carrière de courtisane était déjà riche en aventures lorsqu’elle fut présentée au roi qui la maria, pour lui obtenir un titre convenable, à un noble aussitôt renvoyé chez lui pour céder toute la place au roi. Elle reprendra dès 1776 sa vie tumultueuse mais restera fidèle à la royauté et au couple royal sous la Révolution, fidélité qui la conduira à l’échafaud en 1793.
5. Pièce du palais de Versailles.
6. Louis XVI est né en 1754 et Marie-Antoinette en 1755.
7. Épouse de Louis de Noailles, l’un des familiers de Louis XV.
—-
Le repas de la reine et du roi à la cour de Louis XVI
« Un des usages les plus désagréables était pour la reine celui de dîner tous les jours en public. Marie Leczinska (1) avait suivi constamment cette coutume fatigante: Marie-Antoinette (2) l’observa tant qu’elle fut dauphine (3). Le dauphin (4) dînait avec elle, et chaque ménage de la famille avait tous les jours son dîner en public. Les huissiers laissaient entrer tous les gens proprement mis (5) ; ce spectacle faisait le bonheur des provinciaux. A l’heure des dîner on ne rencontrait, dans les escaliers, que de braves gens qui, après avoir vu la dauphine manger sa soupe, allaient voir les princes manger leur bouilli et couraient ensuite à perte d’haleine pour aller voir Mesdames manger leur dessert (6).
L’usage le plus anciennement établi voulait aussi qu’aux yeux du public les reines de France ne parussent environnées que de femmes ; l’éloignement des serviteurs de l’autre sexe existait même aux heures des repas pour le service de table ; et quoique le roi mangeât publiquement avec la reine, il était lui-même servi par des femmes pour tous les objets qui lui étaient directement présentés à table. La dame d’honneur, à genoux pour sa commodité sur un pliant très bas, une serviette posée sur le bras, et quatre femmes en grand habit présentaient les assiettes au roi et à la reine. La dame d’honneur leur servait à boire. »
Mémoires de Mme Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, Paris, Mercure de France, 1988, 1999, p. 92-93.
Notes :
1. 1703-1768. Fille de Stanislas, ancien roi de Pologne. Épouse de Louis XV depuis 1725.
2. 1755-1793. Fille de François Ier et de Marie-Thérèse, empereur et impératrice d’Autriche. Épouse de Louis XVI depuis 1770.
3. Titre porté par Marie-Antoinette avant l’accession de Louis au trône, en 1774.
4. Louis, fils du dauphin Louis et petit-fils de Louis XV. Il devient à son tour dauphin, c’est-à-dire héritier du trône, à la mort de son père en 1765 et le roi Louis XVI en 1774, à celle de son grand-père.
5. Toute une foule de curieux pouvait ainsi se promener plus ou moins librement dans les jardins et le palais de Versailles.
6. Mme Campan fait ici la note suivante: « On peut imaginer aisément que le charme de la conversation, la gaieté, l’aimable abandon, qui contribuent en France au plaisir de la table, étaient bannis de ces repas cérémonieux. Il fallait avoir pris, dès l’enfance, l’habitude de manger en public, pour que tant d’yeux inconnus dirigés sur vous n’ôtassent pas l’appétit. »
—-
Limites de l’absolutisme
« L’Anglais aura dit : »Le roi de France jouit d’une autorité presque indéfinie ; il a le fer dans une main, l’or dans l’autre […]; il est sûr que la noblesse sera à ses ordres quand il le voudra ; la magistrature lui apporte des remontrances et se retire ; le peuple n’a aucune voix, aucune force […]; il a un plus grand pouvoir encore : il défend à la pensée de paraître […]
Voilà bien des prérogatives ! Eh bien, l’Anglais se trompe […] Les Français, avec tout cela ne sont pas asservis ; les moeurs s’opposent au pouvoir absolu, et le rendent modéré, civil, policé, lui ordonnent des égards et des ménagements […]
Le prince est législateur suprême, et possède toute l’autorité ; mais il n’ose anéantir les droits et privilèges de plusieurs ordres de citoyens ; il les respecte, ou ne les attaque que d’une manière lente, adroite, détournée […] Il est des bornes qu’il ne saurait franchir. »
Dans Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, c. 1780, dans Jacqueline Le Pellec (dir.), Histoire Seconde, Bertrand-Lacoste, 1996, p. 187.
—-
Le programme de Turgot, l’impossible réforme
Le jour même où il est nommé Contrôleur général des Finances, le 24 août 1774, Turgot expose son programme au roi Louis XVI.
« Je me borne en ce moment, Sire, à vous rappeler ces trois paroles :
– Point de banqueroute ;
– Point d’augmentation d’impositions : la raison en est dans la situation des peuples, et encore plus dans le coeur de Votre Majesté ;
– Point d’emprunt, parce que tout emprunt nécessite au bout de quelque temps, ou la banqueroute, ou l’augmentation d’impositions ;
Pour remplir ces trois points, il n’y a qu’un moyen, c’est de réduire la dépense au-dessous de la recette, pour pouvoir économiser chaque année une vingtaine de millions pour rembourser les dettes anciennes. Sans cela le premier coup de canon forcerait l’État à la banqueroute.
Il faut, Sire, vous armer, contre votre bonté, de votre bonté même ; considérer d’où vous vient cet argent que vous pouvez distribuer à vos courtisans, et comparer la misère de ceux auxquels on est quelquefois obligé de l’arracher par les exécutions des plus rigoureuses, à la situation des personnes qui ont le plus de titres pour obtenir vos libéralités.
On peut espérer de parvenir, par l’amélioration de la culture, par la suppression des abus dans la perception, et par une répartition plus équitable des impositions, à soulager sensiblement les peuples, sans diminuer beaucoup les revenus publics. Mais si l’économie n’a précédé, aucune réforme n’est possible.
C’est surtout de l’économie que dépendent la prospérité de votre règne, le calme dans l’intérieur, la considération au dehors, le bonheur de la nation et le vôtre. »
Jacques Dupâquier et Marcel Lachiver, Les Temps modernes, 4e, Bordas, 1970, p. 245.
Le débat sur la corvée royale
Turgot, ministre de Louis XVI, décide, par l’édit de janvier 1776, de supprimer la corvée royale dont il dénonce le caractère injuste dans le préambule de l’édit :
« Un motif plus puissant et plus décisif encore nous détermine : c’est l’injustice, inséparable de l’usage des corvées. Tout le poids de cette charge retombe et ne peut retomber que sur la partie la plus pauvre de nos sujets, sur ceux qui n’ont de propriété que leurs bras et leur industrie, sur les cultivateurs et sur les fermiers. Les propriétaires, presque tous privilégiés, en sont exempts ou n’y contribuent que très peu. Cependant c’est aux propriétaires que les chemins publics sont utiles, par la valeur que des communications multipliées donnent aux productions de leurs terres. C’est la classe des propriétaires des terres qui recueille le fruit de la confection des chemins : c’est elle qui devrait seule en faire l’avance puisqu’elle en retire les intérêts. Comment pourrait-il être juste d’y faire contribuer ceux qui n’ont rien à eux ? De les forcer à donner leur temps et leur travail sans salaire, de leur enlever la seule ressource qu’ils aient contre la misère et la faim, pour les faire travailler au profit des citoyens plus riches qu’eux ? »
Le Parlement de Paris adresse au roi, le 4 mars, de solennelles remontrances :
« Tout système qui, sous une apparence d’humanité et de bienfaisance, tendrait, dans une monarchie bien ordonnée, à établir entre les hommes une égalité de devoirs et à détruire les distinctions nécessaires, amènerait bientôt le désordre, suite inévitable de l’égalité absolue, et produirait le renversement de la société… C’est là une question d’État et une des plus importantes, puisqu’il s’agit de savoir si tous vos sujets peuvent et doivent être confondus, s’il faut cesser d’admettre parmi eux des conditions différentes, des rangs, des titres, des prééminences.
Le service personnel du Clergé est de remplir toutes les fonctions relatives à l’instruction, au culte religieux, et de contribuer au soulagement des malheureux par ses aumônes.
Le Noble consacre son sang à la défense de l’État et assiste de ses conseils le souverain.
La dernière classe de la nation, qui ne peut rendre à l’État des services aussi distingués, s’acquitte envers lui par les tributs, l’industrie et les travaux corporels. »
Les deux textes cités dans R. Frank (dir.), Histoire Seconde, Belin, 1987, p. 47.
Un autre extrait de la même remontrance
Une société d’ordres
« La monarchie française, par sa constitution est composée de plusieurs états distincts et séparés.
Cette distinction de conditions et de personnes tient à l’origine de la nation; elle est née avec ses mœurs; elle est la chaîne précieuse qui lie le souverain à ses sujets.
Si l’état des personnes n’était pas distingué, il n’y aurait que désordre, confusion […] Nous ne pouvons pas vivre en égalité de conditions, il faut par nécessité que les uns commandent et que les autres obéissent. Dans l’assemblage formé par ces différents ordres, tous les hommes de votre royaume vous sont sujets, tous sont obligés de contribuer aux besoins de l’État. Mais dans cette contribution même, l’ordre et l’harmonie se retrouvent toujours. Le service personnel du clergé est de remplir toutes les fonctions relatives à l’instruction, au culte religieux et de contribuer au soulagement des malheureux par ses aumônes. Le noble consacre son sang à la défense de l’Etat et assiste le souverain de ses conseils. La dernière classe de la nation, qui ne peut rendre à la nation les services aussi distingués, s’acquitte envers lui par ses tributs, l’industrie et les travaux corporels.
[…] Si on dégrade la noblesse, si on lui enlève les droits primitifs de sa naissance, elle perdra bientôt son esprit, son courage et cette élévation d’âme qui la caractérise […]
Ce n’est point ici, comme on a essayé de vous le persuader, Sire, un combat de riches contre les pauvres. C’est une question d’État et une des plus importantes, puisqu’il s’agit de savoir si tous vos sujets peuvent et doivent être confondus, s’il faut cesser d’admettre parmi eux des conditions différentes, des titres, des rangs et des prééminences… »
Remontrances du Parlement de Paris, 4 mars 1776.
—-
Critique des intendants du roi
Les conseils de Necker
« Une multitude de plaintes se sont élevées de tout temps contre le genre d’administration employé dans les provinces ; ces plaintes se renouvellent plus que jamais et l’on ne pourrait s’y montrer indifférent sans avoir peut-être des reproches à se faire. À peine en effet peut-on donner le nom d’administration à cette volonté arbitraire d’un seul homme, qui, tantôt présent, tantôt absent, tantôt instruit, tantôt incapable, doit régir les parties les plus importantes de l’ordre public, et qui doit s’y trouver habile, après ne s’être occupé toute sa vie que de requêtes au Conseil (1) ; qui souvent, ne mesurant pas même la grandeur de la commission (2) qui lui est confiée, ne considère sa place que comme un échelon pour son ambition ; et si, comme il est raisonnable, on ne lui donne à gouverner, en débutant, qu’une généralité (3) d’une médiocre étendue, il la voit comme un lieu de passage, et n’est point excité à préparer des établissements dont le succès ne lui est point attribué. Enfin, présumant toujours, et peut-être avec raison, qu’on avance encore plus par l’effet de l’intrigue et des affections que par le travail et l’étude, ces commissaires sont impatients de venir à Paris, et laissent à leurs secrétaires ou à leurs subdélégués le soin de les remplacer dans leurs devoirs publics.
Il est sans doute des parties d’administration qui, tenant uniquement à la police, à l’ordre public, à l’exécution des ordres de Votre Majesté, ne peuvent jamais être partagées, et doivent, par conséquent, reposer sur l’intendant seul ; mais il en est aussi, telles que la répartition et la levée des impositions, l’entretien et la construction des chemins, le choix des encouragements favorables au commerce, au travail en général, et aux débouchés de la province en particulier, qui, soumises à une marche plus lente et plus constante, peuvent être confiées préalablement à une commission composée de propriétaires, en réservant à l’intendant l’importante fonction d’éclairer le gouvernement sur les différents règlements qui seraient proposés […]
Comme la force morale ou physique d’un ministre ne saurait suffire à une tâche si immense et à de si vastes sujets d’attention, il arrive nécessairement que c’est du fond des bureaux que la France est gouvernée, et selon qu’ils sont plus ou moins éclairés, plus ou moins purs, plus ou moins vigilants, les embarras des ministres et les plaintes des provinces s’accroissent ou diminuent. En retenant à Paris tous les fils de l’administration, il se trouve que c’est dans un lieu où l’on ne sait rien que par des rapports éloignés, où l’on ne croit qu’à ceux d’un seul homme et où l’on n’a jamais le temps d’approfondir, qu’on est obligé de diriger et de discuter toutes les parties d’exécution. Les ministres auraient dû sentir qu’en ramenant à eux une multitude d’affaires, au-dessus de l’attention, des forces et de la mesure du temps d’un seul homme, ce ne sont pas eux qui gouvernent, ce sont leurs commis ; et ces mêmes commis, ravis de leur influence, ne manquent jamais de persuader au ministre qu’il ne peut se détacher de commander un seul détail, qu’il ne peut laisser une seule volonté libre, sans renoncer à ses prérogatives et diminuer sa consistance.
Cet ouvrage imparfait et successif de l’administration française présente partout des obstacles. Qui peut les vaincre et les surmonter le plus facilement ? Est-ce un seul homme ? Est-ce un corps d’administration ? C’est un homme seul, sans doute, si vous réunissez en lui les qualités nécessaires. Rien n’est plus efficace que l’action du pouvoir dans une seule main ; mais en même temps que je crois autant qu’un autre à la puissance active d’un seul homme qui réunit au génie la fermeté, la sagesse et la vertu, je sais combien de tels hommes sont épars dans le monde ; combien, lorsqu’ils existent, il est accidentel qu’on les rencontre, et combien il est rare qu’ils se trouvent dans le petit circuit où l’on est obligé de prendre les intendants de province. L’expérience et la théorie indiquent également que ce n’est pas avec des hommes supérieurs, mais avec le plus grand nombre de ceux qu’on connaît et qu’on a connus, qu’il est juste de composer une administration provinciale, et alors toute la préférence demeurera à cette dernière. Dans une commission permanente, composée des principaux propriétaires d’une province, la réunion des connaissances, la succession des idées, donnent à la médiocrité même une consistance ; la publicité des débats force à l’honnêteté ; si le bien arrive avec lenteur, il arrive du moins, et une fois obtenu, il est à l’abri du caprice ; tandis qu’un intendant, le plus rempli de zèle et de connaissances, est bientôt suivi par un autre qui dérange ou abandonne les projets de son prédécesseur. Dans l’espace de dix à douze ans, on les voit aller de Limoges en Roussillon, du Roussillon en Hainaut, du Hainaut en Lorraine, et à chaque variation, ils perdent le fruit des connaissances locales qu’ils peuvent avoir acquises. »
Necker, Mémoire au Roy, 1778.
1. La plupart des intendants sont recrutés au sein des diverses formations du Conseil de Roi (Conseil des Parties, Conseil des Aides, etc.) où ils occupent les charges d’auditeur puis de maître des requêtes. Ils y ont l’occasion de se faire remarquer d’un ministre ou du roi en personne, qui les nomme ensuite dans une généralité.
2. Les intendants reçoivent, au moment où ils sont nommés une commission écrite qui fixe leurs attributions, leurs prérogatives et l’étendue de leur juridiction, et qui leur donne, le cas échéant, des instructions plus précises sur les orientations qu’ils doivent donner à leur administration provinciale.
3. La généralité est la circonscription au sein de laquelle opère l’intendant. En général, les limites des généralités sont celles des provinces, mais ces frontières peuvent varier en fonction des nécessités politiques. Elles sont précisées dans les lettres de commission.
Dans Clio-Texte, il y a aussi des textes sur la société française d’Ancien régime, l’Édit de Fontainebleau révoquant l’Édit de Nantes, les dragonnades ainsi que des portraits du Régent, de Louis XV, Louis XVI, de Marie-Antoinette et de Necker .
Sur le site Arisitum , vous trouverez aussi des textes sur la France de l’époque moderne.