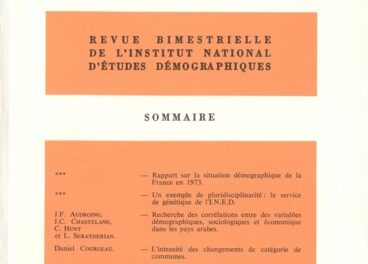Extraits des Mémoires de Monsieur de Pontis

Querelle de préséance lors d’un assaut
« Après la bataille d’Avain, les deux armées marchèrent vers Tirlemont, ville qui est devenue célèbre par sa prise et par le saccagement horrible qui en fut fait avec tant d’inhumanités et de sacrilèges que je ne puis encore y penser sans que les cheveux me dressent presque à la tête.
Il fallut d’abord prendre les faubourgs, et comme j’étais des premiers avec les enfants perdus, j’eus dans l’assaut une assez grande brouillerie avec M. de la Motte-Haudencourt. Car me voyant en même rang que lui et dans une aussi grande ardeur de pousser ma pointe et de monter le premier à l’escalade, il commença à me crier :
« Monsieur, Monsieur de Pontis, vous ne marchez pas en votre rang. Je suis mestre de camp ; je dois marcher devant vous. »
Je lui répondis sans m’émouvoir :
« Monsieur, chacun garde le poste qui lui a été donné. Vous gardez le vôtre et je tâcherai de conserver le mien. »
Ma réponse, au lieu de lui plaire, le mit tout de bon en colère. Il ne put souffrir ma froideur et la fermeté avec laquelle je lui avais parlé, et commençant à jurer un peu, il me cria encore plus haut que si je ne m’arrêtais, il se ressentirait de cet affront. Je lui répondis en riant que je croyais qu’il ne s’en souviendrait que pour m’en aimer davantage, lorsque nous serions tous deux entrés glorieusement dans la ville et que c’était là tout le ressentiment que j’attendais de l’honneur de son amitié. Il ne prit pas néanmoins en raillerie ce que je disais et comme nous avancions toujours chacun de notre côté, lorsque je montais déjà sur un travail avancé en forme de bastion et qu’il me vit prêt d’être monté, et de lui ravir l’honneur qu’il prétendait de monter le premier, il se mit à crier de nouveau, mais avec plus de chaleur qu’auparavant, que si je ne m’arrêtais, il allait faire tirer sur moi.
C’était assurément une aussi agréable chose que l’on puisse guère s’imaginer, de nous voir ainsi tous les deux parlementer et combattre touchant l’honneur de l’assaut, l’un avec le froid d’un homme qui rit et l’autre avec toute la chaleur d’une personne qui est transportée de colère. Je ne m’étonnai pas davantage de ce dernier compliment que des précédents et je lui dis avec la même gaîté qu’à l’ordinaire :
« Si je ne connaissais M. de la Motte-Haudencourt et quelle est sa générosité, j’aurais quelque lieu de craindre ce dont il me menace ; mais je sais que c’est seulement pour rire. Je m’en vais, Monsieur, ajoutais-je, vous faire le chemin et vous ouvrir un passage. »
Dans le même instant, je gagnai le dessus du bastion avec mes soldats, et les ennemis se voyant forcés de tous côtés se retirèrent dans la ville.
Je me trouvai justement, étant monté, vis-à-vis d’une des portes et comme ce poste était très avantageux, cela contribua encore à augmenter le chagrin et la mauvaise humeur de M. de la Motte-Haudencourt qui fut obligé de prendre un détour et se rencontra en un autre poste beaucoup moins favorable que le mien. Mais je fus prophète, car notre querelle n’ayant commencé qu’avec le combat, se termina bientôt, heureusement (…). »
Mémoires de Monsieur de Pontis. Maréchal de bataille. Paris, Mercure de France, 1986/2007, pp. 238 – 240.
—-
Un émissaire du Cardinal de Richelieu tente de s’assurer des services de Monsieur de Pontis
Proche de Louis XIII, et par moments même son confident, M. de Pontis manifesta une fidélité sans faille à son roi, même si celui-ci fut parfois ingrat ou négligent en regard des services de son futur Maréchal de bataille. À l’époque du siège de La Rochelle, le Cardinal de Richelieu tente de ranger de Pontis dans son camp et de le détacher en conséquence du service direct du Roi, à un moment où celui-ci espère devenir capitaine des Gardes du Roi. Peine perdue, de Pontis ne renia jamais son maître même si le grade et la fonction lui échappèrent. La scène a lieu alors que de Pontis est chargé d’assurer la sécurité du Cardinal.
« Dans le dessin qu’il [Richelieu] avait de me gagner et de m’attirer à son service, il donna ordre qu’on me préparât une belle chambre où rien ne manquait. Mais je ne voulus seulement pas me coucher durant la nuit, afin de veiller à ce qui était de ma charge. Il ne laissa pas de prendre de cela même une occasion de me flatter et il affecta de me louer extrêmement devant quelques personnes de la Cour, afin qu’elles me le redisent. Enfin il se résolut de me faire tenter tout de bon et il choisit pour cela le Père Joseph, qui était très propre pour exécuter son dessein, étant entièrement dans ses intérêts et n’ayant pas l’esprit moins adroit ni moins pénétrant que lui. (…)
Le Père Joseph passant donc devant mon logis, ou au moins faisant semblant de passer, pour ne pas faire connaître qu’il venait exprès, demanda assez haut si j’y étais. On m’en avertit, et étant aussitôt descendu au-devant de lui, nous montâmes ensemble à la chambre. Tout le monde qui y était se retira à l’heure même pour faire place à ce ministre du Cardinal qui n’était guère moins redouté que lui. Ainsi nous nous enfermâmes tous deux seuls.
[Le Père Joseph ouvre la conversation avec une invitation à M. de Pontis de se rendre chez lui avec un soldat et lui rappelle un service que ce même de Pontis lui avait proposé quelque temps plus tôt. Pontis, rapidement, perçoit la manœuvre.]
C’était donc de cette rencontre que parlait le Père, lequel continua à m’entretenir de la sorte :
« Je me suis toujours souvenu depuis de la charité que vous nous fîtes alors, et je n’ai pu vous oublier en y pensant. J’ai parlé pour vous en plusieurs occasions à M. le Cardinal et j’ai reconnu qu’il vous estime beaucoup. Il est très disposé à vous servir. Il ne se trompe pas dans le choix qu’il fait des personnes. Il a un discernement merveilleux pour juger du mérite des gens, il récompense la vertu partout où il la connaît.
– Mon Père, lui dis-je, je vous ai une extrême obligation de ce que vous avec eu une si grande reconnaissance d’une si petite chose. Je ne méritais pas néanmoins que vous parlassiez de moi à M. le Cardinal, et j’ai peur que ce que vous avez eu la bonté de lui dire à ma louange ne tourne à mon désavantage. Car comme un aussi grand esprit que le sien ne peut estimer que les choses éminentes, n’y ayant rien en moi qui ne soit très commun, c’est vouloir donner de l’estime d’une personne qui ne la mérite pas. Je ne puis, ce me semble, me vanter que d’une chose, qui est de la fidélité inviolable que j’ai toujours gardée au Roi mon maître et dans laquelle je puis dire sans vanité que je ne cède à personne. »
Le Père, voyant sa mine éventée, ne s’étonna point et prit sujet de mes paroles pour me répondre.
« C’est cela même, me dit-il, que M. le Cardinal estime le plus en vous, c’est cette grande fidélité connue de tout le monde qu’il recherche davantage. Ce sont ces personnes qu’il demande : il veut des officiers qui lui soient fidèles et ne soient qu’à lui sans exception et sans réserve. Il ne veut point de ceux qui servent à deux maîtres (ce furent ses propres termes), sachant bien qu’il ne peut se trouver de fidélité en eux. C’est ce qui l’a porté à jeter les yeux sur vous, parce qu’il sait que lorsque vous vous êtes donné à un maître, vous ne regardez que lui, et ne servez que lui seul après Dieu. Il est si rare en ce temps-ci, ajouta-t-il, de trouver des hommes de cette trempe, que s’il fallait les acheter, M. le Cardinal les achèterait au poids de l’or. »
On ne pouvait guère, sans doute, pousser les choses plus loin, ni se déclarer plus ouvertement, Aussi ne croyant pas alors devoir garder davantage de mesures avec une personne qui en gardait si peu avec moi, je ne craignis plus de me déclarer aussi ouvertement qu’il le faisait.
« Je sais, mon Père, lui dis-je, que ce m’est un trop grand honneur que Son Éminence ait jeté les yeux sur moi ; et je suis très persuadé que je ne pourrais m’approcher de sa personne sans être assuré de ma fortune. Mais puisque M. le Cardinal témoigne lui-même qu’il estime principalement la fidélité dans les serviteurs, ne serait-il pas le premier à me blâmer d’infidélité, si après l’honneur qu’il a plu au Roi de me faire en m’approchant de sa personne, et me donnant lui-même une lieutenance dans ses Gardes, je quittais si tôt son service pour me donner à un autre ? Ce serait faire paraître une légèreté et une ingratitude bien inexcusables ; et il n’y a personne qui ne jugeât qu’ayant été si mauvais serviteur d’un Roi de France, je ne fusse très indigne de l’être du plus grand Cardinal de la Chrétienté. J’ai sans doute tout sujet de croire, mon Père, que M. le Cardinal veut éprouver ma fidélité en cette personne et j’espère que vous aurez la bonté de lui en rendre témoignage et d’ajouter cette nouvelle grâce à tant d’autres dont je vous suis obligé. »
Alors le Père se sauvant heureusement par cette ouverture favorable que je lui donnais, feignit d’être fort satisfait de moi et après m’avoir loué de cette reconnaissance que j’avais des faveurs du Roi, il sortit, paraissant aussi content à l’extérieur qu’il avait de dépit au fond de l’âme de voir ses compliments si mal payés.
[Dans les jours qui suivent, Richelieu exprime lui-même son admiration pour de Pontis, mais rien n’y fait. Pontis peut alors conclure son récit.]
Je dirai dans la suite de ces mémoires comment après avoir tenté les promesses et les louanges et usé de toutes les voies de la douceur, dont un homme aussi habile que lui pût s’aviser, il en vint enfin à la rigueur et à la violence, jusqu’à me faire perdre en un jour et ma liberté et tous mes appointements. »
Mémoire de Monsieur de Pontis, Maréchal de bataille, Paris, Mercure de France, 1986/2007, pp. 126 – 131.
—-
La mort du duc de Montmorency (1595 – 1632)
Issu d’une famille de haute noblesse, Henri II de Montmorency sert brillamment Louis XIII avant de prendre le parti de Gaston d’Orléans et soulève pour lui le Languedoc. Battu, il est condamné à la peine capitale et exécuté à Toulouse, le 30 octobre 1632. Monsieur de Pontis décrit la douleur que causa cette mort dans l’entourage du roi où Richelieu, avec cette exécution, voit disparaître un rival.
« Le Parlement [de Toulouse] était aux opinions. On ne pouvait pas beaucoup délibérer sur ce sujet ; et un homme qui avait été pris ayant les armes à la main contre son prince ne pouvait pas n’être point condamné à la mort. Ainsi l’un des commissaires forma le premier l’avis de mort, et on remarqua qu’en finissant il avait les larmes aux yeux. Toute la compagnie ayant ôté le bonnet sans dire un seul mot, M. le Garde des Sceaux conclut de même, fit dresser et signa l’arrêt avant que de sortir du Palais.
Alors tous les juges se retirèrent en grande hâte dans leurs maisons, pour donner toute la liberté à leurs larmes et à leurs soupirs, qu’ils avaient été contraints de retenir par cérémonie dans le siège de la justice.
L’arrêt ayant été porté au Roi, Sa Majesté ne put elle-même s’empêcher de s’attendrir et elle changea deux articles de l’arrêt : l’un que l’exécution qui devait être faite dans les halles se ferait à huis-clos dans l’Hôtel de Ville, et l’autre que M. de Montmorency pourrait disposer de ses biens qui avaient été confisqués, ce qu’il fit ensuite dans un testament qu’il donne à M. de Saint-Preüil pour le donner à Sa Majesté, le priant de lui demander pardon de sa part. Et il voulut, par une action digne d’un vrai chrétien, témoigner encore à son plus grand ennemi qu’il renonçait en mourant à tout ressentiment et à toute haine, ayant chargé le même M. de Saint-Preüil d’offrir à M. le Cardinal de Richelieu un tableau de Saint-François, pour marque qu’il mourait son serviteur.
Sur le midi du même jour que l’arrêt fut donné, les deux commissaires et le greffier criminel se rendirent dans la chapelle de l’Hôtel de Ville, où l’on fit venir M. de Montmorency, lequel se mit à genoux au pied de l’autel et ayant les yeux sur un crucifix, il ouït prononcer son arrêt. S’étant ensuite levé, il dit à ceux qui étaient présents :
« Priez Dieu, Messieurs, qu’il me fasse la grâce de souffrir chrétiennement l’exécution de ce qu’on me vient de lire. »
Les commissaires le laissant dans les mains de son confesseur, l’un d’eux lui dit :
« Nous allons faire, Monsieur, ce que vous nous avez commandé ; nous prions Dieu qu’il vous fortifie. »
Comme il demeura dans la chapelle, et qu’il leva de nouveau les yeux sur le crucifix, les ayant ensuite baissés sur ses habits qui étaient fort riches, il jeta sa robe de chambre et dit :
« Oserai-je, étant criminel comme je suis, aller à la mort vêtu avec vanité, lorsque je vois mon Sauveur mourir innocent tout nu sur la croix ? Il faut, mon père, ajouta-t-il en parlant à son confesseur, que je me mette en chemise, pour faire amende honorable devant Dieu des grands péchés que j’ai commis contre lui. »
Dans ce moment, le comte de Charlus vint lui demander de la part du Roi l’Ordre du Saint-Esprit et le bâton de Maréchal de France. Il employa tout le temps qui lui restait à s’offrir à Dieu, à se fortifier contre la mort par la vue des souffrances de Jésus-Christ et à le prier de vouloir lui pardonner ses péchés. S’étant informé de l’heure en laquelle il devait être exécuté, il demanda comme une grâce de mourir à l’heure que Jésus-Christ était mort, c’est-à-dire, environ deux heures plus tôt qu’il n’avait été ordonné, ce qui fut laissé à son choix. Il écrivit, avant que de mourir, à Mme de Montmorency, sa femme, un billet par lequel il la conjurait de vouloir se consoler et d’offrir à Dieu, pour le repos de son âme, la douleur qu’elle ressentait de sa mort en modérant son ressentiment dans la vue de la miséricorde que Dieu lui faisait.
Il se fit couper les cheveux par-derrière et étant nu en caleçon et en chemise, il traversa, au milieu des gardes qui le saluèrent à son passage, une allée qui conduisait dans la cour de l’Hôtel de Ville, à l’entrée de laquelle il rencontra l’échafaud qui pouvait être de quatre pieds de hauteur.
Lorsqu’il fut monté accompagné de son confesseur et suivi de son chirurgien, il salua la compagnie qui n’était que du greffier du Parlement, du Grand Prévost et de ses archers, et des officiers du Corps de Ville qui avaient eu ordre de s’y trouver. Il les pria de bien vouloir témoigner au Roi qu’il mourait son très humble sujet, et avec un regret extrême de l’avoir offensé, dont il demandait pardon aussi bien qu’à toute la compagnie. Il s’informa où était l’exécuteur qui ne l’avait point encore approché et ne voulant plus souffrir par humilité que son chirurgien le touchât, mais s’abandonnant absolument entre les mains du bourreau afin qu’il l’ajustât, qu’il le liât, qu’il le bandât et qu’il lui coupât encore les cheveux qui ne l’étaient pas assez, il dit avec un profond sentiment d’humilité qu’un grand pécheur comme lui ne pouvait mourir avec assez d’infamie. Enfin, il se mit à genoux, proche le billot sur lequel il posa son cou en se recommandant à Dieu, et l’exécuteur à l’instant lui coupa la tête, chacun ayant détourné les yeux, tous fondant en larmes et les gardes mêmes jetant les plus grands soupirs.
[Dans les lignes suivantes, M. de Pontis rappelle les titres et la grandeur du personnage que le royaume venait de perdre.]
Mémoires de Monsieur de Pontis, Maréchal de bataille, Paris, Mercure de France, 1986/2007, pp. 214 -217.
—-
La mort de Louis XIII
Officier de sa Garde et par moments assez proche du roi, Bénédict-Louis de Pontis (1578 – 1670) est, après diverses disgrâces dues à ses emportements autant qu’à son refus de servir Richelieu, à nouveau proche de celui qu’il a servi avec une loyauté sans défaut et assiste à ses derniers instants.
« Ce pauvre prince devint si maigre et si défait qu’ayant pitié de soi-même dans l’état où il se voyait, il découvrait quelquefois ses bras tout décharnés, et les montraient à ceux de sa Cour qui le venaient voir.
Lorsqu’il était au lit de la mort, M. de Souvray, premier gentilhomme de la Chambre, ayant dit un jour selon la coutume que tout le monde sortît, afin que le Roi pût reposer, et ayant tiré le rideau du lit du côté que j’étais, pour m’obliger de sortir comme les autres, le Roi retira tout d’un coup son rideau, et m’ordonna de demeurer. Car son dessein n’était pas tant de reposer que de se voir délivré de l’importunité des gens de la Cour. Il commença ensuite avec une bonté toute particulière à s’entretenir familièrement avec moi. En voyant de loin, de dedans son lit, par la fenêtre de sa chambre du château de Saint-Germain, le clocher de Saint-Denis, il me demanda ce que c’était. Comme je lui eus répondu que c’était l’église de Saint-Denis, il me dit en envisageant déjà sa mort :
« Voilà où nous reposerons. »
Puis tirant son bras de son lit, il me le montra, en me disant :
« Tiens, Pontis, vois cette main, regarde ce bras, voilà quels sont les bras du Roi de France. »
Je vis, en effet, avec une angoisse et un serrement de cœur que je ne puis exprimer, que c’était comme un squelette qui avait la peau collée sur les os, et qui était tout couvert de grandes taches blanches. Ce prince me fit voir ensuite son estomac, qui était si fort décharné que l’on comptait facilement tous les os, comme s’il n’y avait point eu de chair. Ce fut alors que ne pouvant plus retenir au-dedans de moi la douleur qui m’étouffait, je m’abandonnai aux larmes et aux soupirs, et fis connaître à Sa Majesté, en me retirant, que j’étais touché au dernier point de la voir en un état qui m’était, si j’ose dire, plus sensible qu’à lui-même.
Je ne parle point ici des conjectures que l’on fit touchant sa maladie. Ce sont des secrets qu’il serait assez inutile, et même assez difficile de découvrir. Il suffit de reconnaître que ce prince mourut au moment auquel Dieu avait résolu qu’il devait mourir.
Il était très mal servi dans sa maladie, et ne prenait presque jamais un bouillon qui fût chaud ; ce qui me donnait une extrême peine de voir un roi beaucoup plus mal servi, au milieu de ce grand nombre d’officiers, que le moindre bourgeois de Paris.
Je n’étais pas dans sa chambre lorsqu’il mourut, car on empêchait tout le monde d’y entrer. »
Mémoires de Monsieur de Pontis, Maréchal de bataille, Paris, Mercure de France, 1986/2007, pp. 292 -294.