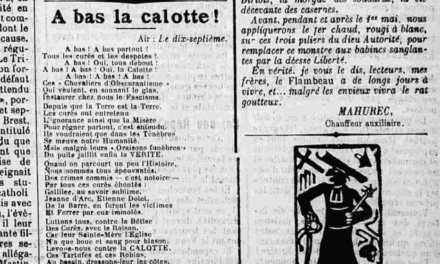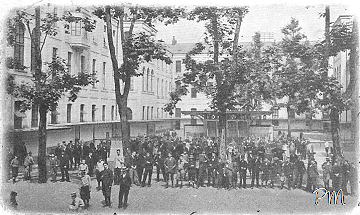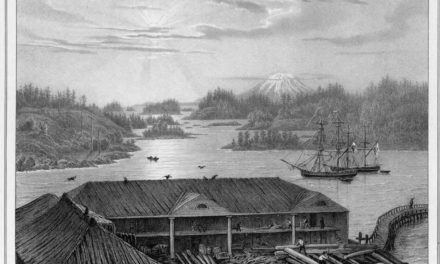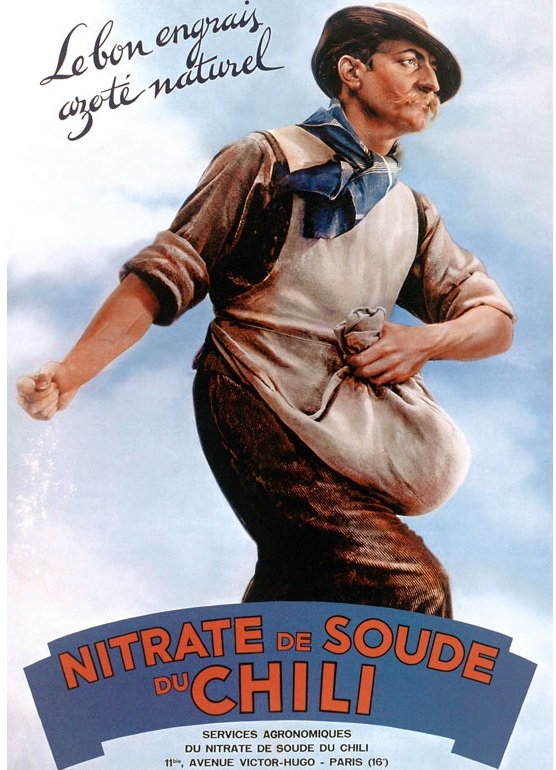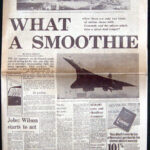Flora Tristan est née en 1803 à Paris d’un père péruvien issu d’une riche famille et d’une mère issue de la petite bourgeoisie parisienne. Fille « illégitime », elle perd son père très jeune et évolue dans la pauvreté. Mariée à l’âge de 17 ans à un homme violent, elle s’enfuit. Elle se rend au Pérou en 1833 afin d’obtenir une part de l’héritage familial mais en vain. De retour en France, elle s’engage dans un long combat visant à obtenir justice sociale et émancipation féminine. Autrice de plusieurs ouvrages, elle veut constituer une « Union ouvrière » dans laquelle les femmes auraient toute leur place. Elle se lance dans un Tour de France et rédige à cette occasion un journal qui restera inachevé, Flora Tristan décédant durant son voyage à Bordeaux en 1844.
Flora Tritan s’est rendue en Grande-Bretagne en 1839 et, à cette occasion, elle entend entrer dans le Parlement anglais, lieu strictement interdit aux femmes. Elle y parvient en se déguisant en homme (elle revêt des habits turcs!). Essuyant des commentaires affligeants, elle offre du lieu sacro-saint une description au vitriol, qualifiant même les individus qui y siègent « d’êtres insignifiants« .
« L’aspect de la salle est ce qu’il y a de plus mesquin, de plus bourgeois, de plus boutiquier : elle forme un carré long, est petite et très incommode ; le plafond est bas ; les galeries supérieures avancent et cachent, en partie, les bas-côtés ; les bancs sont en bois peint couleur de noyer. Cette salle n’a point de caractère qui annonce sa destination, elle ressemble à tout ce qu’on veut, pourrait, dans un village, servir de chapelle, et ne ferait pas disparate avec une réunion d’épiciers ; elle n’a de dignité, ni dans l’architecture, ni dans les décors ; L’éclairage au gaz est d’une grande richesse, et c’est la seule chose dont on puisse faire l’éloge.
Les honorables s’étendent sur les bancs, en hommes fatigués et ennuyés ; plusieurs sont couchés entièrement et dorment. Cette société anglaise, qui se martyrise toujours par la stricte observation des règles de l’étiquette, qui attache une si haute importance à la toilette, qu’elle ne s’exempte pas même à la campagne d’en faire trois par jour, ces anglais si guindés, qui se formalisent pour le plus petit oubli, pour la moindre négligence, affichent à la chambre un mépris complet pour tous les égards que les usages de la société imposent. C’est du bon ton parlementaire de se présenter à la séance, tout crotté, le parapluie sous le bras, en costume de matin ; d’arriver à cheval, d’entrer dans l’assemblée avec des éperons, la cravache à la main et en habit de chasse.
Les êtres insignifiants, si nombreux dans les chambres britanniques, espèrent ainsi faire croire à leurs grandes occupations ou fashionables amusements, et quoique, je le présume, aucun de ces messieurs ne se permit de visiter n’importe lequel de ses collègues en gardant le chapeau sur la tête, tous dans l’assemblée, affectent de le garder ; à la vérité, ils n’exigent pas plus de politesse des autres qu’ils n’en ont pour eux-mêmes ! personne dans les tribunes n’ôte son chapeau. En France on exige cette marque de déférence dans toutes les réunions publiques, il faut croire qu’en Angleterre la chambre des communes pense n’y avoir aucun droit ».
Flora Tristan, « Une visite aux Chambres du Parlement », chapitre VI, Promenades dans Londres ou l’aristocratie et les prolétaires anglais (1840), in Flora Tristan, L’aventure de l’émancipation féminine, Folio, 2025, pp.41-42.