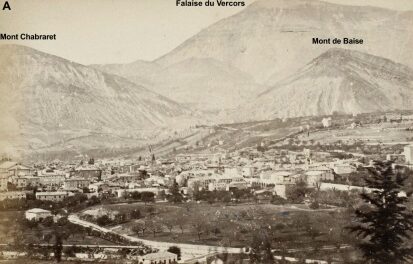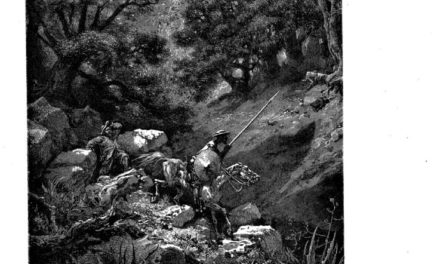Né le 15 mars 1830 à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), mort à Thourout, près de Gand (Belgique), le 4 juillet 1905, Jacques Élisée Reclus fut à la fois géographe, militant anarchiste, membre de l’Internationale bakouninienne et Communard.
Quatrième enfant d’un pasteur qui le destine à suivre sa voie, Élisée se détache de la foi religieuse et découvre à la fin des années 1840 les auteurs socialistes dont il ne tarde pas à devenir un fervent militant, avec son frère Élie. En 1850, il se rend à Berlin et suit les cours du géographe Karl Ritter. L’année suivante, Élisée rentre en France et suit des cours de droit. Après le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, il quitte la France avec son frère pour Londres puis l’Irlande, où il découvre les ravages de la pauvreté, puis enfin les États-Unis en 1853, où il tente de fonder à Santa-Martha (Colombie) une colonie agricole, mais sans succès. Il continue à voyager, essentiellement en Amérique latine. Élisée rentre en France en 1857 et s’installe dans un premier temps chez Élie, à Neuilly-sur-Seine. Ils rencontrent notamment Auguste Blanqui et Pierre-Joseph Proudhon. Tout en donnant des cours de langues étrangères, en 1858, Élisée s’engage en franc-maçonnerie et entre à la Société de géographie.
En 1859, il participe à la très influente Revue des deux mondes en rédigeant de nombreux articles dont la plupart sont consacrés à la géographie. C’est dans ce contexte qu’il publie l’article suivant en 1864. S’appuyant sur un ouvrage de George P. Marsh Man and Nature, or Physical geography as modified by human action, publié la même année à Londres, Élisée Reclus consacre son propos à démontrer (déjà !) l’influence de l’Homme sur le climat et son milieu.
Comme le vieil Adam pétri d’argile et comme les premiers Égyptiens nés du limon, nous sommes les fils de la terre. C’est d’elle que nous tirons notre substance; elle nous entretient de ses sucs nourriciers et fournit l’air à nos poumons ; au point de vue matériel, elle nous donne « la vie, le mouvement et l’être. » Quelle que soit la liberté relative conquise par notre intelligence et notre volonté propres, nous n’en restons pas moins des produits de la planète attachés à sa surface comme d’imperceptibles animalcules, nous sommes emportés dans tous ses mouvemens et nous dépendons de toutes ses lois. Et ce n’est point seulement en qualité d’individus isolés que nous appartenons à la terre, les sociétés, prises dans leur ensemble, ont dû nécessairement se mouler à leur origine sur le sol qui les portait; elles ont dû refléter dans leur organisation intime les innombrables phénomènes du relief continental, des eaux fluviales et maritimes, de l’atmosphère ambiante. Tous les faits de l’histoire s’expliquent en grande partie par la disposition du théâtre géographique sur lequel ils se sont produits ; on peut même dire que le développement de l’humanité était inscrit d’avance en caractères grandioses sur les plateaux, les vallées et les rivages de nos continents. Ces vérités sont d’ailleurs devenues presque banales depuis que les Humboldt, les Ritter, les Guyot, ont établi par leurs travaux la solidarité de la terre et de l’homme. L’idée-mère qui inspirait l’illustre auteur de l’Erdkunde lorsqu’il rédigeait à lui seul sa grande encyclopédie, le plus beau monument géographique des siècles, c’est que la terre est le corps de l’humanité, et que l’homme, a son tour, est l’âme de la terre.
A mesure que les peuples se sont développés en intelligence et en liberté, ils ont appris à réagir sur cette nature extérieure dont ils subissaient passivement l’influence ; devenus, par la force de l’association, de véritables agens géologiques, ils ont transformé de diverses manières la surface des continens, changé l’économie des eaux courantes, modifié les climats eux-mêmes. […]
L’action de l’homme donne au contraire la plus grande diversité d’aspect à la surface terrestre. D’un côté elle détruit, de l’autre elle améliore ; suivant l’état social et les progrès de chaque peuple, elle contribue tantôt à dégrader la nature, tantôt à l’embellir. Campé comme un voyageur de passage, le barbare pille la terre ; il l’exploite avec violence sans lui rendre en culture et en soins intelligens les richesses qu’il lui ravit ; il finit même par dévaster la contrée qui lui sert de demeure et par la rendre inhabitable. L’homme vraiment civilisé, comprenant que son intérêt propre se confond avec l’intérêt de tous et celui de la nature elle-même, agit tout autrement. Il répare les dégâts commis par ses prédécesseurs, aide la terre au lieu de s’acharner brutalement contre elle, travaille à l’embellissement aussi bien qu’à l’amélioration de son domaine. Non seulement il sait, en qualité d’agriculteur et d’industriel, utiliser de plus en plus les produits et les forces du globe ; il apprend aussi, comme artiste, à donner aux paysages qui l’entourent plus de charme, de grâce ou de majesté. Devenu « la conscience de la terre, » l’homme digne de sa mission assume par cela même une part de responsabilité dans l’harmonie et la beauté de la nature environnante. […]
La surface de la terre offre de nombreux exemples de dévastations complètes. En maints endroits, l’homme a transformé sa patrie en un désert, et « l’herbe ne croit plus où il a posé ses pas. » Une grande partie de la Perse, la Mésopotamie, l’Idumée, diverses contrées de l’Asie-Mineure et de l’Arabie, qui «découlaient de lait et de miel» et qui nourrissaient jadis une population très considérable, sont devenues presque entièrement stériles, et sont habitées par de misérables tribus vivant de pillage et d’une agriculture rudimentaire. […]
L’homme, qui par ses travaux peut ainsi troubler l’économie des rivières, dérange également l’harmonie des climats. Sans mentionner l’influence toute locale que les villes exercent en élevant la température et malheureusement aussi en viciant l’atmosphère, il est certain que la destruction des forêts et la mise en culture de vastes étendues ont pour conséquence des modifications appréciables dans les diverses saisons. Par ce fait seul que le pionnier défriche un sol vierge, il change le réseau des lignes de température, isothère, isochimène, isotherme, qui passent à travers la contrée. Dans plusieurs districts de la Suède dont les forêts ont été récemment coupées, les printemps de la période actuelle commenceraient, d’après Absjorasen, environ quinze jours plus tard que ceux du siècle dernier. Aux États-Unis, les défrichemens considérables des versans alléghaniens semblent avoir eu pour résultat de rendre la température plus inconstante et défaire empiéter l’automne sur l’hiver et cette dernière saison sur le printemps. On peut dire d’une manière générale que les forêts, comparables à la mer sous ce rapport atténuent les différences naturelles de température entre les diverses saisons tandis que le déboisement écarte les extrêmes de froidure et de chaleur et donne une plus grande violence aux courans atmosphériques.