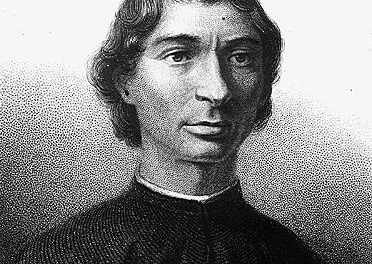La richesse de l’Eglise…

Récit d’un témoin oculaire (chronique italienne) à propos d’une réception donnée par le cardinal* Annibal de Ceccano en l’honneur du pape dans sa livrée* des environs d’Avignon.
« On introduisit le pape dans une salle tendue, du plancher au plafond, de tapisseries d’une grande richesse. Le sol était recouvert d’un tapis velouté. Le lit de parade était garni de velours cramoisi très fin, doublé d’hermine blanche, de draps d’or et de soie. À table, le service fut fait par quatre chevaliers et douze écuyers* du pape, qui reçurent chacun de l’amphitryon* : les premiers, une riche ceinture d’argent et une bourse valant vingt-cinq florins d’or ; les écuyers, une ceinture, et une bourse d’une valeur de douze florins. Cinquante écuyers appartenant au cardinal Ceccano assistaient les chevaliers et les écuyers pontificaux*. Le menu comprenait neuf services qui se décomposaient chacun en trois plats, soit au total vingt-sept plats. On vit apparaître, entre autres, une sorte de château fort renfermant un cerf gigantesque, un sanglier, des chevreuils, des lièvres, des lapins. Après le quatrième service, le cardinal fit offrir au pape un destrier* blanc, d’une valeur de quatre cents florins d’or, et deux anneaux ornés, l’un d’un énorme saphir, l’autre d’une non moins énorme topaze*. Chacun des seize cardinaux reçut un anneau enrichi de pierres fines ; il en fut de même des vingt prélats ou seigneurs laïques. Les douze jeunes clercs* de la maison pontificale reçurent une ceinture et une bourse d’une valeur de vingt-cinq florins d’or ; les vingt-quatre sergents d’armes : une ceinture valant trois florins. (…)
Après le cinquième service, on apporta une fontaine surmontée d’une tour et d’une colonne d’où s’échappait cinq espèces de vin. Les margelles de cette fontaine étaient ornées de paons, de faisans, de perdrix, de grues et de divers autres volatiles. L’intervalle entre le septième et le huitième service fut occupé par un tournoi qui eut lieu dans la salle même du festin, qui se termina par un concert. Au dessert, on apporta deux arbres, l’un qui semblait en argent, garni de pommes, de poires, de figues, de pêches et de raisins d’or ; l’autre, vert comme un laurier, garni de fruits confits multicolores. »
Cité dans R. DARBOIS, Quand les papes régnaient en Avignon, Paris, Fayard, 1981, p. 89-90.
Vocabulaire :
. amphitryon : hôte qui offre à dîner.
. cardinal : religieux de haut rang dans l’Église catholique membre du Sacré
. collège (électeur et conseiller du pape).
. clerc : membre du clergé (ensemble des ecclésiastiques d’une Église).
. destrier : cheval de combat au Moyen Âge.
. écuyer : gentilhomme au service d’un chevalier.
. livrée : palais édifié pour un cardinal.
. pontificaux : au service du pape.
. topaze : pierre précieuse.
—-
Un courant mystique : l’imitation de Jésus-Christ
Au XVe siècle, à partir de la Hollande, un courant spirituel, appelé devotio moderna, gagne tout le nord-ouest de l’Europe. D’inspiration mystique, il préconise pour le fidèle la recherche d’un contact direct avec Dieu par la prière et par une piété simple et affective. Cette spiritualité s’exprime bien dans l’Imitation de Jésus-Christ. Au cours des siècles suivants, cet ouvrage est demeuré un grand classique spirituel, apprécié aussi bien par les catholiques que par les protestants :
» J’écouterai ce que le Seigneur Dieu dit en moi.
Heureuse l’âme qui entend le Seigneur lui parier intérieurement, et qui reçoit de sa bouche la parole de consolation !
Heureuses les oreilles toujours attentives à recueillir ce souffle divin, et sourdes au bruit du monde !
Heureuses, encore une fois, les oreilles qui écoutent non la voix qui retentit au-dehors, mais la vérité qui enseigne au-dedans ! (…)
Heureux ceux qui pénètrent les mystères que le coeur recèle, et qui, par des exercices de chaque jour, tâchent de se préparer de plus en plus à comprendre les secrets du Ciel !
Heureux ceux dont la joie est de s’occuper de Dieu et qui se dégagent de tous les embarras du siècle !
Considère ces choses, ô mon âme, et ferme la porte de tes sens, afin que tu puisses entendre ce que le Seigneur ton Dieu dit en toi.
Voici ce que dit ton bien-aimé : je suis votre salut ; votre paix et votre vie.
Demeurez près de moi, et vous trouverez la paix. Laissez là tout ce qui passe. Ne cherchez que ce qui est éternel. (…)
Renoncez à tout, et occupez-vous de plaire à votre Créateur et de lui être fidèle, afin de parvenir à la vraie béatitude. »
Extrait de L’imitation de Jésus-Christ, trad. Lamennais, 111, 1-2.
—-
Un « précurseur » : Savonarole
– Extrait d’un sermon de Savonarole prononcé le dimanche de l’Avent (dimanche avant Noël) de 1493.
« Les prêtres nous rebattent les oreilles d’Aristote, de Platon, de Virgile et de Pétrarque, et ils n’ont cure du salut des âmes. Pourquoi tant de livres au lieu du livre unique qui renferme la loi et la vie ? Chrétiens, vous devriez toujours avoir sur vous l’Evangile, j’entends non pas le livre mais son esprit. (…)
La charité chrétienne n’habite point dans les livres. Les véritables livres du Christ sont les apôtres et les saints, et la véritable vie consiste dans l’imitation de sa vie. Mais de nos jours ces hommes sont devenus des livres du diable. Ils parlent contre l’orgueil et l’ambition, et ils y sont plongés jusque par-dessus les oreilles. Ils prêchent la chasteté et ils entretiennent des maîtresses. Ils commandent l’observation du jeûne et ils vivent dans le luxe. (…)
Les prélats [= membres du haut clergé] se rengorgent dans leur dignité et méprisent les autres; ils prétendent qu’on se courbe devant eux; ils veulent occuper les premières chaires [= postes] dans les écoles et les églises d’Italie. Ils aiment qu’on aille à leur rencontre, le matin, sur le marché, qu’on les salue du nom de « maître »(…). Ils n’ont de pensées que pour la terre et pour les choses terrestres; le souci des âmes ne leur tient plus au coeur. Dans les premiers temps de l’Eglise, les calices [= vase sacré pour le vin de messe] étaient de bois et les prélats d’or; aujourd’hui l’Eglise a des calices d’or et des prélats de bois. »
Le moine Savonarole, devenu maître de la ville de Florence grâce à l’appui populaire, entrepris d’imposer un ordre moral très rigoureux (1494-1498). En conflit avec le pape AlexandreVI Borgia, il fut finalement brûlé comme hérétique en 1498. Il ne remit jamais en cause l’orthodoxie catholique contrairement à Luther.
—-
La légende noire du pape Alexandre VI (1492 – 1503)
« 1492. – Le successeur d’Innocent fut Rodrigue Borgia, natif de Valence, une des cités royales d’Espagne, cardinal parmi les plus anciens et les plus importants de la cour de Rome, élevé cependant au pontificat par les dissensions qui régnaient entre les cardinaux Ascanio Sforza et Giuliano de Saint-Pierre-aux-Liens (1), mais bien davantage – exemple sans précédent pour l’époque – parce qu’il acheta ouvertement, partie avec de l’argent et partie en promettant certains de ces offices et bénéfices, qui étaient considérables, les voix de nombreux cardinaux qui, au mépris de l’enseignement évangélique, vendirent sans vergogne la possibilité de faire commerce des trésors sacrés au nom de l’autorité divine, dans la partie la plus sainte du temple. Ce fut le cardinal Ascanio qui incita nombre d’entre eux à un marché si abominable, moins par la persuasion et les prières que par l’exemple ; en effet, corrompu par l’appétit infini des richesses, il obtint pour lui-même, comme prix de tant de scélératesse, la vice-chancellerie – principale charge de la cour de Rome – des églises, des châteaux, et, à Rome, le palais de la Chancellerie, rempli de meubles d’une très grande valeur. Mais il n’échappa pour autant, ni, par la suite, au jugement divin, ni, alors, à l’infamie et à la juste haine des hommes, pleins d’effroi et d’horreur devant cette élection, parce qu’elle procédait de manoeuvres si détestables, et aussi parce que la nature et les habitudes de la personne élue étaient, pour bonne part, connues de beaucoup ; il est notoire que le roi de Naples (2), entre autres, tout en dissimulant en public sa douleur, fit savoir à la reine, son épouse – en versant des larmes qu’il avait coutume de retenir même pour la mort d’un de ses enfants -, qu’on avait élu un pape qui serait très malfaisant pour l’Italie et toute la chrétienté : prédiction, au vrai, loin d’être indigne de la prudence de Ferdinand. Car Alexandre VI (ainsi voulut être nommé le nouveau pape) était un homme d’une subtilité et d’une sagacité singulières, d’excellent conseil, d’une force de persuasion étonnante, d’une diligence et d’une habileté incroyables dans toutes les affaires graves ; mais ces vertus étaient dépassées, et de loin, par les vices : moeurs très obscènes, nulle sincérité, nulle vergogne, nulle vérité, nulle foi, nulle religion, avarice insatiable, ambition immodérée, cruauté plus que barbare et désir très ardent de grandir, par tous les moyens, ses enfants, qui étaient nombreux ; et, parmi eux (afin que pour exécuter les mauvais conseils on ne manquât pas de mauvais instruments) d’aucuns n’étaient pas, par certains côtés, moins détestables que leur père (…). Chez le pape, sur le courroux et sur tout autre sentiment, prévalait la convoitise effrénée de grandir ses enfants au point d’être, parmi tous ces papes qui pour voiler un peu leur infamie les appelaient d’ordinaire leurs neveux, le premier à les appeler ses enfants et à les présenter à la face du monde comme tels.
1497. – Mais il ne put échapper aux malheurs domestiques, car sa maison fut affligée par des accidents tragiques, fruits d’une luxure et d’une cruauté qui auraient suscité l’horreur même dans une contrée barbare. Il avait en effet, dès le début de son pontificat, eu pour dessein de transférer tout son pouvoir temporel à son aîné, le duc de Gandia (3) ; mais le cardinal de Valence (4) – qui, étranger par nature à la profession sacerdotale, aspirait au métier des armes et ne pouvait tolérer que celui-ci fût réservé à son frère, ni supporter que ce dernier fût davantage dans les bonnes grâces de dame Lucrèce, leur soeur à tous deux – , poussé par la luxure et l’ambition (ministres puissants de toute grande scélératesse), le fit, en secret, tuer puis jeter dans le Tibre, une nuit que le duc chevauchait seul dans Rome. Le bruit courait également (si tant est qu’une telle énormité soit digne de foi) que non seulement les deux frères mais le père lui-même se partageaient l’amour de dame Lucrèce : dès qu’on le fit pape, il enleva sa fille à son premier mari (5), trop inférieur à leur nouvelle condition, et la maria à Giovanni Sforza, seigneur de Pesaro mais, ne supportant pas d’avoir aussi le mari pour rival, il fit dissoudre ce mariage déjà consommé après avoir, devant des juges délégués par lui, fait prouver par de faux témoignages puis confirmer par une sentence que Giovanni était pas nature impuissant et inapte au coït (6). La mort du duc de Gandia affligea démesurément le pape, brûlant d’un amour qu’aucun père n’avait jamais ressenti pour ses enfants et peu habitué à éprouver les coups de la fortune, car depuis son enfance jusqu’alors il était clair qu’il n’avait connu, en toutes choses, que de très heureux succès ; il fut tellement ému qu’au consistoire, après s’être amèrement lamenté sur son malheur, sans retenir son émotion et ses larmes, et avoir condamné beaucoup de ses propres actions et la façon dont il avait vécu jusqu’à ce jour, il affirma avec une grande conviction qu’il entendait à l’avenir, se gouverner suivant d’autres pensées et d’autres moeurs ; et il chargea certains cardinaux de réformer avec lui les moeurs et les règles de la curie. Il s’y employa pendant quelques jours, mais, comme on commençait à voir qui était l’auteur de la mort de son fils, dont on pensait au début qu’elle pouvait être l’oeuvre du cardinal Ascanio ou des Orsini, il renonça d’abord à ses bonnes intentions puis à ses larmes et s’en retourna, avec moins de freins que jamais, aux pensées et aux agissements dans lesquels il avait consumé sa vie jusqu’à ce jour (…).
1503. – Mais voilà qu’au comble de leurs plus grandes espérances (tant sont vaines et trompeuses les pensées des hommes) le pape, alors qu’il était allé dîné dans une vigne (7) proche du Vatican pour échapper aux grandes chaleurs, est soudainement transporté au palais pontifical et donné pour mort, et qu’aussitôt après on amène et on donne pour mort son fils. Le lendemain, dix-huitième jour d’août, son cadavre est transporté selon l’usage, dans l’église Saint-Pierre, noir, enflé et affreux, indices manifestes du poison ; mais le Valentinois, grâce à la vigueur de son âge et aux remèdes puissants et efficaces contre le poison qu’il avait aussitôt absorbés, eut la vie sauve, mais resta accablé par une longue et grave maladie. On a toujours cru que l’origine de cet événement était le poison ; et selon la version la plus commune, on raconte ainsi le déroulement de l’affaire : le Valentinois, qui devait se rendre au même repas, avait décidé d’empoisonner Adriano, cardinal de Corneto, dans la vigne duquel ils devaient dîner (car il est chose notoire que c’était une habitude fréquente pour son père et lui-même d’employer du poison, non seulement pour se venger de leurs ennemis ou pour s’assurer de ceux qui leur étaient suspects, mais même pour satisfaire leur ambition scélérate de dépouiller de leurs biens les personnes riches, cardinaux et autres courtisans (…)) ; on raconte donc que le Valentinois avait envoyé à l’avance certains fiasques de vin empoisonné et les avait fait remettre à un domestique qui n’était pas au fait de la chose, avec consigne de ne les donner à personne ; mais le pape survint par hasard à l’heure du dîner, et, accablé par la soif et les chaleurs excessives, demanda qu’on lui donnât à boire : comme les provisions pour dîner n’étaient pas encore arrivées du palais, ce domestique, qui croyait qu’on le réservait parce que c’était un vin de très grand prix, lui donna à boire ce vin qu’avait envoyé par avance le Valentinois ; celui-ci, arrivant alors que le pape buvait, se mit aussi à boire du même vin.
Tout Rome afflua à Saint-Pierre avec une incroyable allégresse devant le cadavre d’Alexandre VI, personne ne pouvant assez se repaître de voir que s’était éteint ce serpent qui, par son ambition immodérée et sa funeste perfidie, et par tous les exemples d’une horrible cruauté, d’une monstrueuse luxure et d’une cupidité inouïe (ne vendait-il pas sans distinction les choses sacrées et les profanes ?) avait infecté de poison le monde entier ; et néanmoins, il s’était élevé avec une très rare et presque constante prospérité, depuis sa première jeunesse jusqu’au dernier jour de sa vie, désirant toujours de très grandes choses et obtenant plus qu’il ne désirait. »
Francesco GUICCIARDINI, Histoire d’Italie, 1492 – 1534, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1996, t. I, p. 8 – 9, 16 ; p. 249 – 250 ; p. 426 – 427.
Notes :
1) Ascanio Sforza était le frère de Ludovic Sforza, maître puis duc (1494 – 1500) de Milan ; Giuliano della Rovere, cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens, était le neveu du pape Sixte IV ; il fut pape de 1503 à 1513 sous le nom de Jules II.
2) Ferdinand Ier d’Aragon (1423 – 1494), roi de Naples à partir de 1458.
3) Pedro Luis Borgia (v. 1467 – 1488), fait duc de Gandia (Espagne) par le roi Ferdinand II le Catholique.
4) César Borgia (v. 1475 – 1507), fait cardinal de Valence en 1493, puis, après avoir abandonné cette dignité, duc de Valentinois.
5) Lucrèce Borgia (1480 – 1519) fut mariée trois fois, au gré des projets politiques de son père et de son frère.
6) L’impuissance du mari était une cause valable d’annulation du mariage chrétien par les cours ecclésiastiques.
7) Ce terme désigne une propriété de campagne.
—-
Un pape guerrier : Jules II (1503 – 1513)
« 1503. – Une fois dissipée, au cours de ces événements, la matière des scandales, les tumultes dans Rome se dissipèrent de même, de sorte que l’on commença à procéder dans le calme à l’élection du nouveau pape, car Pie III, ne décevant pas les espoirs conçus par les cardinaux lors de sa désignation, était, vingt-six jours après, passé à une vie meilleure (1). Après sa mort, comme le collège des cardinaux avait différé de quelques jours l’entrée au conclave, parce qu’il voulait que sortissent d’abord de Rome les Orsini qui y étaient restés pour compléter leurs troupes, l’élection fut décidée hors du conclave ; en effet, le cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens, fort de ses amis, de sa réputation et de ses richesses, avait attiré sur son nom les voix de cardinaux si nombreux que n’osèrent pas s’y opposer ceux qui étaient d’avis contraire, et qu’entrant au conclave il était déjà sûr et certain d’être pape. Ainsi (événement dont la mémoire des hommes ne connaissait aucun exemple), sans même que l’on fermât le conclave, cette nuit-là, qui était la dernière nuit d’octobre, il fut élevé au pontificat. Que ce fût à cause de son premier prénom – Giuliano – ou, comme le voulut la rumeur, pour signifier la grandeur de ses desseins, ou pour ne pas le céder, jusque dans l’excellence du nom, à Alexandre VI, il prit le nom de Jules, deuxième du nom parmi tous les papes passés.
Grande fut certainement la stupéfaction universelle de voir que le pontificat avait été attribué, dans un telle union des coeurs, à un cardinal dont chacun connaissait le naturel difficile et redoutable, et qui, d’esprit inquiet depuis toujours et ayant consumé son âge en de continuels travaux, avait nécessairement offensé beaucoup de gens et entretenu des haines et des inimitiés avec nombre de grands personnages. Mais, par ailleurs, les raisons pour lesquelles toutes les difficultés avaient été surmontées pour l’élever à un tel rang apparurent clairement. En effet, comme il avait été longtemps un cardinal très puissant, qu’il avait toujours surpassé tous les autres en magnificence et qu’il était d’un rare courage, non seulement il avait de nombreux amis, mais depuis longtemps beaucoup d’autorité à la curie, et il avait le renom de principal défenseur de la dignité et de la liberté de l’Église. Mais plus encore, il fut élevé au pontificat en promettant sans modération ni limite à des cardinaux, à des princes, à des barons et à quiconque pouvait lui être utile dans cette affaire tout ce qu’ils purent demander. Et il eut en outre la faculté de distribuer de l’argent et de nombreux bénéfices et dignités ecclésiastiques – car sa réputation de libéralité faisait que beaucoup accourraient spontanément pour lui offrir d’utiliser à sa guise leur argent, leur nom, leurs offices et leurs bénéfices ; et personne ne considéra que ses promesses dépassaient beaucoup ce qu’ensuite, une fois pape, il pourrait ou voudrait tenir, car il avait longtemps eu un tel renom d’homme entier et sincère qu’Alexandre VI, son ennemi juré, qui le vitupérait pour toutes les autres choses, reconnaissait qu’il était un homme franc ; sachant que nul ne trompe facilement les autres que celui qui a l’habitude et la réputation de ne jamais les tromper, ce fut un éloge qu’il se soucia peu d’entacher, pour obtenir le pontificat.
1511. – (…) Mais au début de l’année nouvelle se produisit une chose inattendue, digne de rester dans les mémoires et jamais vue dans tous les siècles passés. En effet, comme il semblait au pape que le siège de La Mirandola traînait en longueur et qu’il l’attribuait en partie à l’impéritie des capitaines et en partie à leur déloyauté (…), il décida de hâter les choses par sa présence ; il faisait passer son impétuosité et l’ardeur de sa nature avant toute autre considération et n’était pas davantage retenu par la majesté de sa charge qui rendait si indigne qu’un pontife romain allât en personne aux armées pour attaquer des villes tenues par des chrétiens, ni par le grand danger qu’il y avait – en méprisant l’opinion unanime et le jugement que tous porteraient sur lui – à fournir un prétexte, et presque une justification à ceux qui, faisant montre, avant tout, d’estimer que son gouvernement était pernicieux à l’Église et ses défauts scandaleux et incorrigibles, oeuvraient pour convoquer le concile et dresser les princes contre lui. Ces propos retentissaient dans toute la curie (…). Mais les prières de tous étaient vaines et vains les arguments. Il partit de Bologne le deuxième jour de janvier, accompagné par trois cardinaux ; arrivé au camp, il logea dans la petite maison d’un paysan, exposé au feu de l’artillerie ennemie, car elle n’était pas à plus de deux arbalétrées des remparts de La Mirandola. Là, prenant de la peine et mettant à l’épreuve son corps aussi bien que son esprit et son autorité, il était sans cesse à cheval et parcourait le camp en tous sens, pressant ses soldats de finir d’installer l’artillerie, dont une seule partie avait été, à ce jour, mise en batterie, car presque toutes les actions militaires étaient gênées par le temps très âpre, par la neige qui ne cessait de tomber, et parce qu’aucune diligence ne suffisait à empêcher les sapeurs de s’enfuir, puisqu’ils subissaient, outre les rigueurs du temps, les nombreuses salves d’artillerie des assiégés. (…) C’était certainement chose remarquable et très nouvelle aux yeux des hommes que de voir le roi de France, prince séculier, encore jeune, et d’une constitution alors très robuste, élevé depuis son plus jeune âge dans le métier des armes, se reposer en ses appartement et laisser à ses capitaines le soin de conduire une guerre qui était, avant tout, dirigée contre lui. Tandis qu’en face, on pouvait voir le souverain pontife, vicaire du Christ sur la terre, vieux, malade, élevé au milieu des plaisirs et des commodités, se rendre à cette guerre contre des chrétiens, qu’il avait lui-même provoquée, et mener lui-même le siège d’une ville obscure ; là, s’exposant, tel le capitaine d’une armée, aux peines et aux dangers, il ne gardait que l’habit et le nom de pape.
1513. – (…) Conservant en toute chose sa constance et sa sévérité coutumières, gardant le même jugement et la même force d’âme qui étaient les siens avant sa maladie, il reçut dévotement les derniers sacrements et, la nuit qui précédait le 21 février, alors que le jour allait poindre, le cours de ses travaux sur cette terre s’acheva. Ce fut un prince d’un rare courage et d’une constance inestimables, mais son impétuosité et ses projets étaient démesurés et, de ce fait, ce furent la révérence dont jouit l’Église, la discorde entre les princes et la condition des temps plutôt que sa modération et sa prudence qui l’empêchèrent de choir. Certes, il eût été digne de la plus grande gloire s’il s’était agi d’un prince séculier ou s’il avait eu, pour exalter, par l’art de la paix, la grandeur de l’Église dans les choses spirituelles, le même soin et la même application que pour l’exalter, par l’art de la guerre, dans les choses temporelles. Néanmoins, plus que pour tous ses prédécesseurs, sa mémoire reste très illustre et honorée, surtout auprès de ceux qui, en un temps où sont perdus les vrais noms des choses et où sont confondues la façon de les peser droitement, estiment que le devoir des papes est d’agrandir, par les armes et le sang chrétien, le domaine du Siège apostolique plutôt que de peiner, par l’exemple d’une bonne vie ou en corrigeant et soignant la corruption des moeurs, pour le salut des âmes, au service duquel il se font gloire que le Christ les ait fait ses vicaires sur la terre ».
Francesco GUICCIARDINI, Histoire d’Italie, 1492 – 1534, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1996, t. I, p. 435 – 436 ; p. 687 – 688 ; p. 852.
1) Le 18 octobre 1503.
—-
Léon X : une occasion manquée de réformer l’Église (1513 – 1521)
« 1513. – (…) Quand les funérailles se furent déroulées selon l’usage, vingt-quatre cardinaux entrèrent tranquillement en conclave (…). Le premier soin du conclave fut de modérer par des règles très strictes l’autorité du futur pape, car ils disaient que le pape défunt l’avait exercée immodérément ; pourtant, peu après (car certains hommes n’ont pas la hardiesse de s’opposer au prince et d’autres désirent gagner sa bienveillance), elles furent presque toutes annulées, par ces mêmes cardinaux. Le septième jour, ils élurent pape, sans la moindre discordance, Jean, cardinal de Médicis, qui prit le nom de Léon X ; il était âgé de trente-sept ans, ce qui ne laissa pas d’étonner, eu égard aux habitudes du passé : la principale raison de cette élection fut l’industrie des jeunes cardinaux qui, bien longtemps auparavant, s’étaient entendus entre eux pour faire pape, pour la première fois, l’un d’entre eux. Presque toute la chrétienté se réjouit fort de cette élection : on était universellement convaincu que ce serait un très excellent pape, car le souvenir de la valeur de son père était dans toutes les mémoires et partout on vantait sa renommée de bénignité et de libéralité ; on le tenait pour un homme chaste et de moeurs très intègre et on espérait qu’à l’exemple de son père il aimerait les lettrés et les esprits illustres ; cet espoir était d’autant plus grand que son élection s’était déroulée avec probité, sans qu’on eût recours à la simonie, sans qu’on soupçonnât la moindre tache (…).
Le premier acte du nouveau pontificat fut le couronnement, qui eut lieu selon l’usage de ses prédécesseurs dans l’Église Saint-Jean de Latran, sa maison et sa cour aussi bien que tous les prélats et de nombreux seigneurs qui étaient accourus déployant une si grande pompe que chacun convint que, depuis le déferlement des barbares, Rome n’avait jamais connu de jour plus magnifique et superbe que celui-ci. Au cours de cette solennité, ce fut Alphonse d’Este qui porta le gonfalon de l’Église ; il avait obtenu la suspension des censures et s’était rendu à Rome avec des fermes espoirs d’accommoder ses affaires grâce à la mansuétude du pape (1). Ce fut Jules de Médicis qui porta celui de l’ordre de Rhodes (2) : monté sur un destrier, il était armé de pied en cap ; sa volonté le poussait vers le métier des armes, mais le destin l’attirait vers la vie sacerdotale, où il allait être un exemple étonnant de la variété de la fortune. Et ce jour était encore plus mémorable et saisissant si l’on considérait que celui qui recevait maintenant, avec une telle pompe, une telle splendeur, les insignes d’une telle dignité avait été à la même date, l’année précédente, fait misérablement prisonnier (3). Cette magnificence renforça les espoirs que le vulgaire fondait sur lui : chacun prévoyait que Rome serait heureuse sous un pape d’une telle libéralité et d’une telle splendeur, car on était certain qu’il avait dépensé plus de cent mille ducats dans cette cérémonie ; mais les hommes prudents eussent désiré plus de gravité et de modération, estimant qu’une telle pompe ne convenait pas aux papes et qu’il n’était pas conforme à la condition des temps présents de dissiper inutilement l’argent accumulé par son prédécesseur.
1517. – L’âpreté de cette affaire (4) contraignit le pape à songer à la création de nouveaux cardinaux, car il savait bien qu’il s’était aliéné presque tout le collège par les supplices infligés et pour d’autres raisons : agissant sans modération aucune, il nomma en une seule matinée trente et un cardinaux en consistoire, le collège y consentant par crainte et non de sa propre volonté. L’importance de ce nombre lui donna la possibilité d’atteindre des buts multiples et de choisir des hommes de toute qualité.
En effet, il promut deux enfants de ses soeurs et certains de ceux qui avaient été à son service depuis qu’il était pape ou avant qu’il ne le fût et que lui-même et le cardinal de Médicis appréciaient, mais qui n’avaient aucun titre pour prétendre accéder à une telle dignité ; dans de nombreux cas, il donna satisfaction à des grands princes en créant les cardinaux sur leurs instances ; il en désigna beaucoup pour l’argent, car il se trouvait fort dépourvu et dans le plus grand besoin. Parmi ces nouveaux cardinaux, quelques-uns étaient illustres pour la renommée de leur science et il y avait trois généraux (grade suprême chez ces religieux) des ordres de saint Augustin, saint Dominique et saint François ; en outre, fait très rare en une même promotion de cardinaux, deux d’entre eux étaient de la famille des Trivulzio : le pape avait choisi l’un parce que c’était son camérier et par désir de donner satisfaction à Gianiacopo, et l’autre à cause de sa réputation de savant – secourue par quelque somme d’argent. Mais ce qui a suscité le plus d’étonnement, ce fut la nomination de Franciotto Orsini, de Pompeo Colonna et de cinq autres Romains des plus grandes familles qui appartenaient à l’une ou l’autre faction ; décision contraire aux choix de son prédécesseurs, elle fut considérée comme imprudente et eut une issue bien peu heureuse pour les siens. En effet, la grandeur des barons de Rome signifiant toujours l’abaissement et le tourment des papes, Jules, lorsque étaient morts les anciens cardinaux de ces familles qu’Alexandre VI avait persécutées pour les dépouiller de leurs domaines, n’avait jamais voulu redonner à aucune d’entre elles cette dignité. Or, Léon fit le contraire sans aucune modération, d’autant qu’on ne pouvait pas dire qu’il y eût été poussé par leurs mérites, puisque Franciotto fut promu à la dignité cardinalice alors qu’il professait l’art militaire et puisque aurait du nuire à Pompeo le souvenir où, à l’occasion de la maladie [de Jules] et bien qu’il fût évêque, il avait tenté de soulever le peuple romain contre la seigneurie des prêtres avant de se rebeller ouvertement contre ce même pape les armes à la main, ce pourquoi Jules l’avait privé de la dignité épiscopale.
1521. – La guerre en était là, et le pape et César (5) nourrissaient de grands espoirs de consolider leur victoire (…). Mais d’un accident inopiné naquirent tout à coup des pensées inopinées : le 1er décembre, le pape Léon mourut subitement. Alors qu’il se trouvait dans sa villa de la Magliana (6), où il se retirait souvent pour se reposer, il avait reçu la nouvelle de la prise de Milan et en avait conçu un immense plaisir ; la nuit, il avait été pris d’une légère fièvre, et s’était fait transporter le lendemain à Rome, où, bien que les médecins trouvassent bénin le début de sa maladie, il mourut en quelques jours. On soupçonna fortement un empoisonnement, provoqué, pensa-t-on, par Bernabo Malespina, son camérier, qui était chargé de lui donner à boire. Bien que ce dernier eût été emprisonné sur ce soupçon, l’affaire n’alla pas plus loin parce que le cardinal de Médicis le fit libérer dès son arrivée à Rome pour ne pas créer de motif de brouille supplémentaire avec le roi de France, car la rumeur courait, dont la source et les fondements étaient incertains, que c’était sur son ordre que Bernabo avait versé le poison. S’il faut en croire l’opinion générale, Léon mourut au faîte de la gloire et de la félicité, non seulement parce que la victoire de Milan l’avait délivré de dangers et de dépenses considérables (…) mais encore parce qu’il avait appris quelques jours avant sa mort la prise de Plaisance, et, le jour même où il mourut, celle de Parme (…). C’était un prince chez qui il y avait beaucoup à louer et beaucoup à blâmer, et qui trompa grandement les espoirs mis en lui quand il fut élevé au pontificat, parce qu’il montra plus de prudence mais beaucoup moins de bonté que tous ne l’avaient estimé. »
Francesco GUICCIARDINI, Histoire d’Italie, 1492 – 1534, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1996, t. I, p. 852 – 854 ; t. II, p. 120 – 121 ; p. 200.
Notes :
1) Alphonse d’Este (1476 – 1534), duc de Ferrare depuis 1505, allié de la France, avait subi les attaques militaires de Jules II, qui l’avait également excommunié. Il espérait que le nouveau pape accepterait de conclure la paix.
2) L’ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ordre militaire fondé au XIIe siècle lors des croisades. Chassés de Terre sainte puis de Chypre, les Hospitaliers s’étaient installée à Rhodes en 1309 ; après la prise de l’île par les Turcs en 1522, ils se replièrent sur Malte.
3) Le cardinal de Médicis avait été fait prisonnier par les Français à la bataille de Ravenne.
4) Le pape avait récemment découvert un complot visant à l’empoisonner ; le principal coupable, le cardinal Alfonso Petrucci, fut étranglé dans sa prison, et ses deux complices écartelés.
5) Titre donné à l’empereur du Saint-Empire romain germanique, ici Charles Quint.
6) Sur le Tibre, à dix kilomètres au sud-ouest de Rome.
—-
Reforma in capite : décret du 5e concile de Latran sur la réforme de la Curie (1514)
Session IX, 5 mai 1514
Léon X : Bulle de réforme de la curie.
» Des Cardinaux
Puisque les cardinaux de la sainte Église romaine l’emportent sur tous les autres en honneur et en dignité dans l’Église elle-même après le souverain pontife, il convient et il est nécessaire qu’ils brillent plus que tous les autres par la pureté de leur vie et par la splendeur de leurs vertus. Pour cette raison, non seulement Nous les exhortons et Nous les avertissons, mais encore Nous décidons et ordonnons que désormais tous les cardinaux existant présentement, conformément à l’enseignement de l’Apôtre, vivent si sobrement, si chastement et si pieusement [Tite, 2, 12], qu’ils évitent non seulement le mal, mais même toute apparence de mal, et qu’ils brillent ainsi au regard des hommes.
En premier lieu, que chacun rende honneur à Dieu par ses oeuvres. Qu’ils soient tous éveillés et attentifs pendant les offices divins et lors de la célébration de la messe ; qu’ils aient leurs chapelles dans un endroit honnête, comme ils ont l’habitude de le faire. Que leurs maison, leur famille, leur table, leur habillement ne soient répréhensibles ni par le faste, ni par la pompe, ni par le superflu, ni de quelque autre façon, évitant ainsi l’incitation au péché et au dépassement de la mesure ; comme il convient plutôt, qu’ils méritent d’être considérés comme un miroir de modestie et de frugalité. Qu’ils se contentent donc de ce qui exprime la modestie sacerdotale ; qu’ils traitent avec douceur et honneur, tant en public qu’en privé, les prélats et tous les autres dignitaires qui viennent à la curie romaine, et reçoivent pieusement et libéralement les causes de ceux qui se recommandent à Nous et à nos successeurs. (…)
Et, dans l’assistance qu’ils apportent au pontife romain, père commun de tous les fidèles du Christ, il ne convient pas du tout qu’ils fassent acception de personnes ou qu’ils se fassent les avocats de celles-ci. Pour cette raison, Nous décidons que, pour éviter qu’ils ne cèdent à la partialité ils ne se feront contre qui que ce soit les promoteurs ou défenseurs de princes, de communes ou de quelqu’un d’autre, si ce n’est dans la mesure où la justice et l’équité le requièrent, ou l’exigent leur dignité et leur condition ; qu’ils s’adonnent plutôt et qu’ils s’appliquent, en mettant de côté toute passion personnelle, à apaiser et à régler en toute diligence les conflits entre toutes les parties. Qu’ils s’occupent avec piété des justes causes des princes et de tous les autres, en particulier des pauvres et des religieux, et qu’ils viennent en aide, selon leur capacité et les exigences de leur fonction, aux opprimés et à ceux qui sont injustement écrasés.
Qu’ils visitent au moins une fois par an les lieux qui relèvent de leur titre, en personne s’ils sont à la curie, par un vicaire compétent s’ils sont absents. Qu’ils s’enquièrent avec soin des clercs et des populations des églises qui relèvent de leur titre, veillent au culte divin et aux biens desdites églises, examinent avec attention et avant tout les moeurs et la vie des clercs et des paroissiens et les avertissent tous et chacun, avec un sentiment paternel, de vivre avec droiture et honnêteté. (…)
Il n’est pas décent de négliger les parents par affinité ou par le sang, surtout ceux qui le méritent et qui ont besoin de secours ; au contraire, il est juste et louable de les nantir. Pour autant, cependant, Nous n’estimons pas convenable de les combler à ce point d’une multitude de bénéfices ou des revenus ecclésiastiques que d’autres souffrent de cette largesse immodérée et que de là naisse le scandale. Nous statuons donc que les cardinaux ne doivent pas distribuer avec témérité des biens des églises, mais les affecter à des oeuvres saintes et pieuses. (…)
En ce qui concerne les églises, même cathédrales, abbatiales ou celles de prieurés, ou encore tout autre bénéfice ecclésiastique, données en commande à ces mêmes cardinaux, Nous voulons aussi que pour assurer le service des cathédrales, ils leur fournissent sans aucune excuse et mettent tous leurs efforts à leur donner des vicaires dignes ou capables ou des suffragants, selon la coutume, en y joignant un traitement adéquat et convenable. Pour les autre églises ou monastères qu’ils ont en commende, qu’ils pourvoient à un nombre juste de clercs et de chapelains, de religieux ou de moines qui servent Dieu de façon adéquate et louable. Qu’ils préservent aussi dans un état convenable tous les édifices, biens et droits, et qu’ils restaurent ceux qui sont en mauvais état, comme c’est la fonction des bons prélats et commendataires.
Nous statuons aussi que, pour ce qui est du nombre des serviteurs et des chevaux qui sont à leurs frais, lesdits cardinaux usent de circonspection attentive, de sorte que le fait d’en avoir un nombre plus grand que ce que permettent leurs moyens, leur condition et leur dignité ne puisse leur faire une réputation de prodigalité. D’autre part, qu’ils ne soient pas réputés avares ni sordides du fait que, avec des revenus larges et abondants, ils fournissent le vivre à un très petit nombre, alors que la maison des cardinaux doit être ouvertement l’asile, le port et le refuge surtout des hommes vertueux et savants, des nobles pauvres et des personnes honnêtes. Qu’ils soient donc prudents au sujet du comportement et du nombre des serviteurs qu’ils maintiennent, et avant tout circonspects au sujet de leur qualité, de sorte que les vices des autres ne leur fassent pas une mauvaise réputation et de créent des occasions justifiées de déblatérer et de calomnier. (…) Que chacun d’eux veille donc à ce que les prêtres et les lévites portent des vêtement ecclésiastiques convenables, de sorte qu’un membre de sa maison pourvu d’un bénéfice à un titre quelconque et ayant reçu les saints ordres, ne porte pas de vêtement bariolés et ne fasse pas usage d’un habit qui convient peu à l’ordre ecclésiastique. (…)
Et puisqu’il appartient aux cardinaux de s’appliquer principalement aux grandes entreprises, ceux-ci s’efforceront, autant qu’ils le peuvent, d’identifier les régions qui sont atteintes par les hérésies, les erreurs et les superstitions contre la foi vraie et orthodoxe, et où l’enseignement par l’Église des commandements divins est déficient, d’identifier aussi les rois, les princes et les populations qui sont infestées ou qu’ils craignent de voir infester par des guerres. Ils mettront leur soin à les connaître et à Nous rapporter, ainsi qu’au pontife en exercice, les choses de cette sorte, afin que par un effort vigilant, des remèdes appropriés et salutaires puissent être trouvés à ces maux et à ces maladies. (…)
Puisque la fonction de cardinal concerne principalement l’assistance fréquente apportée au pontife romain et aux affaires du Siège apostolique, Nous statuons que, pour cette raison, tous les cardinaux doivent résider à la curie romaine ; ceux qui sont absents y reviendront dans les six mois à compter du jour de la publication de la présente constitution s’ils sont en Italie, ou dans l’année s’ils se trouvent hors d’Italie. Autrement, ils perdront les fruits de leurs bénéfices et les émoluments de tous leurs offices (…), sauf dans le cas de ceux qui pourraient être absent en raison d’une charge imposée par le Siège apostolique, par mandat ou permission du pontife romain, en raison d’une crainte justifiée, d’un empêchement légitime ou de la maladie. (…)
De plus, Nous statuons que les dépenses funéraires des cardinaux ne doivent pas dépasser la somme de mille cinq cents florins tout compté, à moins que la prudence des exécuteurs, sur l’allégation de causes et de raisons justes, ne conduise à dépenser davantage. Les obsèques et la fin du deuil sont fixées au premier et au neuvième jour ; des messes seront célébrées durant l’octave, comme à l’accoutumée.
En raison de la révérence due au Siège apostolique, pour l’utilité et l’honneur communs du pontife et des cardinaux eux-mêmes, afin d’éviter l’occasion de scandales qui pourraient surgir, en vue d’assurer une plus grande liberté des votes du saint sénat et, comme il convient, pour permettre à chaque cardinal d’exprimer librement et impunément, selon Dieu et sa conscience, tout ce qu’il pense, Nous décidons que, sous peine de parjure ou de désobéissance, aucun cardinal ne devra révéler oralement, par écrit ou de quelque façon le vote qu’il aura donné en consistoire, ni rien de ce qui s’y est dit ou fait qui pourrait entraîner haine, préjudice ou scandale à l’endroit de quelqu’un. (…) Si quelqu’un agit à l’encontre de cette décision, en plus des peines mentionnées, il encourra une sentence d’excommunication déjà portée, dont il ne pourra être absous que par Nous-même ou par ledit pontife romain et pour une cause expresse, si ce n’est à l’article de la mort. »
« Concile de Latran V (1512 – 1517) », dans : Les Conciles Œcuméniques. Les décrets. t. II-1. Paris, Editions du Cerf, 1994, p. 1261 – 1269.
—-
Un pape « barbare » : Adrien VI (1522 – 1523)
» 1522. – A cette époque, l’élection du nouveau pape n’était pas encore faite, à cause du retard qu’entraînait la discorde entre les cardinaux, due essentiellement au fait que le cardinal de Médicis, qui aspirait au pontificat, et que rendaient puissant sa réputation de grandeur, ses revenus, et la gloire acquise lors de la prise de Milan, avait rassemblé sur son nom les suffrages de quinze autres cardinaux, animés par des intérêts particuliers, par l’amitié qu’ils avaient pour lui, ou par le souvenir des bienfaits de Léon, et, pour quelques-uns, par l’espoir de le voir prendre le parti de ceux qui auraient été prompts à le soutenir s’il venait lui-même à désespérer de devenir pape. Mais cette ambition rencontrait pourtant beaucoup d’obstacles : de nombreuses personnes pensaient qu’il n’était pas bon de laisser succéder au pape défunt un pape de la même famille, ce qui constituerait un premier exemple de pontificat obtenu par voie de succession ; il avait contre lui les cardinaux plus âgés, qui prétendaient eux-mêmes à cette charge, qui ne pouvaient supporter que fût élu un homme qui n’avait pas cinquante ans, tous les cardinaux qui suivaient le parti français, et même quelques-uns du parti impérial (…) ; quant aux cardinaux qui n’avaient pas été contents de Léon, ils étaient ses ennemis acharnés (…). Un matin, alors que, selon l’usage, se déroulait un vote, on prononça au conclave le nom d’Adrien, cardinal de Tortosa ; celui-ci, un Flamand qui avait été le précepteur de César (1) lorsque ce dernier était enfant, et qui grâce à lui avait été élevé au cardinalat, représentait l’autorité de César en Espagne. La proposition avait été faite pour que la matinée s’écoulât en vain, sans que personne ne fût enclin à l’élire, mais, comme quelques voix se découvrirent en faveur d’Adrien le cardinal de San Sisto (2) ne cessa pratiquement plus de haranguer l’assemblée en faisant l’éloge de ses vertus et de son savoir : quelques cardinaux commencèrent à céder, les autres lui suivirent peu à peu, plus par un élan soudain que par choix délibéré, si bien qu’il fût élu le matin même à l’unanimité, sans que ceux-là mêmes qui l’avaient élu sussent clairement dire pourquoi, au moment où l’Église traversait tant de difficultés et de dangers, ils élisaient un pape barbare, qui résidait si loin de Rome, qui ne devait son crédit ni à ses mérites antérieurs, ni à la fréquentation des autres cardinaux, lesquels connaissaient à peine son nom, qui n’avait jamais vu l’Italie, et qui ne songeait ni n’espérait un jour la voir. Cette extravagance, qu’aucun argument ne pouvait excuser, ils l’imputaient au Saint-Esprit qui, disaient-ils, inspire d’ordinaire le coeur des cardinaux lors de l’élection des papes ; comme si le Saint-Esprit, qui aime par-dessus tout les coeurs purs et les âmes sans tache, ne répugnait point à entrer dans des âmes pleines d’ambition et d’inimaginable cupidité, sujettes presque toutes à l’amour de plaisirs fort raffinés, pour ne pas dire déshonnêtes. Adrien reçut la nouvelle de son élection à Vittoria, en Biscaye : lorsqu’il l’apprit, sans changer le nom qu’il portait, il se fit appeler Adrien VI.
En un tel état de choses, l’Italie, accablée de maux continuels, et effrayée par ceux, plus grands encore, qu’elle entrevoyait dans l’avenir, attendait avec impatience l’arrivée du pape, dont l’autorité pontificale servirait opportunément à calmer de nombreuses discordes et à remédier à de nombreux désordres. César (…) avait supplié le pape de l’attendre à Barcelone, où il voulait se rendre en personne afin de faire acte de soumission et d’adoration, mais Adrien refusa de l’attendre, soit parce qu’il craignît que César, alors encore à l’autre bout de l’Espagne, ne lui fît perdre trop de temps en l’amenant ainsi à voyager à la mauvaise saison (…) soit encore, comme le prétendirent de nombreuses personnes, qu’il ne voulût pas alimenter l’opinion, conçue à son sujet dès le début, selon laquelle il était trop acquis à l’Empereur, ce qui pouvait faire obstacle au dessein qu’il avait formé d’établir la paix universelle entre les chrétiens. Le pape se rendit par mer à Rome, où il entra le 29 août, accueilli par une foule très nombreuse et par toute sa cour. Bien que sa venue fût au plus au point désirée (car Rome, sans pape, ressemble plus à un désert qu’à une ville), son arrivée émut néanmoins grandement tous les esprits, car on savait le pape de nation barbare, sans aucune expérience des affaires d’Italie et de la cour pontificale, et même pas issu d’une de ces nations qu’on long commerce a familiarisées avec l’Italie. A ces tristes pensées vint s’ajouter le fait qu’à son arrivée, la peste se déclara à Rome – ce qui était interprété comme de fort mauvais augure pour son pontificat – et fit des ravages pendant tout l’automne (…). »
Francesco GUICCIARDINI, Histoire d’Italie, 1492 – 1534, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1996, t. I, p. 852 – 854 ; t. II, p. 211 – 212.
1) Charles de Habsbourg, proclamé roi de Castille et d’Aragon en 1516, et élu empereur en 1519 sous le nom de Charles Quint. Tortosa est un diocèse situé dans la couronne d’Aragon.
2) Tommaso da Vio, dit le cardinal Cajetan, général des Dominicains, fait cardinal de San Sisto en1517. Il était très hostile à Luther, qu’il avait rencontré à Augsbourg en 1518.
—-
La Bible à la portée de tous
» Je suis tout à fait opposé à l’avis de ceux qui ne veulent pas que la Bible soit traduite en langue commune pour être lue par les gens du peuple, comme si J’enseignement du Christ était si voilé que seule une poignée de théologiens pouvait le comprendre, ou comme si la religion chrétienne se fondait sur l’ignorance. Je voudrais que les plus humbles des femmes lisent les Évangiles, les épîtres de Paul. Puisse ce livre être traduit en toutes les langues de sorte que les Écossais, les Irlandais, mais aussi les Turcs et les Sarrasins soient en mesure de le lire et de le connaître. (…) Puisse le paysan au manche de sa charrue en chanter des passages, le tisserand à ses lisses* en moduler quelques airs, ou le voyageur alléger la fatigue de sa route avec ses récits. Puissent ceux-ci faire les conversations de tous les chrétiens. (…)
* Lisse métier à tisser.
In ÉRASME, Préface à la traduction du Nouveau Testament, 1516, Éditions Labor et Fides.
Idem plus complet (autre traduction)
La question de la traduction de l’Écriture en langue vulgaire
ERASME, Préfaces à l’édition du Nouveau Testament (1516)
» Le soleil est un bien commun, offert à tout le monde. Il n’en va pas autrement avec la science du Christ ; elle ne repousse personne, sinon celui qui se repousse lui-même par haine de lui-même. Je suis en effet tout à fait opposé à l’avis de ceux qui ne veulent pas que les lettres divines soient traduites en langue vulgaire pour être lues par les profanes, comme si l’enseignement du Christ était si voilé que seule une poignée de théologiens pouvait le comprendre, ou bien comme si le rempart de la religion chrétienne était fait de l’ignorance où on la tiendrait. Les mystères des rois, peut-être valait-il mieux les taire, mais le Christ a voulu que ses mystères à lui fussent répandus le plus possible. Je voudrais que toutes les plus humbles des femmes lisent les évangiles, lisent les épîtres de saint Paul. Puissent ces livres être traduits en toutes les langues, de façon que les Écossais, les Irlandais, mais aussi les Turcs et les Sarrasins soient en mesure de les lire et de les connaître. Tel est le premier stade : les faire connaître par tout moyen. Admettons : beaucoup en riront, mais certains y seront pris. Puisse le paysan au manche de sa charrue en chanter des passages, le tisserand à ses lisses en moduler quelque air, ou le voyageur alléger la fatigue de sa route avec ses récits ; puissent ceux-ci faire les conversations de tous les chrétiens, car nous valons à peu près ce que valent nos conversations de chaque jour. Il faut saisir ce qu’on peut, exprimer ce qu’on peut ; que le second ne jalouse pas qui le précède ; que celui qui va devant encourage qui le suit au lieu de le désespérer. Pourquoi restreindre à quelques-uns une profession commune à tous ? Voici en effet qui est inadmissible : alors que le baptême – cette première profession de la philosophie chrétienne – est un bien également commun à tous les chrétiens, alors que les autres sacrements, alors que la récompense de l’immortalité s’appliquent également à chacun, seuls les dogmes devraient-ils être réservés à cette poignée de gens qu’on appelle aujourd’hui ordinairement théologiens ou moines, alors qu’ils sont minoritaires dans le peuple qui porte le nom du Christ, à ces gens, dis-je, dont je souhaiterais qu’ils fussent un peu plus conformes à ce qu’on en croit ?
Je crains en effet que parmi les théologiens on ne puisse en trouver qui ne soient très loin de leur dénomination, c’est-à-dire dont les paroles soient terrestres et non divines ; et que parmi les moines, qui professent la pauvreté et le mépris du monde, on ne trouve rien que mondanité. Pour moi, le vrai théologien est celui qui use non de syllogismes, d’artifices tordus, mais de sa passion, mais de son visage, et de ses yeux, mais de sa vie même pour enseigner que les richesses sont à mépriser, que le chrétien ne doit pas se fier aux protections de ce monde, et qu’au rebours pour lui tout dépend du ciel, qu’il ne doit pas répondre à l’injustice par l’injustice, qu’il doit prier bien pour ceux qui prient mal, faire le bien pour ceux qui font le mal, qu’il lui faut aimer et aider tous les gens de bien exactement comme s’ils étaient des membres de son propre corps, et tolérer les méchants s’ils ne peuvent être amendés (…). Tout homme qui, inspiré par l’esprit du Christ, prêche, inculque pareilles vérités, qui y exhorte, incite, anime autrui, celui-là, dis-je, est un vrai théologien, fût-il fossoyeur ou tisserand. Si de plus il y conforme ses moeurs, alors il est un grand docteur. Sur la question de savoir quelle est l’intelligence des anges, il se peut que tel autre, même un non-chrétien, raisonne avec plus de subtilité ; mais nous persuader que, purs de toute souillure, nous devons passer une vie angélique, telle est la tâche du théologien chrétien. »
ERASME, Les Préfaces au Novum Testamentum (1516), traduites du latin par Y. Delègue, Genève, Labor et Fides, 1990, p. 73 – 77.
—-
Le traducteur
« Nous avons traduit l’ensemble du Nouveau Testament d’après les textes grecs en mettant le grec vis-à-vis pour qu’on puisse immédiatement comparer. Nous avons ajouté des notes à part, où nous montrons, soit par des preuves, soit par l’autorité de vieux théologiens, que nous n’avons point fait de modifications à la légère, et cela pour qu’on se fie à nos corrections, et qu’on ne puisse altérer facilement ce que nous avons corrigé (…).
Pour ce qui touche aux affaires de l’Église, je ne craindrai pas de dédier ce produit de mes veilles à tout évêque, à tout cardinal et même à tout Souverain Pontife*, pourvu qu’il soit pareil à celui que nous avons.»
* Il s’agit du pape Léon X, de la famille des Médicis, ami des humanistes.
In Érasme, Lettre à Dorpius XXXIII, 1513, Flammarion, 1964.
—-
Critiques du clergé par Érasme
» Mais en vérité, depuis longtemps, les souverains pontifes, les cardinaux, les évêques, rivalisent délibérément avec les habitudes des princes et en sont presque à les dépasser. (…) Et ils ne se souviennent même plus de leur nom, de ce que signifie le mot d’évêque, c’est-à-dire travail, vigilance, sollicitude. Mais pour attraper l’argent du troupeau, ils font parfaitement les « évêques » : ils surveillent*. Il en serait de même si les cardinaux pensaient qu’ils sont les successeurs des apôtres, qu’on exige d’eux la vie dont ils donnèrent l’exemple et qu’ils sont non pas les possesseurs mais les dispensateurs des biens spirituels dont ils auront bientôt à rendre un compte très exact. (…) Quant aux souverains pontifes qui sont les vicaires du Christ, s’ils s’efforçaient d’imiter sa vie, c’est-à-dire sa pauvreté, ses travaux, sa doctrine, sa croix, son mépris de la vie, s’ils réfléchissaient seulement à leur nom de pape, autrement dit de père, ou à leur surnom de « très saint », qu’y aurait-il sur terre de plus malheureux ? »
* Surveillent : jeu de mots sur évêque, dérivé du grec episcopos, « surveillant ».
In ÉRASME, Éloge de la folie, 1511. extraits des chap. LVII à LIX.
« Les plus heureux sont ceux qui s’appellent couramment eux-mêmes « religieux » et « moines », deux surnoms tout à fait trompeurs, car la plupart d’entre eux sont fort éloignés de la religion et on les rencontre plus que personne en tous lieux. (…)
D’abord ils trouvent que le comble de la piété, c’est de ne rien savoir des belles-lettres, pas même lire. Ensuite, quand, à l’église, ils braillent de leur voix d’âne leurs psaumes, dûment numérotés mais nullement compris ; alors ils croient vraiment charmer l’oreille des saints d’une infinie volupté. Il y en a quelques-uns parmi eux qui vendent au meilleur prix leur crasse et leur mendicité, et qui beuglent aux portes à tue-tête pour qu’on leur donne du pain, et il n’y a pas d’auberge, de voiture, de bateau qu’ils importunent au grand détriment, c’est sûr, des autres mendiants. Et c’est de cette manière que ces personnages particulièrement délicieux, avec leur saleté, leur ignorance, leur grossièreté, leur impudence, font revivre pour nous, disent-ils, les apôtres. »
In Érasme, Éloge de la Folie, chapitre LIV, 1511.
—-
La diffusion d’écrits religieux en Allemagne à la fin du XV°s.
» L’Allemagne entière regorge de bibles, de doctrines sur le salut, d’éditions des Saints-Pères et de livres semblables (…). On tourne et on retourne la Bible, on lui fait dire tout ce qu’on veut (…). Il faut s’attendre à beaucoup d’orages et de catastrophes, car maintenant on ne sait plus où est la vérité. La Sainte Écriture est pour ainsi dire mise à l’envers et tout autrement expliquée. »
In S. BRANT, La Nef des fous, 1494, dans J. DELUMEAU, Naissance et affirmation de la Réforme, PUF, 1971.
—-
La vie religieuse à Meaux en 1525
» L’évêque interrogea Pierre de Glana, vicaire de la paroisse Saint-Martin, sur les paroissiens, lui demandant s’il n’y avait pas de scandale dans cette paroisse. Le vicaire lui répondit que ceux qui avaient causé scandale avaient été traduits en justice ; qu’il y avait beaucoup de blasphémateurs mais que c’étaient des vagabonds. Les paroissiens avaient une vue juste de la confession et de la communion, et le manifestaient par leur assiduité [à la messe] les dimanches et jours de fêtes.
Cependant, quelques-uns pensaient qu’il n’était pas nécessaire de prier les saints, mais Dieu seul. Plusieurs fréquentaient peu leur église paroissiale (…). Il ajouta qu’il avait entendu des chansons dans les rues (…) contre l’honneur de Dieu et contre des ecclésiastiques.
Citation de Guillaume Briçonnet (1470-1534).
Sur Clio-Texte, il y a d’autres textes d’Erasme et des textes de Luther .