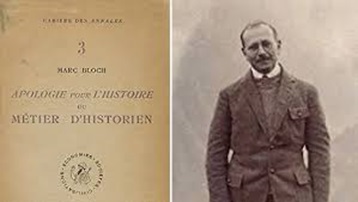Notes tirées du « Manuel de Diplomatique » de A. GIRY, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1894, pages 12, et 863 à 887.
—-
Les règles de la critique diplomatique ont en grande partie pour objet de permettre de distinguer les actes authentiques des actes apocryphes.
Pour opérer ce triage, il faut :
- étudier les documents dont l’authenticité ne saurait donner de prise au doute;
- multiplier sur ces textes les observations;
- montrer l’application des procédés de la critique aux actes supects d’altération ou de fausseté;
- rechercher quels ont été les procédés et les mobiles des faussaires;
- examiner si tout document faux doit être absolument retranché du nombre des sources historiques, et s’il n’y en a pas où l’histoire puisse encore trouver des indications utiles.
Entre les documents faux, il est juste d’établir des distinctions fondées sur leur nature et sur les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. C’est ce que nous allons voir
—-
Copies figurées
On a souvent désigné comme faux, mais abusivement, des documents dont l’aspect général est celui d’originaux, mais qui ne sont que des copies dont le scribe s’est efforcé de reproduire l’écriture et les dispositions de l’original. Ce sont des copies figurées.
Lorsque ces transcriptions sont à peu près contemporaines des actes qu’elles reproduisent, et faites avec habileté, elles se confondent facilement avec les originaux, dont il importe cependant de les distinguer, car elles sont toujours suspectes d’altérations ou même d’interpolations. Le caractère qui les fait le plus ordinairement et le plus facilement reconnaître est l’absence de signes de validation; mais ce n’est pas un indice absolument sûr, car il est arrivé que les copistes ont reproduit en les imitant les souscriptions, les monogrammes, les paraphes, et même pratiqué au bas de l’acte les incisions qui, dans l’original, marquaient la place du sceau. On ne peut être assuré d’éviter des méprises que par une étude attentive et minutieuse des écritures et de tous les usages des chancelleries.
—-
Actes subreptices
Il y a eu dans toutes les chancelleries, à certaines époques, des agents accessibles à la corruption, qui ont abusé de leur situation pour faire insérer par surprise dans certains documents des clauses subreptices, ou même qui ont réussi à faire authentiquer frauduleusement et à l’insu de ceux qui étaient censés les avoir faits, certains documents contraires à toutes règles ou rédigés en violation des lois. Souvent des pratiques de falsification se sont mêlées à ces fourberies.
Les formalités de contrôle, que ne cessaient de multiplier les règlements de chancellerie, et les solemnités dont l’apposition du sceau était partout entourée avaient pour objet de prévenir ce genre de fraudes; elles furent impuissantes cependant à l’empêcher jamais tout à fait.
La chancellerie pontificale, dispensatrice de tant de faveurs, est l’une de celle qui malgré le luxe de précautions dont la confection des lettres apostoliques y étaient entourée, paraît avoir expédié le plus de documents subreptices.
Pour exemple, nous citerons l’affaire que raconte le strasbourgeois Jean Burchard dans son journal (Diarium) en septembre 1489 : un écrivain apostolique, un notaire de la chambre apostolique, un clerc du registre et le procureur de la pénitencerie furent condamnés à mort et exécutés. En voici la raison :
Ils s’enquéraient des suppliques adressées au pape, s’abouchaient avec les solliciteurs, convenaient du prix, et faisaient ensuite expédier en bonne forme des faveurs sans conséquence et d’obtention aisée, mais dont ils avaient eu soin d’écrire une partie de la teneur avec une encre spéciale, facile à effacer.
La bulle scellée, ils en faisaient disparaître cette écriture par un lavage, la remplaçaient par des dispositions nouvelles, écrites cette fois de bonne encre, modifiaient le chiffre de la taxe, et délivraient aux parties des lettres dont tous les signes d’authenticité étaient véritables et dont il était dès lors bien difficile d’établir la fausseté.
Burchard évalue à 50 ou environ le nombre de bulles aisni falsifiées : dispenses à des moines mendiants pour recevoir des bénéfices, unions de bénéfices à des menses abbatiales, autorisation de garder sa femme à un prêtre marié du diocèse de Rouen, etc.
On trouve dans les textes, jusqu’à l’époque moderne, de fréquentes mentions de documents subreptices. Dans les actes des rois de France, il n’est pas rare de voir figurer depuis le XIVe siècle, parmi les formules finales, une clause de dérogation qui y est relative; elle est généralement conçue en ces termes : nonobstantibus quibuscumque litteris subrepticiis impetratis in contrarius vel etiam impetrandis.
La critique peut discerner les documents de cette espèce lorsqu’il s’y mêle des falsifications du genre de celle qui a été signalée plus haut, ou encore lorsque la fraude est évidente, mais la plupart des actes subreptices échappent nécessairement à son action, lorsque aucun témoignage extérieur ne vient l’avertir.
Rien n’est plus difficile que de prouver la subreption; les allégations des contemporains où les décisions judiciaires n’y suffisent même pas toujours, car il n’est pas sans exemple que l’intérêt politique ou d’autres influences aient fait déclarer subreptices des actes régulièrement expédiés et parfaitement authentiques.
—-
Actes récrits
Les reconstitutions de titres faites sans intention de fraude pour réparer les pertes des archives ont été extrêmement nombreuses, surtout pendant la première partie du moyen âge et jusqu’à la fin du XIe siècle.
Bien qu’il existât des moyens légaux de renouveler les titres détruits, il ne semble pas que les réfections librement faites, sans intervention de l’autorité publique et qui se donnaient l’apparence d’originaux, aient été considérées comme absolument illégitimes, et soient tombées sous le coup des lois en matière de faux.
Beaucoup de ces documents, rédigés d’après d’anciennes mentions qui rapportaient une partie de la teneur des textes perdus, copiés pour le reste sur de bons modèles (formules ou actes authentiques) et à une époque assez voisine de la date des actes à reconstituer, ont été assez habilement faits pour passer pour des originaux, même à des yeux exercés, ou du moins pour se sauver par une apparence d’authenticité.
La critique en est particulièrement délicate lorsque, le prétendu original ayant disparu, elle ne peut plus se prendre aux caractères extérieurs et doit s’exercer exclusivement sur les termes de la teneur.
Mais le plus souvent les bons matériaux faisaient défaut pour ces reconstitutions. Le rédacteur opérait sur des traditions anciennes plus ou moins altérées, sinon fausses; il utilisait les renseignements que pouvaient lui fournir les sources narratives, vies des Saints, annales ou chroniques; il ne résistait pas aux suggestions de la vanité, qui le poussaient à insérer hors de propos dans ses compositions, et à y développer sans mesure des traits, qui ne se rencontrent jamais dans les actes sincères, mais qu’il jugeait avantageux à son église ou à son couvent; le même sentiment le poussait à substituer aux formules vagues et aux réserves circonspectes en usage dans les chancelleries des affirmations catégoriques; enfin, malgré ses préoccupations d’archaïsme, il ne manquait guère de se trahir par des anachronismes : expressions nouvelles, allusions à des institutions de son temps, formalités diplomatiques récentes, etc.
Il suit de là que, pour faire la critique de documents de cette espèce, – et cela s’applique du reste aussi bien aux actes complètement faux qu’aux actes récrits -, les moyens d’investigation les plus sûrs sont la recherche des sources et celles des anachronismes. Nous laissons de côté la critique paléographique qui n’est possible que dans les cas assez rares où les prétendus originaux se sont conservés.
Un trait auquel on peut reconnaître presque toujours les documents faux, c’est qu’ils n’apprennent rien qu’on ne puisse aussi bien trouver ailleurs. Les faussaires, le plus souvent, n’ont pas assez d’imagination pour inventer, ils se bornent à compiler, et il suffit de soumettre leurs productions à une analyse rigoureuse pour en retrouver tous les éléments dans des textes connus d’ailleurs.
Quant aux anachronismes, il est sans exemple qu’un faussaire, si instruit, si soigneux, si habile qu’on le suppose, ait pu y échapper. Presque nécessairement, il lui arrivait de donner aux noms propres les formes usitées de son temps plutôt que les formes anciennes, d’ajouter aux noms de personne les titres et qualités requis par l’étiquette qu’il était habitué à observer, de faire quelque allusion aux institutions au milieu desquelles il vivait, d’employer le formulaire en usage à son époque, et surtout de mentionner des garanties ou des signes de validation dans les formes auxquelles il était accoutumé.
Sans valeur pour l’époque à laquelle ils sont attribués, de tels documents doivent être considérés comme des notices historiques plus ou moins habilement composées, à l’égard desquelles par conséquent il appartient à la critique de procéder comme elle procède à l’égard des chroniques. Ils sont ce que seraient des chroniques composées dans les mêmes circonstances. Au lieu de les rejeter absolument comme de la fausse monnaie historique, il faut en séparer les éléments par la critique, et assigner l’emploi de chacun d’après le temps auquel il se rapporte.
Les guerres, les invasions, les incendies, la négligence, ont causé la perte de nombre de documents, de titres, de privilèges, dont la tradition, des témoignages, voire des analyses ou des mentions conservaient seuls le souvenir. Les établissements religieux d’ancienne fondation s’appliquèrent souvent à réparer les pertes de cette nature qu’ils avaient subies, soit lorsqu’un temps de tranquillité leur en laissait le loisir, soit lorsqu’un abbé soigneux entreprenait de mettre de l’ordre dans l’administration domaniale, soit plus souvent lorsqu’un procès, des revendications, des empiétements rendaient nécessaire la production de leurs titres.
Par exemple, on sait que les invasions du IXe siècle furent l’occasion de calamités effroyables dont les établissements ecclésiastiques furent les principales victimes. La plupart des églises de la Gaule furent alors saccagées, renversées ou livrées aux flammes, puis désertées pendant un temps par leurs moines, que les récits contemporains nous montrent errants de refuge en refuge et réduits à une condition quasi nomade.
On devine ce que fut en ces conjonctures le sort des archives ! Quand, au cours du Xe siècle, l’ordre se fut un peu rétabli, lorsque les religieux, réinstallés dans leurs monastères reconstruits, purent songer à remettre de l’ordre dans leurs affaires, ils s’occupèrent à reconstituer leurs chartrier et à en combler les lacunes.
C’était la première précaution à prendre pour étayer de titres la propriété des biens qui leur restaient, pour se mettre en mesure de revendiquer ceux dont les désordres de l’époque précédente et l’abandon où ils les avaient laissaient avaient favorisé l’usurpation, pour maintenir les droits, les prérogatives, les privilèges dont ils voulaient continuer à jouir, pour se défendre enfin contre les convoitises des seigneurs féodaux. Un grand nombre d’actes soi-disant mérovingiens ou carolingiens furent refaits dans ces conditions du Xe au XIe siècle.
Il faut citer parmi les plus célèbres un prétendu diplôme de Childebert Ier, de 558, qui a longtemps passé pour l’acte original de la fondation de l’abbaye de Saint-Germain-des-Près, et dont Jules Quicherat a montré l’origine par une discussion critique admirablement conduite et qui ne laisse subsister aucun doute dans l’esprit du lecteur (Jules Quicherat, Critique des deux plus anciennes chartes de l’abbaye de Saint-Germain-des-Près, publié dans « Bibliothèque de l’École des Chartes », 6e série, tome I (1864-1865), pages 513 à 555).
Deux fois saccagée par les Normands au IXe siècle, l’abbaye avait perdu son titre fondamental et ne possédait plus sur les circonstances de sa fondation que des traditions douteuses que recueillit à la fin du même siècle un religieux du nom de Gislemar pour écrire une vie de Saint Droctovée, le premier abbé. Ce fut cette vie qui servit de modèle au moine qui entreprit de reconstituer le diplôme du roi Childebert.
Les documents mérovingiens de cette espèce sont nombreux. Ceux de l’époque carolingienne n’ont pas échappé davantage à ce travail de réfection; mais comme du IXe au XIe siècle le style diplomatique, les institutions et les usages avaient subi des modifications moins profondes, comme les bons modèles à imiter se trouvaient en plus grand nombre à la portée des faussaires, il est souvent plus difficile de les démasquer.
Le XIe siècle n’est pas le dernier où l’on ait procédé ainsi à des reconstitutions de titres perdus; néanmoins, les exemples postérieurs sont beaucoup plus rares. D’une part, en effet, la perte ou la destruction de titres ne furent plus, après le bouleversement général causé par les invasions normandes, que des accidents isolés, et d’autre part la notion juridique longtemps assez indécise de l’authenticité des actes se précisa au cours du XIIe siècle. Cependant, au XIIIe siècle encore, les religieux de l’ordre de Grandmont, qui s’étaient montrés jusqu’alors fort peu soucieux de la conservation de leurs titres de fondation et de dotation, n’employèrent pas un autre moyen pour réparer, fort maladroitement du reste, les pertes de leurs chartriers.
—-
Actes faux
Si parmi les pièces apocryphes il est une catégorie d’actes qui se justifient en quelque manière par leur origine et les intentions de leurs auteurs, il y a un nombre beaucoup plus considérable de documents qui constituent purement et simplement des faux.
Entre ces faux cependant, il y a lieu d’établir des distinctions utiles à la critique, fondées sur :
- les mobiles des faussaires,
- la nature des faux,
- leurs dates.
Un grand nombre n’ont eu d’autre mobile que la vanité. Dans les églises et les abbayes, ce sentiment a produit des documents tels que des privilèges pompeux, rédigés au nom de leurs fondateurs, de bienfaiteurs illustres, et surtout des plus célèbres d’entre les souverains : Clovis, le grand roi Dagobert, Charlemagne, ont joui, à ce point de vue, d’une remarquable popularité. La plus grande partie des faux de cette espèce sont fort anciens et par là demeurent intéressants.
Il faut faire une catégorie spéciale des documents fabriqués dans un intérêt généalogique, car si beaucoup d’entre eux n’ont eu d’autre objet que de flatter l’orgueil de familles souveraines ou les préjugés aristocratiques de gentilshommes et de parvenus, en leur attribuant des ancêtres glorieux ou seulement fort anciens, il en est en plus grand nombre qui devaient procurer aux intéressés des avantages plus positifs.
En un temps où toute la hiérarchie sociale était fondée sur une aristocratie héréditaire, les documents généalogiques étaient susceptibles, pour les uns d’accroître leur situation dans l’Etat, ou même de leur faire entrevoir l’éventualité d’une couronne, pour les autres de leur procurer des prérogatives, des privilèges et des franchises fort enviables.
Les faux de ce genre sont véritablement innombrables et infiniment variés. Il y en a de tous les temps : on en fabriquait déjà au XIe siècle et probablement auparavant, on en forge encore de nos jours. Les uns sont composés avec un soin, une recherche d’exactitude, une dépense d’érudition à défier les plus habiles; d’autres sont d’une grossièreté à éveiller les soupçons des plus crédules.
Un caractère commun à ces deux catégories de faux documents, c’est qu’ils sont généralement trop intéressants; il s’y trouve trop de renseignements, trop de développements, trop de faits, trop de détails, trop de hors-d’oeuvre que ne comporte pas le style diplomatique. Les plus habiles faussaires ne pouvaient guère, en raison du but même qu’ils poursuivaient, échapper à ce défaut, et c’est par là que leurs productions donnent presque toujours l’éveil à la critique.
L’intention frauduleuse, en vue de procurer un bénéfice illégitime, de porter préjudice à autrui ou de faire triompher une mauvaise cause, a naturellement produit un nombre considérable de faux. Les procès, intentés en vue de revendiquer des biens ou soutenus pour se défendre contre des revendications, ont été l’occasion de fabriquer de nombreux titres de propriété. Les contestations relatives à la possession de reliques, source si considérable de revenus pour les églises au moyen âge, ont donné naissance à une espèce particulière et souvent curieuse de pièces fausses. Les produits de ce genre sont naturellement très divers selon l’habileté des faussaires ; ils ne présentent point de particularités caractéristiques.
Parmi les mobiles qui ont provoqué la fabrication ou la falsification de documents, il faut compter encore l’intérêt politique. On sait combien certains gouvernements ont usé de ce moyen, comment certains d’entre eux ont entretenu des faussaires à gages et organisé de véritables ateliers de fausses pièces.
Comme les faux de cette espèce sont généralement attribués à une date assez voisine de l’époque de leur fabrication, comme le plus souvent ils ne diffèrent pas des documents couramment expédiés dans les chancelleries, et comme les faussaires disposaient d’ordinaire de ressources nombreuses, on conçoit que ces pièces doivent compter parmi les mieux faites et les plus difficiles à reconnaître.
Il existe enfin des documents apocryphes que l’on pourrait appeler des faux littéraires, les uns, généralement fort grossiers, destinés à être vendus aux curieux et aux collectionneurs, d’autres, souvent fort habilement contrefaits, fabriqués par des savants en goût de mystification.
Si l’on envisage la nature des faux, on doit distinguer ceux dont les auteurs se sont hasardés à contrefaire des originaux. Lorsque ces prétendus originaux se sont conservés, ils donnent naturellement prise à la critique d’une foule de manières. Il est exceptionnel que de semblables contrefaçons puisse faire longtemps hésiter son jugement. Lors même que ces pièces ne nous sont plus connues que par des copies, il est souvent possible de recueillir sur les originaux perdus des témoignages suffisants pour les apprécier. Mais beaucoup de faussaires avisés se sont contentés de composer les pièces fausses, et n’en ont communiqué au public que la teneur, soit en copie manuscrite, soit en texte imprimé, provenant à leur dire d’originaux, ou d’anciennes copies.
En ce qui touche la date, il y a intérêt à distinguer les faux qui remontent à une époque ancienne, et qui, dépouillés de leur prestige de pièces authentiques, peuvent conserver encore quelque valeur, et les faux modernes qui, reconnus pour tels, doivent être rayés du nombre des sources historiques, et gardent à peine un certain intérêt de curiosité.