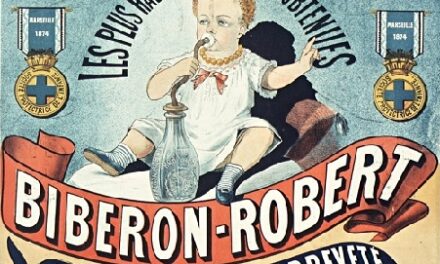« 1er juin [ 1885 ]
Je viens d’assister aux funérailles de Victor Hugo, du haut d’une fenêtre donnant sur le boulevard Saint-Germain. C’était vraiment colossal. J’étais chez le sonneur de Saint-Thomas-d’Aquin. Je suis ivre de tant de bruit, de foules, de couronnes portées, de musique, de costumes, de manifestations.
Je note ici ce qui m’a causé le plus d’impression. C’était, outre l’armée à pied et à cheval qui encadrait cet immense défilé, qui l’ouvrait et qui le fermait, d’abord cette suite de chars traînés par des chevaux vêtus de housses noires et blanches et portant des montagnes de couronnes. Non, jamais tant de couronnes aux mille couleurs n’ont été jetées au pied d’un défunt. Un Himalaya ! Le corbillard où reposait Victor Hugo était celui des pauvres, triste et noir. Mais quel défilé ! Les dénombrements d’Homère sont surpassés ! Le journal le plus exagéré ne dira rien de trop. J’étais à mon poste à midi : le défilé qui avait commencé à 12h40 s’est terminé à 6h20. Tout mon pays était là ! Tous les âges, toutes les corporations, toutes les associations étaient représentées. Je regardais particulièrement ces lycéens, ces jeunes gens, ces enfants qui escortaient le poète auguste ! Que de couronnes portées sur des brancards, couronnes qui défiaient en grosseur et en beauté grappes de la Terre Promise ! Des femmes défilaient avec des hommes qui portaient, elles aussi, leurs couronnes. Et les drapeaux et les bannières flottaient au vent. Parfois, souvent même, la foule vivement battait des mains. J’ai cru l’entendre applaudir le char algérien qui s’avançait, surmonté d’un palmier, et aussi l’Alsace-Lorraine. Elle applaudissait encore la musique – voire même la Marseillaise et l’air de « Mourir pour la patrie ! ».
Le boulevard Saint-Germain, mon pacifique quartier, était un fourmillement de visages et de chapeaux. Foule sous les arbres verts de la chaussée, foule aux balcons. Quelques audacieux étaient perchés sur les toits. Sur le trottoir, échelles, estrades sur lesquelles le public se hissait pour mieux voir. Les becs de gaz étaient allumés sous leurs crêpes. On eût dit un oeil rouge sombre qui regardait çà et là.
L’Histoire racontera ce poème vivant dont j’ai été le témoin.
Peut-être, je dois l’avouer, le caractère de ces obsèques était-il trop bruyant, trop profane. Il y avait un grossier et lourd parfum de foire qui se dégageait de ces masses. Moi, du moins, à certains moments, j’étais ému et je me répétais à moi-même, en songeant à l’absence du prêtre : quel malheur irréparable de n’avoir pas pour soi l’âme de la patrie ! Ah ! c’est là, en face d’un tel spectacle que j’ai mieux saisi et douloureusement savouré l’isolement du sacerdoce ! La religion qui était tout, autrefois, se renferme, de plus en plus, dans l’Eglise et devient le fait d’une minorité féminine !
Tout à l’heure, 8 heures du soir, j’ai été, en haut de la rue de Médicis, regarder de loin le Panthéon. La croix du Dôme subsiste encore : seule, la croix du fronton a été enlevée. Derrière les colonnes, j’ai vu des tentures noires. Hugo mort a ouvert, à lui seul, les portes fermées du Panthéon. Mais il en a chassé Dieu ! Ces funérailles nationales, toutes splendides qu’elles soient, feront pleurer plus d’un prêtre, entre le vestibule et l’autel. De temps en temps, je regardais, avec mélancolie, le clocher de Saint-Germain-des-Prés. Le temps était superbe et parfois de beaux coups de soleil venaient dorer les casques et les instruments.
Je n’oublierai pas le 1er juin 1885 où j’ai vu mon pays, le monde entier suivre l’humble corbillard de Victor Hugo. Quelle ironie, si Dieu n’a pas eu pitié de cet homme !
Le culte des grands hommes sera une caractéristique de ce siècle à son déclin. Certes, je suis bien de mon siècle, moi qui ai tant de fois passé sous les fenêtres du grand homme, moi qui, tant de fois, l’ai fixé de mes yeux au Sénat ! »
Source : Abbé Mugnier, Journal. (1879 – 1939), Paris, Mercure de France, 1985-2003, p. 50 – 52.