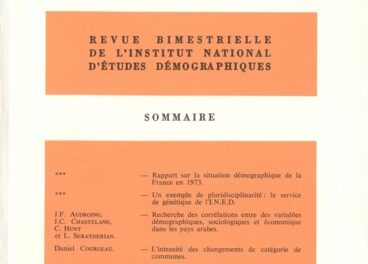Monarque absolu, Louis XIV n’a pas manqué de thuriféraires empressés à chanter la gloire du Roi-Soleil, le lieutenant de Dieu sur Terre et le grand dispensateur des faveurs et des pensions. Mais sa politique a aussi fait l’objet au cours de son long règne, de vives critiques, venues parfois de fidèles serviteurs. Nous pensons ici en particulier à Vauban.
Le texte que nous présentons ici est une lettre rédigée par François Fénelon (1651-1715), adressée à Louis XIV. Fénelon fut à la fois homme d’Église et écrivain. Précepteur du duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV, à partir de 1689, cela lui valut d’être nommé archevêque de Cambrai en 1695. En tant qu’écrivain, Fénelon est resté célèbre pour son roman didactique « Les aventures de Télémaque » , considéré comme une critique voilée de l’absolutisme de Louis XIV.
La lettre à Louis XIV est écrite vers 1694, à la même époque que Les aventures de Télémaque. L’auteur s’adresse directement à son souverain et lui « parle fortement » de vérités que le roi n’est « guère accoutumé à entendre ».
Dans l’extrait choisi, Fénelon met l’accent sur la misère effroyable du peuple qui meurt de faim : « La France entière n’est plus qu’un grand hôpital désolé et sans provision ». Cette misère doit être replacée dans le contexte de l’effroyable crise de subsistance de 1693-1694 qui aurait provoqué une surmortalité de plus d’un million de sujets dans un royaume qui en comptait plus de 20. Mais Fénelon pointe du doigt une autre cause que le mauvais temps : les guerres dispendieuses pour accroître la gloire du Roi mais qui accablent les peuples d’impôts : « vous avez détruit la moitié des forces réelles du dedans de votre état, pour faire et pour défendre de vaines conquêtes au dehors », avec comme conséquence un peuple français qui » a eu tant de confiance en vous, commence à perdre l’amitié, la confiance, et même le respect ».
Cette lettre éminemment politique n’a jamais été lue au Roi-Soleil et c’est surtout au siècle suivant qu’elle rencontra un écho certain, à un moment marqué par la remise en cause de la monarchie absolue.
Lettre à Louis XIV (extraits)
La personne, Sire, qui prend la liberté de vous écrire cette lettre, n’a aucun intérêt en ce monde. Elle ne l’écrit ni par chagrin, ni par ambition, ni par envie de se mêler des grandes affaires. Elle vous aime sans être connue de vous ; elle regarde Dieu en votre personne. Avec toute votre puissance vous ne pouvez lui donner aucun bien qu’elle désire, et il n’y a aucun mal qu’elle ne souffrît de bon cœur pour vous faire connoître les vérités nécessaires à votre salut. Si elle vous parle fortement, n’en soyez pas étonné, c’est que la vérité est libre et forte. Vous n’êtes guère accoutumé à l’entendre. Les gens accoutumés à être flattés prennent aisément pour chagrin, pour âpreté et pour excès, ce qui n’est que la vérité toute pure. C’est la trahir, que de ne vous la montrer pas dans toute son étendue. Dieu est témoin que la personne qui vous parle le fait avec un cœur plein de zèle, de respect, de fidélité, et d’attendrissement sur tout ce qui regarde votre véritable intérêt. […]
Cependant vos peuples, que vous devriez aimer comme vos enfants, et qui ont été jusqu’ici si passionnés pour vous, meurent de faim. La culture des terres est presque abandonnée ; les villes et la campagne se dépeuplent ; tous les métiers languissent et ne nourrissent plus les ouvriers. Tout commerce est anéanti. Par conséquent vous avez détruit la moitié des forces réelles du dedans de votre état, pour faire et pour défendre de vaines conquêtes au dehors. Au lieu de tirer de l’argent de ce pauvre peuple, il faudroit lui faire l’aumône et le nourrir. La France entière n’est plus qu’un grand hôpital désolé et sans provision. Les magistrats sont avilis et épuisés. La noblesse , dont tout le bien est en décret, ne vit que de lettres d’état. Vous êtes importuné de la foule des gens qui demandent et qui murmurent. C’est vous-même, Sire, qui vous êtes attiré tous ces embarras ; car, tout le royaume ayant été ruiné, vous avez tout entre vos mains, et personne ne peut plus vivre que de vos dons. Voilà ce grand royaume si florissant sous un roi qu’on nous dépeint tous les jours comme les délices du peuple, et qui le seroit en effet si les conseils flatteurs ne l’avoient point empoisonné.
Le peuple même (il faut tout dire) qui vous a tant aimé, qui a eu tant de confiance en vous, commence à perdre l’amitié, la confiance, et même le respect. Vos victoires et vos conquêtes ne le réjouissent plus ; il est plein d’aigreur et de désespoir. La sédition s’allume peu-à-peu de toutes parts. Ils croient que vous n’avez aucune pitié de leurs maux, que vous n’aimez que votre autorité et votre gloire. Si le Roi, dit-on, avoit un cœur de père pour son peuple, ne mettroit-il pas plutôt sa gloire à leur donner du pain, et à les faire respirer après tant de maux, qu’à garder quelques places de la frontière qui causent la guerre ? Quelle réponse à cela, Sire ? Les émotions populaires qui étoient inconnues depuis si longtemps deviennent fréquentes. Paris même, si près de vous, n’en est pas exempt. Les magistrats sont contraints de tolérer l’insolence des mutins et de faire couler sous main quelque monnoie pour les apaiser ; ainsi on paie ceux qu’il faudroit punir. Vous êtes réduit à la honteuse et déplorable extrémité, ou de laisser la sédition impunie, et de l’accroître par cette impunité, ou de faire massacrer avec inhumanité des peuples que vous mettez au désespoir, en leur arrachant, par vos impôts pour cette guerre, le pain qu’ils tâchent de gagner à la sueur de leurs visages.
Mais, pendant qu’ils manquent de pain, vous manquez vous-même d’argent, et vous ne voulez pas voir l’extrémité où vous êtes réduit. Parce que vous avez toujours été heureux, vous ne pouvez vous imaginer que vous cessiez jamais de l’être. Vous craignez d’ouvrir les yeux ; vous craignez qu’on ne vous les ouvre ; vous craignez d’être réduit à rabattre quelque chose de votre gloire. Cette gloire, qui endurcit vôtre cœur, vous est plus chère que la justice, que votre propre repos, que la conservation de vos peuples qui périssent tous les jours des maladies causées par la famine, enfin que votre salut éternel incompatible avec cette idole de gloire.
Voilà, Sire, l’état où vous êtes. Vous vivez comme ayant un bandeau fatal sur les yeux ; vous vous flattez sur les succès journaliers qui ne décident rien, et vous n’envisagez point d’une vue générale le gros des affaires qui tombe insensiblement sans ressource. Pendant que vous prenez, dans un rude combat, le champ de bataille et le canon de l’ennemi, pendant que vous forcez les places, vous ne songez pas que vous combattez sur un terrain qui s’enfonce sous vos pieds, et que vous allez tomber malgré vos victoires. […]
François Fénelon, Lettre à Louis XIV, vers 1694
Pour consulter la version intégrale de la lettre de Fénelon, cliquer Ici