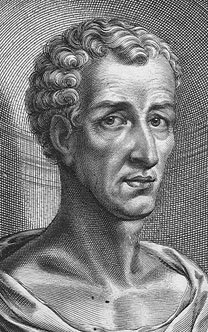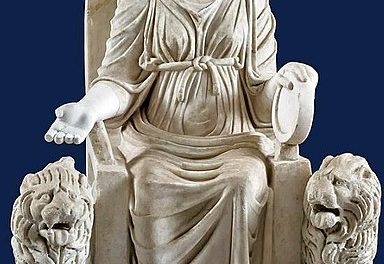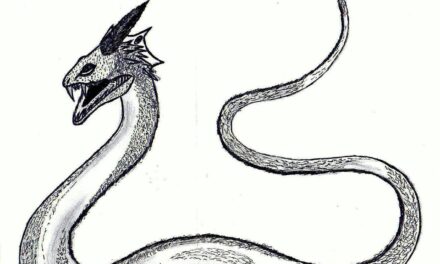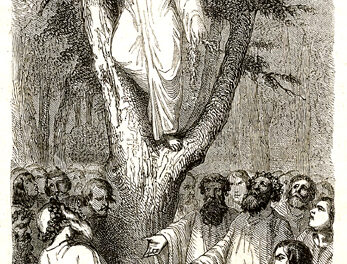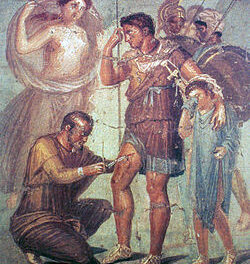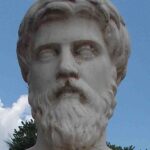Lucien de Samosate (120-180 apr.J.-C.) est né au deuxième siècle de notre ère, en Syrie. Après des études de philosophie et d’éloquence, il donne des cours en tant que rhéteur. Il a beaucoup voyagé (Gaules, Grèce, Asie Mineure) et s’établit en Égypte où il obtient un poste dans l’administration impériale. Esprit brillant, il a rédigé de nombreuses œuvres (on lui attribue 86 écrits) de nature variée.
L’extrait ci-dessous est issu de son Éloge du parasite, petit traité dans lequel il entend démontrer, dans un dialogue plein de drôlerie, que le métier de parasite est de loin le meilleur et le plus noble qui soit. Il en profite pour égratigner philosophes et orateurs, dans de nombreuses tirades savoureuses, le parasite apparaissant finalement bien plus vertueux que ceux qui en font profession.
« Sur l’agora ou dans les tribunaux, on ne voit guère le parasite. Il faut dire que ces lieux conviennent mieux aux sycophantes (délateurs professionnels) et que rien de ce qui s’y passe n’est de bon ton. En revanche, le parasite fréquente palestres, gymnases et banquets. Il en est même l’ornement. Pour ce qui est du corps, peut-on comparer un philosophe ou un orateur nu à un parasite ? Quand en on voit un dans un gymnase, n’est-il pas plutôt la risée du lieu ? Dans un endroit désert, on les imagine mal résister à une bête féroce, alors que le parasite attend de pied ferme et soutient facilement ce genre d’attaques, habitué qu’il est, dans les festins, à se mesurer avec ces animaux. (…)
Dans un banquet, enfin, qui arrive à la cheville d’un parasite pour ce qui est des plaisanteries ou de l’appétit ? Qui égaie le mieux les convives ? Celui qui chante et badine, ou celui qui ne rit jamais, drapé dans un manteau râpé jusqu’à la corde comme s’il était venu à des funérailles ? Un philosophe dans un banquet me fait l’impression d’un chien dans un bain.
Mais venons-en à la vie même du parasite. Examinons-la et comparons-la avec celle du philosophe. Que voyons-nous ? Le parasite n’a jamais eu que dédain pour la gloire, et se soucie fort peu de ce qu’on pense de lui. Les orateurs et les philosophes en revanche, nous les voyons tous – pas seulement quelques-uns ! – préoccupés par les vaines fumées de la gloire et – honte plus grande encore – par l’argent. Le parasite, lui, éprouve pour l’argent une indifférence plus parfaite que celle qu’on éprouve pour les cailloux du rivage. À ses yeux, l’or ne diffère en rien du feu. Les orateurs, au contraire, et, chose plus effroyable, ceux-là même qui se prétendent philosophes sont d’une mesquinerie extrême. Parmi les philosophes – pour ne rien dire des orateurs ! – qui jouissent aujourd’hui de la meilleure réputation, l’un s’est laissé acheter pour défendre une cause, tandis qu’un autre exige une pension d’un roi chez qui il habite, et c’est pour cet argent que, sans honte aucune, il demeure loin de son pays, tout vieux qu’il est, stipendié comme un prisonnier indien ou scythe, indifférent à la mauvaise réputation qu’il se fait. Et combien d’autres faiblesses trouvera-t-on chez les philosophes : chagrins, colères, envies et désirs de toutes sortes ? Le parasite, lui, est exempt de tous ces défauts. Capable de supporter tous les maux, rien ni personne ne peut l’irriter. S’il se fâche quelquefois, sa colère est sans conséquence : elle fait plutôt rire et réjouit la compagnie. Il est moins que personne sujet à l’affliction, car son métier lui épargne gracieusement tout motif de chagrin. Il n’a ni bien, ni maison, ni serviteur, ni femme, ni enfants, toutes choses dont la perte afflige nécessairement ceux qui les possèdent. Enfin il ne désire ni la gloire, ni la richesse ».
Lucien de Samosate, Éloge du parasite, éditions Arléa, 2004, collection Retour aux grands textes, traduction de Claude Terreaux, extrait pp.42-45.