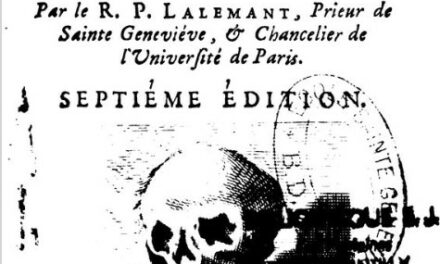PORTRAIT DE VOLTAIRE par un rival qui ne manque pas d’esprit
L’homme qui a écrit cette lettre vers 1735 est peut-être Alexis Piron, poète et satiriste. Peu importe. L’essentiel est d’y voir s’inscrire, en formules fatales, la matrice impeccable de tous les portraits à venir de Voltaire, l’homme et l’œuvre réunis.
« Monsieur de Voltaire est au-dessous de la taille des grands hommes, c’est-à-dire un peu au-dessus de la médiocre (…). Il est maigre, d’un tempérament sec. Il a la bile brûlée, le visage décharné, l’air spirituel et caustique, les yeux étincelants et malins. Tout le feu que vous trouverez dans ces ouvrages, il l’a dans son action. Vif jusqu’à l’étourderie : c’est un ardent qui va et vient, qui vous éblouit et qui pétille. (…) Gai par complexion, sérieux par régime, ouvert sans franchise, politique sans finesse, sociable sans amis, il sait le monde et il l’oublie. (…) il aime les grandeurs et méprise les Grands, est aisé avec eux, contraint avec ses égaux. Il commence par la politesse, continue par la froideur et finit par le dégoût. Il aime la Cour et s’y ennuie. Sensible sans attachement, voluptueux sans passion, il ne tient à rien par choix, et à tout par inconstance. Raisonnant sans principes, sa raison a des accès, comme la folie des autres. L’esprit droit, le coeur injuste, il pense tout et se moque de tout. (…) il travaille moins pour sa réputation que pour l’argent : il en a faim et soif. Enfin, il se presse de travailler pour se presser de vivre : il était fait pour jouir, il veut amasser. Voilà l’homme, voici l’auteur.
Né poète, les vers lui coûtent trop peu. Cette facilité lui nuit ; il en abuse, et ne donne presque rien d’achevé. Ecrivain facile, ingénieux, élégant, après la poésie, son métier serait l’histoire s’il faisait moins de raisonnements et jamais de parallèles, quoiqu’il en fasse quelquefois d’assez heureux.
M. de V***, dans son dernier ouvrage, a voulu suivre la manière de Bayle ; il tâche de le copier en le censurant. On a dit depuis longtemps que pour faire un écrivain sans passions et sans préjugés, il faudrait qu’il n’ait ni religion, ni patrie. Sur ce pied-là, M. de V*** marche à grands pas vers la perfection. On ne peut l’accuser d’être partisan de sa nation ; on lui trouve au contraire un tic approchant de la manie des vieillards. Les bonnes gens vantent toujours le passé, et sont mécontents du présent. Monsieur de V*** est toujours mécontent de son pays, et loue avec excès ce qui est à mille lieues de lui. Pour la religion, on voit bien qu’il est indécis à cet égard. (…)
M. de V*** a beaucoup de littérature étrangère et française (…). Politique, physicien, géomètre, il est tout ce qu’il veut, mais toujours superficiel et incapable d’approfondir. Il faut pourtant avoir l’esprit bien délié pour effleurer comme lui toutes les matières. Il a le goût plus délicat que sûr. Satirique, ingénieux, mauvais critique, il aime les sciences abstraites, et l’on ne s’en étonne point. On lui reproche de n’être jamais dans un milieu raisonnable, tantôt philanthrope et tantôt satirique outré. Pour tout dire en un mot, M. de V*** veut être un homme extraordinaire et il l’est à coup sûr. »
—-
Autre portrait de Voltaire par Joseph d’Hemery
Joseph d’Hemery est un inspecteur, s’occupant de la librairie (auteurs, éditeurs…) qui rédigea 500 fiches de police sur des auteurs qui en valent la peine. Voici la fiche de Voltaire, commencée le 1e janvier 1748, mais rédigée essentiellement en 1751 (Voltaire a 57 ans).
Orthographe d’époque
« Noms
Arouet de Voltaire
auteur
1er janvier 1748
Age
57
Pays
Paris fils d’un payeur de Rentes
Signalement
Grand, sec et l’air d’un satyre
Demeure
Rue Traversine chez Mme La Marquise du Châtelet
Histoire
C’est un aigle pour l’Esprit et un fort mauvais sujet pour les sentiments, tout le monde connoit ses ouvrages et ses aventures. Il est de l’académie francoise. Mad.e Denis est sa niece.
Au mois de juin 1750 il a quitté tout à fait sa patrie pour aller en Prusse, sa place d’historiographe a été donnée à Duclos. Il avoit perdu le 15 Sbre précédent Made la marquise du Chatelet.
Après son arrivée en Prusse, il y fit venir d’Arnaud qu’il fit recevoir a l’académie de Berlin, mais quelque tems après s’etant brouillé avec lui au sujet d’une preface que d’Arnaud avoit faite pour mettre a une edition des uvres de Voltaire, celui-ci le fit chasser de Prusse.
Le 29 avril 1751 j’ai été chargé de faire une perquisition de l’ordre du Roy chez le nomme Lonchamp valet de chambre de Voltaire et chez le nommé Lafond cy devant valet de chambre avec sa femme de Made du Chatelet, voyés a ce sujet mon rapport.
J’ai sçu que le veritable sujet de cette visite etoit pour tacher d’y trouver des lettres que Voltaire avoit ecrites a Made du Chatelet touchant leur amour que cette Dame avoit faite relier en quatre volumes, et que ne les ayant point trouvés après sa mort, on craignoit que la femme de chambre ne les eut prises pour les faire imprimer, ce qui seroit plaisant.Voltaire ayant craint cet accident fit prier M. Dargenson de faire faire cette perquisition sous un autre pretexte.Ce qui n’a cependant pas eu de succès.
Le 4 May suivant, le Magistrat m’a dit qu’il sçavoit à coup sur, que lorsque nous fimes la perquisition chez Lonchamp, il y avoit dans son tiroir de son bureau les vers ecrits contre le Roy et Made la Marquise [la marquise de Pompadour] et que Lonchamp s’en etoit vanté, et qu’il avoit meme fait un memoire contre Made Denis et Voltaire au sujet de l’injustice de cette perquisition.
Qu’il auroit plaisant si en faisant cette perquisition, que Voltaire faisoit faire, on eut trouvé des vers contre le Roy et Made la Marquise, peutêtre de l’écriture de Voltaire, ou de quelqu’autre qui lui appartient, ce qui auroit decouvert bien des choses. »
Joseph d’Hemery, « Notes de police sur divers écrivains français du milieu du XVIIIe siècle« .
—-
Polémique entre Voltaire et Rousseau
Lettres entre Voltaire et Jean-Jacques Rousseau
Voltaire s’oppose au « Discours sur l’origine et le fondements de l’inégalité parmi les hommes » de Rouseau.
Lettre de Voltaire à Jean-Jacques Rousseau, Aux Délices, près de Genève (30 août 1755)
« J’ai reçu, Monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain ; je vous en remercie ; vous plairez aux hommes à qui vous dites leurs vérités, et vous ne les corrigerez pas. Vous peignez avec des couleurs bien vraies les horreurs de la société humaine dont l’ignorance et la faiblesse se promettent tant de douceurs. On n’a jamais employé tant d’esprit à vouloir nous rendre Bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de soixante ans que j’en ai perdu l’habitude, je sens malheureusement qu’il m’est impossible de la reprendre. Et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes, que vous et moi. Je ne peux non plus m’embarquer pour aller trouver les sauvages du Canada, premièrement parce que les maladies auxquelles je suis condamné me rendent un médecin d’Europe nécessaire, secondement parce que la guerre est portée dans ce pays-là, et que les exemples de nos nations ont rendu les sauvages presque aussi méchants que nous. Je me borne à être un sauvage paisible dans la solitude que j’ai choisie auprès de votre patrie où vous devriez être. J’avoue avec vous que les belles lettres, et les sciences ont causés quelquefois beaucoup de mal.
Les ennemis du Tasse firent de sa vie un tissu de malheurs, ceux de Galilée le firent gémir dans les prisons à soixante et dix ans pour avoir connu le mouvement de la terre, et ce qu’il y a de plus honteux c’est qu’ils l’obligèrent à se rétracter.
Dès que vos amis eurent commencé le dictionnaire encyclopédique, ceux qui osaient être leurs rivaux les traitèrent de déistes, d’athées et même de jansénistes. Si j’osais me conter parmi ceux dont les travaux n’ont eu que la persécution pour récompense, je vous ferais voir une troupe de misérables acharnés à me perdre du jour que je donnai la tragédie d’Oedipe, une bibliothèque de calomnies ridicules imprimées contre moi, un prêtre ex-jésuite que j’avais sauvé du dernier supplice me payant par des libelles diffamatoires du service que je lui avais rendu ; un homme plus coupable encore faisant imprimer mon propre ouvrage du Siècle de Louis XIV avec des notes où la plus crasse ignorance débite les impostures les plus effrontées, un autre qui vend à un libraire une prétendue histoire universelle sous mon nom, et le libraire assez avide et assez sot pour imprimer ce tissu informe de bévues, de fausses dates, de faits, et de noms estropiés ; et enfin des hommes assez lâches et assez méchants pour m’imputer cette rapsodie. Je vous ferais voir la société infectée de ce nouveau genre d’homme inconnu à toute l’antiquité qui ne pouvant embrasser une profession honnête soit de laquais, soit de manoeuvre, et sachant malheureusement lire et écrire se font courtiers de la littérature, volent des manuscrits, les défigurent et les vendent. Je pourrais me plaindre qu’une plaisanterie faite il y a plus de trente ans, sur le même sujet que Chapelain eut la bêtise de traiter sérieusement, court aujourd’hui le monde par l’infidélité et l’infâme avarice de ces malheureux qui l’ont défigurée avec autant de sottise que de malice, et qui au bout de trente ans, vendent partout cet ouvrage lequel certainement n’est plus mien, et qui est devenu le leur ; j’ajouterais qu’en dernier lieu on a osé fouiller dans les archives les plus respectables et y voler une partie des mémoires que j’y avais mis en dépôt, lorsque j’étais historiographe de France, et qu’on a vendu à un libraire de paris le fruit de mes travaux. Je vous peindrais l’ingratitude, l’imposture et la rapine, me poursuivant jusqu’au pied des Alpes, et jusques au bord de mon tombeau.
Mais, Monsieur, avouez aussi que ces épines attachées à la littérature et à la réputation ne sont que des fleurs en comparaison des autres maux qui de tout temps ont inondés la terre. Avouez que ni Cicéron ni Lucrèce, ni Virgile ni Horace ne furent les auteurs des proscriptions de Marius, de Sylla, de ce débauché d’Antoine, de cet imbécile Lépide, de ce tyran sans courage Octave Cépias surnommé si lâchement Auguste.
Avouez que le badinage de Marot n’a pas produit la Saint-Barthélémy, et que la tragédie du Cid ne causa pas les guerres de la Fronde. Les grands crimes n’ont été commis que par de célèbres ignorants. Ce qui fait et ce qui fera toujours de ce monde une vallée de larmes c’est l’insatiable cupidité et l’indomptable orgueil des hommes, depuis Thamas Couli Can, qui ne savait pas lire, jusqu’à un commis de la douane qui ne sait que chiffrer. Les lettres nourrissent l’âme, la rectifient, la consolent ; et elles font même votre gloire dans le temps que vous écrivez contre elles. Vous êtes comme Achille qui s’emporte contre la gloire, et comme le père Malebranche dont l’imagination brillante écrivait contre l’imagination. Monsieur Chapui m’apprend que votre santé est bien mauvaise. Il faudrait la venir rétablir dans l’air natal, jouir de la liberté, boire avec moi du lait de nos vaches, et brouter nos herbes. Je suis très philosophiquement, et avec la plus tendre estime, Monsieur, Votre très humble et très obéissant serviteur Voltaire »
Réponse de Rousseau à François-Marie Arouet de Voltaire, Paris, 1755

Je conviens de toutes les disgrâces qui poursuivent les hommes célèbres dans la littérature. Je conviens même de tous les maux attachés à l’humanité, qui paraissent indépendants de nos vaines connaissances. Les hommes ont ouvert sur eux tant de sources de misères que quand le hasard en détourne quelqu’une, ils n’en sont guère plus heureux. D’ailleurs, il y a dans le progrès des choses des liaisons cachées que le vulgaire n’aperçoit pas, mais qui n’échappent point à l’oeil du Philosophe, quand il y voudra réfléchir. Ce n’est ni Cicéron, ni Virgile, ni Sénèque, ni Tacite qui ont produit les crimes des romains et les malheurs de Rome. Mais sans le poison lent et secret qui corrompait insensiblement le plus vigoureux gouvernement dont l’histoire fasse mention, Cicéron, ni Lucrèce, ni Salluste, ni tous les autres n’eussent point existé ou n’eussent point écrit. Le siècle aimable de Lelius et de Térence amenait de loin le siècle brillant d’Auguste et d’Horace, et enfin les siècles horribles de de Sénèque et de Néron, de tacite et de Domitien. Le goût des sciences et des arts naît chez un peuple d’un vice intérieur qu’il augmente bientôt à son tour, et s’il est vrai que tous les progrès humains sont pernicieux à l’espèce, ceux de l’esprit et des connaissances, qui augmentent notre orgueil et multiplient nos égarements, accélèrent bientôt nos malheurs : mais il vient un temps où le mal est tel que les causes même qui l’ont fait naître sont nécessaires pour l’empêcher d’augmenter : c’est le fer qu’il faut laisser dans la plaie, de peur que le blessé n’expire en l’arrachant. Quant à moi, si j’avais suivi ma première vocation et que je n’eusse ni lu ni écrit, j’en aurais sans doute été plus heureux. Cependant, si les lettres étaient maintenant anéanties, je serais privé de l’unique plaisir qui me reste : c’est dans leur sein que je me console de tous les maux ; c’est parmi leurs illustres enfants que je goûte les douceurs de l’amitié, que j’apprends à jouir de la vie et à mépriser la mort ; je leur dois le peu que je suis, je leur dois même l’honneur d’être connu de vous. Mais consultons l’intérêt dans nos affaires et la vérité dans nos écrits : quoiqu’il faille des Historiens, des Philosophes et de vrais savants pour éclairer le monde et conduire ses aveugles habitants, si le sage Memnon m’a dit vrai, je ne connais rien de si fou qu’un peuple de sages.
Convenez-en, Monsieur : s’il est bon que de Grands Génies instruisent les hommes, il faut que le vulgaire reçoive leurs instructions ; si chacun se mêle d’en donner, où seront ceux qui les voudront recevoir ? Les boiteux, dit Montaigne, sont mal propres aux exercices du corps, et aux exercices de l’esprit les âmes boiteuses. Mais en ce siècle savant on ne voit que boiteux vouloir apprendre à marcher aux autres. Le peuple reçoit les écrits des sages pour juger et non pour s’instruire. Jamais on ne vit tant de Dandins.(…) Recherchons la première source de tous les désordres de la société : nous trouverons que tous les maux des hommes leur viennent de l’erreur bien plus que de l’ignorance, et que ce que nous ne savons point nous nuit beaucoup moins que ce que nous croyons savoir. Or, quel plus sûr moyen de courir d’erreurs en erreurs que la fureur de savoir tout ? Si l’on n’eût prétendu savoir que la terre ne tournait pas, on n’eût point puni Galilée pour avoir dit qu’elle tournait, si les seuls Philosophes en eussent réclamé le titre, l’Encyclopédie n’eût point été persécutée. Si cent mirmidons n’aspiraient à la gloire, vous jouiriez paisiblement de la vôtre, et vous n’auriez au moins que des adversaires dignes de vous.
Ne soyez donc pas surpris de sentir quelques épines inséparables des fleurs qui couronnent les grands talents. Les injures de vos ennemis sont le cortège de votre gloire comme les acclamations satiriques étaient celui des triomphateurs. C’est l’empressement que le public a pour vos ouvrages qui produit les vols dont vous vous plaignez : mais les falsifications n’y sont pas faciles, car le fer ni le plomb ne s’allient point avec l’or. Permettez-moi, Monsieur, de vous le dire par l’intérêt que je prends à votre repos et à notre instruction : méprisez de vaines clameurs par lesquelles on cherche moins à vous faire du mal qu’à vous détourner de bien faire. Plus on vous critiquera, plus vous devez vous faire admirer ; un bon livre est une terrible réponse à des injures imprimées, et qui vous oserait attribuer des écrits que vous n’avez point faits, tant que vous continuerez à n’en faire que d’inimitables ? Je suis sensible à votre invitation, et si cet hiver me laisse en état d’aller au printemps habiter ma patrie, j’y profiterai de vos bontés, mais j’aimerais encore mieux boire de l’eau de votre fontaine que du lait de vos vaches, et quant aux herbes de votre verger, je crains bien de n’y en trouver guère d’autres que le lotus qui convient mal aux bêtes, et le mollé qui empêche les hommes de le devenir.
Je suis de tout mon coeur, et avec respect, Monsieur, Votre très humble et très obéissant serviteur. Jean-Jacques Rousseau »
Lettre de Rousseau à Voltaire (17 juin 1760)
« Je ne vous aime point, Monsieur ; vous m’avez fait les maux qui pouvaient m’être les plus sensibles, à moi, votre disciple et votre enthousiaste. Vous avez perdu Genève pour le prix de l’asile que vous y avez reçu ; vous avez aliéné de moi mes concitoyens pour le prix des applaudissements que je vous ai prodigués parmi eux ; c’est vous qui me rendez le séjour de mon pays insupportable ; c’est vous qui me ferez mourir en terre étrangère, privé de toutes les consolations des mourants, et jeté pour tout honneur dans une voirie, tandis que tous les honneurs qu’un homme peut attendre vous accompagneront dans mon pays. Je vous hais, enfin, puisque vous l’avez voulu ; mais je vous hais en homme plus digne de vous aimer si vous l’aviez voulu.(…) »
Sur Jean-Jacques Rousseau de Voltaire (1766)
« Cet ennemi du genre humain, Singe manqué de l’Arétin, Qui se croit celui de Socrate ; Ce charlatan trompeur en vain, Changeant cent fois son mithridate ; Ce basset hargneux et mutin, Bâtard du chien de Diogène, Mordant également la main Ou qui le fesse, ou qui l’enchaîne, Ou qui lui présente du pain. »
Repris de http://tecfa.unige.ch/proj/rousseau/voltaire.htm.
—-
Défense de Jean-Jacques Rousseau sur l’abandon de ses enfants
Lettre à Mme de Francueil, 20 avril 1751
« Oui, Madame, j’ai mis mes enfants aux Enfants-Trouvés ; j’ai chargé de leur entretien l’établissement fait pour cela. Si ma misère et mes maux m’ôtent le pouvoir de remplir un soin si cher, c’est un malheur dont il faut me plaindre, et non un crime à me reprocher. Je leur dois la subsistance ; je la leur ai procurée meilleure ou plus sûre au moins que je n’aurais pu la leur donner moi-même ; cet article est avant tout. Ensuite, vient la déclaration de leur mère qu’il ne faut pas déshonorer.
Vous connaissez ma situation ; je gagne au jour la journée mon pain avec assez de peine ; comment nourrirais-je encore une famille. (…)
Accablé d’une maladie douloureuse et mortelle, je ne puis espérer encore une longue vie ; quand je pourrais entretenir, de mon vivant, ces infortunés destinés à souffrir un jour, ils paieraient chèrement l’avantage d’avoir été tenus un peu plus délicatement qu’ils ne pourront l’être où ils sont. Leur mère, victime de mon zèle indiscret, chargée de sa propre honte et de ses propres besoins, presque aussi valétudinaire, et encore moins en état de les nourrir que moi, sera forcée de les abandonner à eux-mêmes ; et je ne vois pour eux que l’alternative de se faire décrotteurs ou bandits, ce qui revient bientôt au même. Si du moins leur état était légitime, ils pourraient trouver plus aisément des ressources. Ayant à porter à la fois le déshonneur de leur naissance et celui de leur misère, que deviendront-ils ? (…)
Ce mots d’Enfants-Trouvés vous en imposerait-il, comme si l’on trouvait ces enfants dans les rues, exposés à périr si le hasard ne les sauve ? Soyez sûre que vous n’auriez pas plus d’horreur que moi pour l’indigne père qui pourrait se résoudre à cette barbarie : elle est trop loin de mon c ur pour que je daigne m’en justifier. Il y a des règles établies ; informez-vous de ce qu’elles sont et vous saurez que les enfants ne sortent des mains de la sage femme que pour passer dans celle d’une nourrice. Je sais que ces enfants ne sont pas élevés délicatement : tant mieux pour eux, ils en deviennent plus robustes ; on ne leur donne rien de superflu, mais ils ont le nécessaire ; on n’en fait pas des messieurs, mais des paysans ou des ouvriers. Je ne vois rien, dans cette manière de les élever, dont je ne fisse choix pour les miens. Quand j’en serais le maître, je ne les préparerais point, par la mollesse, aux maladies que donnent la fatigue et les intempéries de l’air à ceux qui n’y sont pas faits. Il ne sauraient ni danser ni monter à cheval ; mais ils auraient de bonnes jambes infatigables. Je n’en ferais ni des auteurs ni des gens de bureau ; je ne les exercerais point à manier la plume, mais la charrue, la lime ou le rabot, instruments qui font mener une vie saine, laborieuse, innocente, dont on n’abuse jamais pour mal faire, et qui n’attire point d’ennemis en faisant bien. C’est à cela qu’ils sont destinés ; par la rustique éducation qu’on leur donne, ils seront plus heureux que leur père.
Je suis privé du plaisir de les voir, et je n’ai jamais savouré la douceur des embrassements paternels. Hélas ! je vous l’ai déjà dit, je ne vois là que de quoi me plaindre, et je les délivre de la misère à mes dépens. Ainsi voulait Platon que tous les enfants fussent élevés dans sa république ; que chacun restât inconnu à son père, et que tous fussent les enfants de l’Etat. Mais cette éducation est vile et basse ! Voilà le grand crime ; il vous en impose comme aux autres ; et vous ne voyez pas que, suivant toujours les préjugés du monde, vous prenez pour le déshonneur du vice ce qui n’est que celui de la pauvreté. »
—-
Extrait des Confessions
« Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont l’éxécution n’aura point d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme se sera moi.
Moi seul. Je sens mon coeur, et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j’ai vus ; j’ose croire n’être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien fait de briser le moule dans lequel elle m’a jeté, c’est ce dont on ne peut juger qu’après m’avoir lu.
Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra ; je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement : Voilà ce que j’ai fait, ce que j’ai pensé, ce que je fus. J’ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n’ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon ; et s’il m’est arrivé d’employer quelque ornement indifférent, ce n’a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J’ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l’être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus ; méprisable et vil quand je l’ai été, bon, généreux, sublime, quand je l’ai été : j’ai dévoilé mon intérieur tel que tu l’as vu toi-même, Être éternel. Rassemble autour de moi l’innombrable foule de mes semblables ; qu’ils écoutent mes confessions, qu’ils rougissent de mes indignités, qu’ils gémissent de mes misères. Que chacun d’eux découvre à son tour son coeur au pied de ton trône avec la même sincérité; et puis qu’un seul te dise, s’il l’ose : « Je fus meilleur que cet homme-là. »
Jean-Jaques Rousseau, Confessions, écrites de 1765 à 1770.
Extrait du Livre I , tiré dans Littérature 2de, édition Hatier, 1996.
Dans Clio-Texte, il y a d’autres textes de Voltaire et Rousseau .