Le témoignage de Simone Veil sur sa déportation à Auschwitz est extrait de son autobiographie , Une vie, publiée en 2007 aux Editions Stock.
« Le 13 avril, nous avons été embarquées à 5 heures du matin pour une nouvelle étape dans cette descente aux enfers qui semblait sans fin. Des autobus nous ont conduits à la gare de Bobigny, où l’on nous a fait monter dans des wagons à bestiaux formant un convoi aussitôt parti vers l’est. Comme il ne faisait ni trop froid ni trop chaud, le cauchemar n’a pas tourné au drame, et dans le wagon où nous nous trouvions toutes les trois, personne n’est mort au cours du voyage. Nous étions cependant effroyablement serrés, une soixantaine d’hommes, de femmes, d’enfants, de personnes âgées, mais pas de malades. Tout le monde se poussait pour gagner un peu de place. Il fallait se relayer pour s’asseoir ou s’allonger un peu. Il n’y avait pas de soldats au-dessus des wagons. La surveillance du convoi était seulement assurée par des SS dans chaque gare où il s’arrêtait. Ils longeaient alors les wagons pour prévenir que, si quelqu’un tentait de s’évader, tous les occupants du wagon seraient fusillés. Notre soumission donne la mesure de notre ignorance. Si nous avions pu imaginer ce qui nous attendait, nous aurions supplié les jeunes de prendre tous les risques pour sauter du train. Tout était préférable à ce que nous allions subir.
Le voyage a duré deux jours et demi ; du 13 avril à l’aube au 15 au soir à Auschwitz-Birkenau. C’est une des dates que je n’oublierai jamais, avec celle du 18 janvier 1945, jour où nous avons quitté Auschwitz, et celle du retour en France, le 23 mai 1945. Elles constituent les points de repère de ma vie. Je peux oublier beaucoup de choses, mais pas ces dates. Elles demeurent attachées à mon être le plus profond, comme le tatouage du numéro 78651 sur la peau de mon bras gauche. A tout jamais, elles sont les traces indélébiles de ce que j’ai vécu.Extrait du chapitre « la nasse », pp. 50-51
Le convoi s’est immobilisé en pleine nuit. Avant même l’ouverture des portes, nous avons été assaillis par les cris des SS et les aboiements des chiens. Puis les projecteurs aveuglants, la rampe de débarquement, la scène avait un caractère irréel. On nous arrachait à l’horreur du voyage pour nous précipiter en plein cauchemar. Nous étions au terme du périple, le camp d’Auschwitz-Birkenau.
Les nazis ne laissaient rien au hasard. Nous étions accueillis par des bagnards que nous avons aussitôt identifiés comme des déportés français. Ils se tenaient sur le quai en répétant : « Laissez vos bagages dans les wagons, mettez-vous en file, avancez. » Après quelques secondes d’hésitation, tout le monde s’exécutait. […] Vite, vite, il fallait faire vite. Soudain, j’ai entendu à mon oreille une voix inconnue me demander : « Quel âge as-tu ? » A ma réponse, 16 ans et demi, a succédé une consigne : « Surtout dis bien que tu en as 18. » […]
La file est arrivée devant les SS qui opéraient la sélection avec la même rapidité. Certains disaient : « Si vous êtes fatigués, si vous n’avez pas envie de marcher, montez dans les camions. » Nous avons répondu : « Non, on préfère se dégourdir les jambes. » Beaucoup de personnes acceptaient ce qu’elles croyaient être une marque de sollicitude, surtout les femmes avec des enfants en bas âge. Dès qu’un camion était plein, il démarrait. Quand un SS m’a demandé mon âge, j’ai spontanément répondu : « 18 ans. ». C’est ainsi que, toutes les trois, nous avons échappé à la séparation et sommes demeurées ensemble dans la file des femmes. Bien qu’elle ait été opérée peu de temps auparavant de la vésicule biliaire et ait conservé des séquelles de cette intervention, Maman, qui avait alors 44 ans, conservait une allure jeune. Elle était belle et d’une grande dignité. Milou avait alors 21 ans.
Nous avons marché avec les autres femmes, celles de la « bonne file », jusqu’à un bâtiment éloigné, en béton, muni d’une seule fenêtre, où nous attendaient les kapos ; des brutes, même si c’étaient des déportées comme nous, et pas des SS. Elles hurlaient leurs ordres avec une telle agressivité que, tout de suite, nous nous sommes demandé : « Qu’est-ce qui se passe ici ? » Elles nous pressaient sans ménagements : « Donnez-nous tout ce que vous avez, parce que de toute façon, vous ne garderez rien. » Nous avons tout donné, bijoux, montres, alliances. Avec nous se trouvait une amie de Nice arrêtée le même jour que moi. Elle conservait sur elle un petit flacon de parfum de Lanvin. Elle m’a dit : « On va nous le prendre. Mais moi je ne veux pas le donner, mon parfum. » Alors, à trois ou quatre filles, nous nous sommes aspergées de parfum ; notre dernier geste d’adolescentes coquettes.
Après cela, plus rien, pendant des heures, pas un mot, pas un mouvement jusqu’à la fin de la nuit, entassées dans le bâtiment. Celles qui avaient été séparées des leurs commençaient à s’inquiéter, se demandant où étaient passés leurs parents ou leurs enfants. Je me souviens qu’aux questions que certaines posaient les kapos montraient par la fenêtre la cheminée des crématoires et la fumée qui s’en échappait. Nous ne comprenions pas ; nous ne pouvions pas comprendre. Ce qui était en train de se produire à quelques dizaines de mètres de nous était si inimaginable que notre esprit était incapable de l’admettre. Dehors, la cheminée des crématoires fumait sans cesse. Une odeur épouvantable se répandait partout. Nous n’avons pas dormi cette nuit-là. »Extrait du chapitre « l’enfer », pp. 52-55
Simone Veil, Une vie, Paris, Livre de Poche, août 2009
Photo : © Centre de Documentation Juive de la Shoah – Mémorial de la Shoah
Des Lectures pour approfondir le sujet
Sur Auschwitz :
Un album D’Auschwitz – Comment les nazis ont photographié leurs crimes
Bruno Halioua – Les médecins d’Auschwitz
Jean-David Morvan, Victor Matet – Adieu Birkenau
Macha Ravine – Tout voir et ne rien oublier
Thomas Christiansen – Nous sommes ici pour mourir
Sur Simone Veil :
Annick Cojean – Simone Veil ou la force d’une femme
David Teboul – Simone et ses soeurs
Pascale Bresson – Simone Veil et ses sœurs, les inséparables
Autres liens :
https://clio-texte.clionautes.org/arrivee-a-auschwitz-temoignages.html






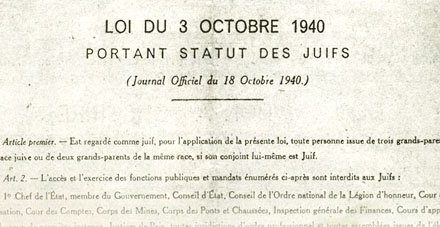








Trackbacks / Pingbacks