Dès la fin de la Première Guerre mondiale, les zones des grandes batailles du front occidental devinrent des lieux de mémoire et de visites touristiques. En témoigne la série des Guides illustrés Michelin des grandes batailles publiés à partir de 1919. Si dans l’immédiat après-guerre, ces champs de ruines attirent surtout des familles endeuillées venues se recueillir là où sont tombées leurs proches, le public se diversifie dans les années 20, permettant l’essor d’un véritable tourisme du souvenir. (1)
la ville belge d’Ypres fut ainsi un haut lieu du tourisme international du souvenir, attirant des visiteurs belges mais surtout britanniques, et devint « un lieu de pèlerinage de la nation anglaise ». Le secteur d’Ypres a été le théâtre, entre 1914 et 1918, de plusieurs batailles qui furent parmi les plus meurtrières de la guerre. C’est à Ypres que fut utilisée pour la première fois l’arme chimique (surnommée ypérite), le 22 avril 1915.
Le grand écrivain autrichien Stefan Zweig (1881-1942), qui n’a pas combattu sur le front, a cependant vécu la guerre comme un déchirement, à la fois personnel et historique. Nostalgique du monde d’hier, celui d’avant l’été 14, cet européen convaincu a puisé dans son expérience de la guerre un profond pacifisme, renforcé par sa correspondance et son amitié avec Romain Rolland. La grande guerre est également devenue une source d’inspiration pour le prolifique écrivain : nouvelles, oeuvre théâtrale, témoignages …
L’extrait présenté est issu d’un texte intitulé sobrement Ypres, publié en allemand en 1928. Ce texte est à mi-chemin entre le reportage et le récit de voyage. Dix ans après la fin de la guerre, Stefan Zweig effectue à Ypres une sorte de pèlerinage dans un lieu qu’il connaît particulièrement bien puisqu’il le fréquentait régulièrement avant guerre. Stefan Zweig nous fait part ici du profond malaise qu’il ressent face à l’exploitation touristique du souvenir de la guerre. Et pourtant, – et c’est ce qui rend ce texte encore plus intéressant -, il estime finalement que ce tourisme de guerre est malgré tout nécessaire s’il devient un tourisme contre la guerre.
Qu’aurait pensé Stefan Zweig en visitant Auschwitz, à l’ère du tourisme mondialisé et du selfie?
(1) : pour plus de détails, voir la préface rédigée par l’historienne Sabine Dullin Stefan zweig – Le monde sans sommeil
Désormais, le nom d’Ypres la “ville martyre”, brûle comme une torche sur toutes les affiches, de Lille à Ostende, d’Ostende à Anvers et jusque bien après la frontière hollandaise : voyages de groupe, excursions automobiles, circuits individuels, les offres se bousculent, chaque jour dix mille personnes (peut-être même plus !) passent ici quelques heures, à toute vitesse. Ypres est devenu le great show de la Belgique, une concurrence déjà dangereuse pour Waterloo, un lieu que chaque touriste doit avoir << fait >>> coûte que coûte. Votre première impulsion serait de résister, de ne pas vous laisser entraîner dans ce tourbillon de badauds visitant le champ de bataille après la fin des combats. Mais le sens des responsabilités nous pousse à ne pas concrète l’histoire de notre temps: la seule manière de rendre justice à l’effroyable passé, et donc à l’avenir, c’est de choisir nos points de repère avec force et en toute conscience.
Nous partons donc pour Ypres.
[…]
Une kermesse des morts
Ypres est désormais un lieu de pèlerinage de la nation anglaise. On peut le comprendre quand on a vu ces milliers et milliers de tombes, et cette stèle tragique à la mémoire des cinquante-six mille. Mais la densité du trafic est précisément ce qui menace l’impression de respect qui s’en dégage. Au plus fort de l’émotion, on est révulsé par une organisation qui fonctionne trop bien et trop précisément. Sur la place du marché, les voitures se pressent sur un parking comme devant un opéra, les cars verts, jaunes et rouges, ces baquets roulants, déversent heure après heure des milliers de personnes dans la ville, des armées entières de touristes qui, accompagnés de guides à la voix forte, observent les curiosítés (deux cent mille tombes!). Pour dix marks, on a tout : l’intégralité de la guerre de quatre ans, les tombes, les gros canons, les halles criblées de balles, avec lunch ou diner, tout confort et nice strong tea, comme on peut le lire sur tous les panneaux. Dans toutes les boutiques, le commerce des morts tourne à plein, on propose des accessoires de mode confectionnés à partir d’éclats d’obus (lesquels ont peut-être déchiré les entrailles d’un être humain), de jolis souvenirs du champ de bataille dont j’ai vu l’échantillon le plus épouvantable dans une vitrine, un Christ en bronze dont la croix était composée de cartouches ramassées sur le terrain. Dans les hôtels, on joue de la musique, les cafés sont pleins, les voitures foncent dans tous les sens, les appareils Kodak cliquettent. Tout est admirablement organisé, chaque curiosité dispose de sa dizaine de minutes, car il faut être revenu à sept heures, au plus tard, à Blanken Berghe, et à Ostende, […]
Et pourtant!
Et pourtant c’est une bonne chose qu’en quelques points de ce monde, il reste encore quelques signes atrocement visibles du grand crime. Au bout du compte, il est même bon que cent mille personnes viennent pétarader ici dans le confort et l’insouciance, car qu’ils le veuillent ou non, ces innombrables tombes, ces forêts emprisonnées, cette place en miettes sont des sources de souvenir. Et tout souvenir est d’une certaine manière formateur, même pour la nature la plus primitive et la plus endormie. Tout souvenir, qu’elles qu’en soient la forme et l’intention, ramène la mémoire vers ses effroyables années qu’on ne devra jamais oublier ni désapprendre. […]
Stefan Zweig, Ypres, 1928


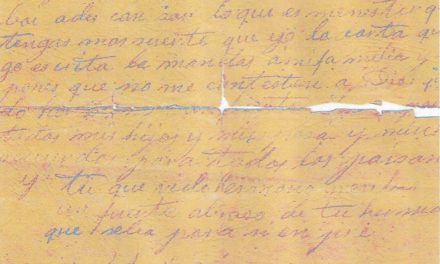
![Image illustrant l'article Amiens_capitale_provinciale___étude_[...]Deyon_Pierre_bpt6k3366710m de Clio Texte](https://clio-texte.clionautes.org/wp-content/uploads/cliotexte/2023/08/amiens-capitale-provinciale---etude--deyon-pierre-bpt6k3366710m-440x264.jpeg)









