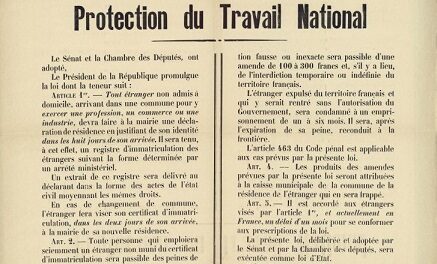Rien de nouveau sous le soleil ! Les Français et les Françaises se plaignaient déjà du retard fréquent des trains à la fin du 19ème siècle, selon le texte ci-dessous.
Cet extrait provient d’un livre de souvenirs d’Ernest Denormandie (1821-1902) publié en 1900, alors que l’auteur allait bientôt fêter ses 80 ans. E. Denormandie fut à la fois homme politique et homme d’affaires. Il fut député puis sénateur inamovible de 1876 jusqu’à sa mort en 1902. Il fut aussi un homme d’affaires important puisqu’il fut gouverneur de la banque de France de 1879 à 1881. Il fut aussi un administrateur de la compagnie privée de chemins de fer Paris-Lyon- Méditerranée, ce qui explique peut être son intérêt pour la question en transports en France.
En expliquant à ses contemporains comment fonctionnait le système national de transports routiers par diligence dans la première moitié du 19ème siècle, E. Denormandie met en relief l’ampleur de la révolution technique et logistique représentée par la création d’un réseau de chemin de fer national. Des années-lumière semblent séparer l’ère de la traction animale de celle du cheval-vapeur.
[…] Si nous voulons sortir de Paris, nous constatons que pour traverser la France dans tous les sens, pour gagner nos frontières de quelque côté que ce soit, ou entreprendre un voyage à l’étranger, nous avons une organisation admirable de voies ferrées, et cependant n’entend-on pas tous les jours des doléances de ce genre :
« Le train a été en retard ; c’est abominable! Nous avons failli ne pas avoir de places! Il y avait tant de voyageurs qu’on a dû dédoubler le grand express! Nous n’avons pu prendre que le second, ce qui nous a fait arriver un quart d’heure plus tard! Il est vraiment inouï que ces compagnies ne puissent pas arriver à temps, à l’heure exacte, à l’heure indiquée par elles-mêmes ; c’est le bouleversement de toutes les affaires ! »
Je ne me donne pas le mandat de répondre à toutes ces réclamations, le plus souvent si peu justifiées ; je voudrais simplement rappeler aux réclamants, sous quel régime vivaient, en matière de transports, les voyageurs d’il y a environ cinquante ans !
La France était sillonnée par les grandes routes de terre du premier empire qui étaient une magnifique création. Sur ces routes, il se trouvait de distance en distance, en général de trois en trois lieues en moyenne (aujourd’hui on dirait tous les dix ou douze kilomètres) un établissement dénommé : Poste aux chevaux. Ces établissements étaient l’objet d’un droit d’exploitation concédé à un particulier qui recevait un brevet et s’appelait Maître de Poste. Sous sa responsabilité personnelle, il établissait une maison de poste où il installait le nombre de chevaux qu’il jugeait lui être nécessaire pour faire conduire les voyageurs de toute sorte jusqu’au relais suivant.
Quelles étaient les voitures qui s’adressaient à ces maîtres de poste?
Les diligences.
Les malles-poste.
Les voitures des particuliers.
C’est ce qu’il faut maintenant vous expliquer.
Deux grandes entreprises de diligence s’étaient en quelque sorte partagé le sol de la France. Je laisse de côté, bien entendu, les petites voitures locales exploitant tels ou tels départements ou arrondissements; je parle des compagnies qui conduisaient les voyageurs au bout de la France : la Compagnie des messageries générales, la Compagnie des messageries royales, ayant leur siège principal à Paris, l’une, rue du Bouloi et rue Coq-Héron ; l’autre, rue Montmartre, avec sortie par la rue Joquelet.
Les voitures de ces deux entreprises étaient faites absolument sur le même modèle :
Un coupé, trois places ;
Intérieur, six places ;
La rotonde, six ou huit places ;
Impériale (banquette installée tout en haut de la voiture), trois places.
Le conducteur représentant la compagnie, maître et directeur de cette maison ambulante, était assis en tête de la banquette dénommée impériale ; c’était le personnage important, tenant les écritures, recevant le prix des places, payant le postillon à chaque relais, faisant arrêter les diligences à tel ou tel hôtel pour le repas, faisant au besoin la police.
Je dis : le postillon, parce que, pendant ma première jeunesse, celui que nous appelons aujourd’hui cocher était vraiment postillon : car il montait à cheval sur le premier cheval à gauche, que, pour cette raison, on nommait « le porteur», et de là, il conduisait les quatre ou les cinq chevaux de la diligence. Ce n’était pas une tâche facile ; il y fallait un bomme fort, habile, prudent, enfin réunissant beaucoup de qualités ; depuis on a pensé, et avec raison, qu’il était très hasardeux de faire conduire une si grande et lourde voiture par un homme à cheval, et pendant les vingt ou trente dernières années du règne des diligences, le cocher, quoique toujours habillé en postillon, montait s’asseoir sur un petit siège généralement placé entre l’impériale et les chevaux ; de là, l’homme, étant assis, conduisait à grandes guides avec une bien plus grande sûreté.
Ceci dit, voyons comment se faisait l’exploitation de ces diligences.
A chaque relais, en vertu de traités, le maître de poste leur fournissait les chevaux nécessaires.
Dans quelles conditions voyageait-on ? Que ceux qui se plaignent des chemins de fer s’instruisent ! […]
Ernest Denormandie, Temps passé. Jours présents, 1900, p. 277 et suivantes