Voir également la rubrique
http://clio-texte.clionautes.org/-liberation-et-reconstruction-.html
Le Plan
Jean Monnet pose l’impératif du Plan
Note de Jean Monnet au général de Gaulle, le 4 décembre 1945.
« La modernisation doit s’accompagner d’une expansion de la production française, tant pour permettre d’accroître la consommation intérieure que pour nous mettre en mesure de payer par l’exportation nos importations de matières premières, de charbon, de pétrole, et les biens d’équipement. Cet effort ne pourra donner de résultat que si, dans un grand nombre de branches, les coûts de production français sont égaux ou inférieurs aux coûts de production des pays concurrents. Enfin, la modernisation et l’équipement de l’économie française permettront d’alléger immédiatement les conditions de travail et ultérieurement (…) de réduire progressivement la durée du travail. (…)
Il est nécessaire d’aller vite. Sinon, nous risquons de voir l’économie française se cristalliser à un niveau de médiocrité contraire à l’intérêt de l’ensemble de la nation. (…)
Puisque l’exécution du plan exigera la collaboration de tous, il est indispensable que tous les éléments vitaux de la nation participent à son élaboration. C’est pour cela que la méthode de travail proposée associe dans chaque secteur l’administration responsable, les experts les plus qualifiés, les représentants des syndicats professionnels (ouvriers, cadres et patrons). »
in Ch. de GAULLE, Mémoires de guerre: Le Salut, Plon, 1959.
Le blocage
1945.(18 janvier) …
« On nous a saisis d’un budget dont les dépenses sont trois fois et demie plus élevées que les recettes, sans qu’aucun effort de compression, de classification des urgences ait été opéré ; on annonce l’amnistie pour ceux qui déclareront, avec quelque retard, leurs avoirs à l’étranger ; on nous fait prévoir l’emprunt à jet continu. Tout cela a été fait et refait vingt fois dans les années d’avant-guerre avec les résultats que l’on connaît.
Politique de confiance, c’est-à-dire politique de facilité ; cette facilité porte un nom qui est l’inflation, l’inflation sans contrepartie ni contre-mesure.
Seule l’inflation permet à la fois de satisfaire les demandes d’augmentation de salaires, d’accorder des accroissements de tarifs ou de prix au marché officiel ou au marché noir) et même des dégrèvements fiscaux, le tout sans inquiéter sérieusement ceux qui ont accumulé des avoirs considérables et cachés, et sur qui l’on compte au fond pour souscrire aux futurs emprunts; en même temps, l’inflation gorge les spéculateurs d’une hausse constante et assurée, les enrichit automatiquement; mais ne voit-on pas qu’ils sont les seuls bénéficiaires et les principaux soutiens de la politique de faiblesse à laquelle on reste malheureusement attaché…
Or, j’y reviens, distribuer de l’argent à tout le monde sans en reprendre à personne, c’est entretenir un mirage, un mirage qui autorise chacun à croire qu’il va vivre aussi bien, et faire autant et plus de bénéfices qu’avant la guerre; alors que les dévastations, les spoliations, l’usure du matériel et des hommes ont fait de la France un Pays pauvre, alors que la production nationale est tombée à la moitié du niveau d’avant-guerre, C’est la solution commode immédiatement. Car plus on fait fleurir le marché noir par l’inflation, plus on y fait monter les prix et plus se dérobe le mirage d’un » marché noir pour tous « , plus on augmente l’écart entre prix illicites et Prix taxés et moins il vient de produits sur le marché régulier, plus se confirme le privilège des riches et se détériore la condition des pauvres. Combien de temps ce jeu peut-il durer et où mène-t-il ?…
La course sans fin ne peut être stoppée que si le Gouvernement, par des décisions courageuses et qui frappent l’opinion, témoigne enfin de sa volonté de briser le circuit inflation.
J’ai peur, mon Général, que par un souci très compréhensible d’arbitrage, vous n’incliniez &-faciliter, ou tout au moins à admettre, les compromis. Mais il est des matières où la demi-mesure est une contre-mesure; qui ne le sait mieux que vous ?… »
in P. Mendès France, Lettre de démission au général de Gaulle, reprise jusqu’au 4 avril à la demande de celui-ci.
La voie progressive
1945 (17 avril)
« J’aurais pratiqué une politique de complet laisser-aller en matière budgétaire comme en matière fiscale. Je n’aurais fait aucun effort d’économies. Je refuserais ou j’ajournerais systématiquement les réformes de structure, je serais en un mot le défenseur des trusts… Vous n’avez certes pas donné à vos critiques une forme aussi acerbe…
Pourquoi nos charges financières sont-elles aussi lourdes qu’en 1945 qu’en 1943 ou 1944? Tout simplement parce que le budget de 1943 et de 1944, s’il était grévé par la charge énorme des frais d’occupation ne comportait pratiquement plus aucun crédit militaire. Or nous avons cette année près de 200 milliards de dépenses militaires… Je pense… que, dans leur principe, une large partie de ces dépenses est exagérée ou prématurée, la situation économique de la France n’étant pas suffisamment rétablie pour lui permettre de consacrer d’ores et déjà l’essentiel de ses forces à la reconstitution de son armée. J’ai attiré sur ce point l’attention du Président du gouvernement… »
de R. Pleven, à P. Mendès France qui a démissionné du ministère de l’Économie nationale. Archives du ministère des Finances.
Le choix
« Les uns déclarent: » Face à l’inflation, prenons le taureau par les cornes. Opérons dans les liquidités une ponction radicale en décrétant tout à coup que les billets actuels n’ont plus cours, que les porteurs doivent sans délai les échanger aux caisses publiques, qu’il ne leur sera remis en vignettes nouvelles que le quart de leur avoir et que le solde sera inscrit au crédit des propriétaires mais sans pouvoir être utilisé En même temps, bloquons les comptes et ne laissons, à chaque détenteur, la faculté de prélever sur le sien que des sommes très limitées. De cette façon, nous réduirons les possibilités d’achat et, du même coup, le champ du marché 1 noir. Quant aux prix, bloquons-les aussi et à un niveau assez bas pour que les consommateurs, restreints dans leurs moyens de paiement, puissent tout de même payer ce qui leur est nécessaire. Seuls les produits de luxe renchériront à volonté. On doit prévoir, évidemment, que les ressources du Trésor seront gravement affectées par un pareil resserrement. Il n’est, pour y parer, que d’instituer un grand impôt sur le capital Ces dispositions sont dures. Mais, pour peu que le général de Gaulle y applique son autorité, elles permettront de surmonter la crise. »
D’autres disent: » L’inflation est moins la cause que l’effet du déséquilibre. Celui-ci est inévitable. En temps de guerre totale, rien ne peut faire que la production des denrées et des objets de consommation soit maintenue au niveau normal, puisque beaucoup de matières, d’outillages et de travailleurs sont employés à d’autres fins.
Des artifices brutaux ajouteraient à notre mal en enlevant aux producteurs l’envie et les moyens de se mettre à l’ouvrage et en ruinant décidément le crédit de l’État et celui de la monnaie. Au contraire, poussons l’économie au démarrage et à l’expansion. Quant à l’excès des liquidités, épongeons-le par des bons du trésor qui favorisent l’esprit d’épargne et répandent dans le public le sentiment que chacun dispose de ce qui lui appartient, Dans le même ordre d’idées, gardons-nous de tout impôt systématique sur le capital. Poursuivons simplement la confiscation des enrichissements coupables. Cette méthode n’est pas miraculeuse. Mais, grâce à la confiance que le pays fait à de Gaulle, elle nous mènera au redressement. »
C’est à moi, en dernier ressort, qu’il appartient de trancher.
Il faut dire que cette affaire divise le gouvernement, Les deux thèses y ont chacune un protagoniste , ardent autant que qualifié. Mendès France, ministre de l’Économie nationale, s’identifie à la première. Pleven, ministre des Finances, soutient la seconde à fond. Comme tous les deux sont des hommes de qualité et d’ambition, que de ce fait ils rivalisent, qu’ils se trouvent porter en la matière une responsabilité égale, l’un pour les prix et les échanges, l’autre pour le budget et la monnaie, que le litige concerne un problème dont dépend le sort du peuple français, toute cote mal taillée serait, à mes yeux, aussi vaine qu’inconvenante. Après en avoir longuement débattu avec eux et en moi-même, j’opte pour la voie progressive et je repousse le blocage.
… Que la nation libérée produise le plus possible! Que l’État l’y aide et l’y pousse! Qu’en échange elle lui fournisse, sous forme d’impositions normales et de placements de l’épargne, de quoi couvrir les dépenses qu’il assume pour le salut public ! Telle est la décision prise en mars 1945.
Comme il est naturel, Pierre Mendès France quitte le gouvernement, sur sa demande, au mois d’avril, Il le fait avec dignité. Aussi gardé-je mon estime à ce collaborateur d’une exceptionnelle valeur. Au demeurant, si je n’adopte pas la politique qu’il préconise, je n’exclus nullement de la faire mienne un jour, les circonstances ayant changé. Mais, pour que Mendès France soit, éventuellement, en mesure de l’appliquer, il faut qu’il sache rester fidèle à sa doctrine. C’est dans ce sens que, pour un ministre, le départ peut être un service rendu à l’État. Je réunis en un seul ministère celui des Finances et celui de l’Économie. Pleven en reçoit la charge. Compagnon d’un esprit brillant et étendu qui s’applique à être modeste, commis voué aux tâches compliquées qui les embrasse d’une souple étreinte, il s’acquitte de ses fonctions sans que notre misère lui permette de spectaculaires succès, mais de telle façon que le pays progresse en fait de ressources et de crédit, Bien que, parfois, je juge ses détours superflus, sa plasticité excessive, je lui accorde ma confiance et ne cesse de le soutenir. »
in Ch de Gaulle, Mémoires de guerre, 1959
Les entreprises nationalisées
- Charbonnages: bassin du Nord-Pas-de-Calais (décembre 1944), puis ensemble des bassins (mai 1946)
- Électricité et gaz (avril 1946)
- Transports aériens Juin 1945)
- Transports maritimes (décembre 1944)
- Banque de France et quatre grandes banques de dépôts: Crédit lyonnais, Société générale, Comptoir national d’escompte, Banque nationale pour le commerce et l’industrie (décembre 1945)
- Grandes compagnies d’assurance (avril 1946)
- Usines Renault janvier 1945)
- Usines Gnome et Rhône de construction de moteurs d’avions, future SNECMA (mai 1945)
L’hostilité patronale
« Le patronat français proteste avec force contre les ravages croissants de l’étatisation sous toutes ses formes (…). Un gouvernement aux prises avec un déficit catastrophique de son budget et une pléthore insupportable de ses fonctionnaires serait bien avisé de limiter ses tâches immédiates et de ne pas s’aventurer dans une extension de ces nationalisations dont un nombre croissant de Français commencent à comprendre qu’elles sont un leurre et fort ruineuses. Les opérations réalisées ont profondément démoralisé l’épargne (…). L’industrie de transformation peut ne pas se sentir directement menacée par le programme de nationalisations. Elle n’a pas moins un besoin impérieux qu’on lui assure aux meilleures conditions son charbon, son électricité, ses matières premières, son crédit. Or les premiers résultats d’exploitation des sociétés nationales n’ont rien, à cet égard, de particulièrement rassurant Rien n’est possible sans un renouveau de l’esprit d’entreprise. »
Lettre de la Commission d’organisation du CNPF au président du gouvernement provisoire. 21 février 1946. Citée par G. LEFRANC, Les Organisations patronales en France, Payot, 1976.
Les nationalisations : une erreur
1949 (août)
« Ainsi, après toutes les critiques produites ça et là dans la presse économique, ou dans la presse d’opinion, il ressort que l’appareil des nationalisations fonctionne peu ou fonctionne mal ; qu’il ne correspond, en aucun cas, aux méthodes en usage dans l’industrie et le commerce ; qu’il contient en soi des vices fondamentaux : abaissement de l’autorité directrice, insuffisance du contrôle de la main-d’oeuvre employée, absence de tenue régulière de comptabilité allant jusqu’à l’infraction pénale puisque, notamment, dans le cas de la Société nationale des entreprises de presse et de la nouvelle société Air-France, les cotisations d’assurances sociales n’ont pas été payées; dispersion des autorités de contrôle et indifférence à leur mission des fonctionnaires qui l’exercent, les retards apportés à la présentation de leurs rapports l’attesteraient à défaut d’autres preuves; enfin et surtout, introduction d’un tiers pouvoir, celui des syndicats politiques agissant, par l’intermédiaire des commissions paritaires ou de leur propre initiative, sur le comportement du personnel.
Il n’est pas surprenant que, dans de telles conditions, le régime des nationalisations n’ait nullement répondu aux espoirs de ceux qui l’ont mis en vigueur.
Au surplus, les entreprises nationalisées, qui sont toutes déficitaires, qui toutes accusent, sur les exploitations auxquelles elles ont été substituées, une diminution du rendement productif, qui toutes, loin de donner au public, les avantages qu’on faisait briller à ses yeux, n’ont cessé de relever les prix de leurs services ou de leurs marchandises, ces sociétés nationalisées ne sont même pas exemptes des risques que font courir à l’entreprise privée les revendications ouvrières. Les grèves y sont plus tenaces qu’ailleurs, elles y sont plus fréquentes, plus généralisées; de surcroît, elles mettent en danger la vie même de la nation sans qu’il soit possible pour les travailleurs d’en tirer le moindre avantage supplémentaire; enfin, elles compromettent l’autorité même de l’État qui ne s’exerce plus qu’à travers des concessions incessantes aux auteurs d’une agitation plus souvent politique que professionnelle et qui, d’ailleurs, l’entendent bien ainsi. On a pu dire: » C’est la, C. G. T. qui gouverne la France. » Etait-ce absolument déraisonnable ? »
Pierre Da Costa-Noble, in Politique, no 14
Les nationalisations : une nécessité pour le pays
1949
« Dans le monde ouvrier une équivoque n’a pas cessé de se manifester sur l’objectif même de la nationalisation. S’agit-il d’une opération d’intérêt général, ou le but premier en est-il de changer la condition même du personnel que les entreprises emploient? C’est un fait que les grandes entreprises nationalisées se sont vu l’une après l’autre appliquer un statut spécial pour leur personnel, dont l’effet est de leur imposer des charges sans commune mesure avec celles que supporte l’économie privée.
Que l’on envisage les tarifs relativement abaissés de l’électricité ou du gaz, ou les obstacles fondamentaux à l’équilibre de la S.N.C.F, dès que la situation des transports redevient normale, il apparaît que les entreprises nationalisées ne sont pas, comme disait un leader de la droite, des machines à perdre de l’argent, mais bien plutôt des machines à faire gagner de l’argent à d’autres. Le patronat serait-il capable de conduites rationnelles en ces matières, il aurait tôt fait de découvrir l’avantage qu’il retire de l’existence d’un secteur public dont les tarifs, par leur niveau ou leur structure, constituent une subvention majeure et continue aux entreprises capitalistes. Qu’une dépression économique se développe, on reconnaîtra aussi quel puissant instrument de stabilisation de l’activité constitue un vaste secteur nationalisé, capable de poursuivre et d’accélérer ses investissements et de travailler pour l’avenir, même si l’état présent du marché ne paraît pas garantir des débouchés immédiatement rentables. Mais l’opposition à cette transformation est affaire de principe et de croyance; elle n’est pas fondée sur le calcul. Elle est, sous une forme larvée, une guerre de religion. »
Pierre Uri, Les Temps Modernes, no 45
Un fier complice
« J’avais, en arrivant à la direction du Trésor en 1947, une sorte d’idée fixe. Je souhaitais que le ministère des Finances sortit de son attitude traditionnelle à l’égard de l’économie, attitude consistant à agir contre ce qui paraît inopportun ou nocif, plutôt qu’à agir pour ce qui peut être bénéfique. Je souhaitais qu’il jouât un rôle délibérément positif dans la Modernisation et l’équipement du pays. (…) Ma conviction personnelle était que le Trésor public devait devenir le facteur actif de la reconstruction puis de l’expansion. Je crois pouvoir dire que mes principaux efforts ont tendu à cela. Depuis 1880 (…) la France était malthusienne. Un peu de fuite en avant ne pouvait pas lui faire de mal. Il fallait donc profiter de ce moment exceptionnel (Jean Monnet l’outsider) pour changer de pied, même sans bien savoir où l’on marchait. Le premier plan était assez bâclé. Il n’était pas solvable. Mais si on l’avait fignolé, il ne serait jamais sorti. Et la France n’aurait pas pris, dans ce grand tournant, son nouveau visage. De cette heureuse imposture, gardien de la caisse, j’ai été le fier complice. »
F. BLOCH-LAINÉ, Profession fonctionnaire, Le Seuil, 1976.
Les critiques de Pierre Mendès France
« Il y a eu le Plan Monnet. Il était, à vrai dire, d’une grande timidité si nous le comparons aux plans des autres pays européens. Sous des pressions démagogiques, nous avons sacrifié ce plan à des satisfactions immédiates ou, plutôt, à des promesses de satisfactions immédiates. En fait, nous avons, dans l’ensemble, réalisé seulement la moitié du chemin que le Plan Monnet prétendait nous faire parcourir, et même moins que la moitié, dans certains domaines vitaux. (…) La politique d’investissements n’a, en réalité, été défendue par personne, sauf en principe, et dans quelques discours. Au fond, les uns y étaient hostiles par esprit de routine, par crainte de bousculer des intérêts acquis, par crainte aussi des changements sociaux qui pourraient devenir indispensables pour redistribuer Une production accrue si elle s’était réalisée. Quant aux autres, favorables au fond à une politique de progrès, ils n’ont malheureusement jamais osé dire qu’elle ne pouvait réussir que par une limitation préalable de la consommation et l’ajournement momentané de certaines satisfactions. Voilà pourquoi les investissements n’ont jamais été vraiment défendus. Au fur et à mesure que nous nous remettions de nos grandes épreuves, que la production reprenait, elle était immédiatement consommée, et dissipée, au lieu qu’en soit réservée une fraction croissante pour ménager un avenir plus prospère et aussi plus juste. »
P. MENDÈS FRANCE, Discours du 27 décembre 1950 à l’Assemblée nationale.
Les ambitions du deuxième Plan
« Ma préoccupation était d’arriver à résoudre un problème fondamental pour la France, qui était l’équilibre de ses échanges extérieurs, dont la structure et le déficit appelaient des transformations fondamentales. La première à laquelle nous nous sommes attaqués a été celle de l’agriculture, qui vivait dans la philosophie de Méline, c’est-à-dire l’autarcie avec des barrières extérieures et aucune ambition exportatrice, à part les vins et les liqueurs. Nous avons persuadé le gouvernement que la vocation de l’agriculture française était exportatrice. (…) En ce qui concerne l’industrie, nous avions de graves lacunes dans certains domaines et, sans tambours ni trompettes, le commissariat au plan s’est efforcé de trouver des industriels capables de les remplir. Par exemple, non sans difficultés, nous avons fini par fabriquer nous-mêmes les caoutchoucs synthétiques qu’auparavant nous importions intégralement. Les structures industrielles étaient vétustes. Le premier Plan avait modifié les structures de la sidérurgie, mais dans les industries mécaniques il y avait un effort énorme à faire. On a obtenu du ministère des Finances que la fiscalité, qui rendait impossible les fusions d’entreprises, soit transformée, et j’ai obtenu la fusion de ces entreprises importantes qui se concurrençaient sur les marchés extérieurs : Cail et Fives-Lille.
C’est au cours des IIe et IIIe Plans qu’on a avancé un programme de constructions scolaires qu’on a lancé une politique de décentralisation qu’on a institué les péages qui ont permis de lancer un programme d’autoroutes, pour lequel on avait un retard considérable, et de réaliser le pont de Tancarville; qu’on a créé la vignette automobile qui a financé les allocations vieillesse au début de 57, et c’est à la même époque qu’on a institué une taxe particulière sur les carburants. Ma préoccupation était de freiner cette débauche de l’automobile en France (…) : on chargeait le transport automobile par des taxes énormes et on subventionnait le logement.
Témoignage d’Étienne Hirsch, Commissaire général du deuxième Plan, cité dans F. FOURQUET, Les Comptes de la puissance, Ed. Recherches, 1980.
Le départ de de Gaulle
Le conflit entre le général de Gaulle et les partis
Déclaration du général de Gaulle à l’Assemblée constituante, le 1er janvier 1946.
« Je me demande quelle étrange conception l’orateur * se fait du Gouvernement de la République! Il nous dit : » Dans la matière grave qu’est celle des crédits de la Défense nationale, le Gouvernement considère une chose comme nécessaire L’Assemblée ne veut pas la reconnaître comme telle. Le Gouvernement n’a qu’à en prendre son parti. »
La même question s’est posée hier à propos des fonctionnaires et avant-hier à propos de la nationalisation du crédit. Elle se posera demain sur n’importe quelle autre question.
Or, ce régime d’une Assemblée qui gouverne elle-même, (…) ce régime est concevable, mais ce n’est pas celui que conçoit le Gouvernement. Je ne l’ai jamais caché en prenant les fonctions que vous avez bien voulu m’attribuer (…).
Veut-on un Gouvernement qui gouverne ou bien veut-on une Assemblée omnipotente déléguant un Gouvernement pour accomplir ses volontés ? (…)
La formule qui s’impose, à mon avis, après toutes les expériences que nous avons faites, c’est un Gouvernement qui ait et qui porte seul – je dis : seul – la responsabilité entière du pouvoir exécutif.
Si l’Assemblée, ou les Assemblées, lui refusent tout ou partie des moyens qu’il juge nécessaires pour porter la responsabilité du pouvoir exécutif, eh bien! ce Gouvernement se retire. Un autre Gouvernement apparaît. C’est d’ailleurs, me semble-t-il, ce qui va justement arriver (…). »
extrait de Charles de GAULLE, Mémoires de guerre, III, Le Salut, Paris, Plon, 1959.
* Le socialiste André Philipp
Pourquoi les Français ont laissé partir le général de Gaulle
« – Comment expliquez-vous cette espèce d’atonie de l’opinion dans cette circonstance? On a l’impression que les Français n’ont pas réagi, sont restés presque indifférents…
– Nous sommes déjà, à ce moment-là, dix-huit mois après la Libération et je pense que les sentiments très vifs qui avaient été provoqués chez les Français par l’émotion des derniers combats, la joie de la Libération, l’enthousiasme pour les chars de Leclerc – pour ceux-là comme pour ceux des Américains, car il faut bien le dire, les Français ne faisaient pas le détail -, tout cela est retombé. Les difficultés de l’existence quotidienne l’ont emporté sur les sentiments politiques et patriotiques. D’autre part, ce qui comptait avant tout, pour le Général, c’était la politique étrangère, c’était le rang de la France dans le monde; or, c’était là quelque chose que les Français ne ressentaient absolument pas à cette époque.
– Mais n’y a-t-il pas là, justement, une faiblesse politique du Général, que l’on a constatée à d’autres moments ?
– Bien sûr. Il y a le hiatus, la distance entre ses propres conceptions, ce qui, pour lui, est le plus important, et ce qui l’est, au jour le jour, pour le Français moyen. Dans les moments de grande crise, il y a accord entre » la France dans ses profondeurs » et ce qu’il veut, accord quelquefois dans l’enthousiasme, quelquefois dans la crainte – la « trouille », comme il disait -, mais il faut une crise pour que le courant passe de nouveau. Or, janvier 1946 n’est pas une période de crise : d’où, je pense, l’atonie de l’opinion. »
Témoignage de François GUGUEL, Secrétaire général du Sénat, Les Départs du général de Gaulle, in L’Histoire n° 11, avril 1979, Le Seuil.
Le discours de Bayeux
« Du Parlement, composé de deux Chambres et exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que le pouvoir exécutif ne saurait procéder, sous peine d’aboutir à cette confusion des pouvoirs dans laquelle le gouvernement ne serait bientôt plus rien qu’un assemblage de délégations. Sans doute aura-t-il fallu, pendant la période transitoire où nous sommes, faire élire par l’Assemblée nationale constituante le président du gouvernement provisoire, puisque, sur la table rase, il n’y avait aucun autre procédé acceptable de désignation. Mais il ne peut y avoir là qu’une disposition du moment. En vérité, l’unité, la cohésion, la discipline intérieure du gouvernement de la France doivent être des choses sacrées, sous peine de voir rapidement la direction même du pays impuissante et disqualifiée. Or, comment cette unité, cette cohésion, cette discipline, seraient elles maintenues à la longue, si le pouvoir exécutif émanait de l’autre pouvoir, auquel il doit faire équilibre, et si chacun des membres du gouvernement, lequel est collectivement responsable devant la représentation nationale tout entière, n’était, à son poste, que le mandataire d’un parti ?
C’est donc du chef de l’État, placé au dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement mais beaucoup plus large et composé de manière à faire de lui le président de l’Union française en même temps que celui de la République, que doit procéder le pouvoir exécutif. Au chef de l’État la charge d’accorder l’intérêt général quant au choix des hommes avec l’orientation qui se dégage du Parlement. A lui la mission de nommer les ministres et, d’abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement. Au chef de l’État la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, car c’est envers l’État tout entier que ceux-ci et celles-là engagent les citoyens. A lui la tâche de présider les Conseils du gouvernement et d’y exercer cette influence de la continuité dont une nation ne se passe pas. A lui l’attribution de servir d’arbitre au dessus des contingences politiques, soit normalement par le Conseil, soit, dans les moments de grave confusion, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa décision souveraine. A lui, s’il devait arriver que la patrie fût en péril, le devoir d’être le garant de I’Indépendance nationale et des traités conclus par la France. »
extrait de Général de Gaulle, Mémoires de Guerre, t. III, Paris, Plon, 1959.
De Gaulle hostile aux projets de la Constituante
« Louis Joxe. – Ce qui me frappait, c’était évidemment le fossé qui se creusait de plus en plus entre la Constituante et le général de Gaulle. Car, en dehors de tous les incidents, menus incidents de personnes ou incidents par exemple de la discussion du budget ou des prises de positions sur la défense nationale et autres sujets, à mon avis le point essentiel était que le général voyait l’Assemblée s’engager vers une solution qu’il ne pouvait pas tolérer, à savoir le gouvernement d’Assemblée : un président du Conseil ou un Premier ministre élu par l’Assemblée, venant devant elle, » planchant » devant elle, comme on dit pour les examens, ne pouvant constituer son équipe qu’après avoir reçu l’investiture de cette Assemblée, obligé de se livrer à des dosages, à des marchandages ; un président de la République dénué de toute véritable autorité, d’autorité exécutive si vous voulez, au sens le plus restreint du terme, et même dépourvu de tout moyen d’être réellement l’arbitre. »
Louis Joxe, in Mémoires de votre temps, op. cit.
Préambule de la Constitution de 1946 (27 octobre)
« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République…
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité…
La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. »
La situation à la veille des élections du 10 novembre 1946
« Nous voici nantis d’une Constitution repoussée par la capitale de la France et votée à la minorité de faveur: 9 millions de » oui » contre 15 millions de » non » et d’abstentions.
Les électeurs viennent ainsi de désavouer les députés des trois partis qu’ils avaient élus le 2 juin et qui avaient voté quelques jours plus tôt cette Constitution, à l’énorme majorité de 404 voix contre 106. Et maintenant ? Les Français vont voter le 10 novembre, suivant le mode électoral du 2 juin dont nous venons de voir qu’il déforme la volonté populaire. Il a d’autres défauts. Il ne permet pas à l’électeur de choisir librement son député, ni même de rayer sur une liste le nom d’un candidat qui lui paraît incapable ou malhonnête. (…)
Les électeurs n’ont plus le droit de se tromper car, cette fois, les députés seront élus pour cinq ans. Si leurs choix sont mauvais tout redressement sera impossible. Le parti le plus puissant parce que le plus homogène et le plus discipliné, qui contrôle la CGT et qui, par là, peut agir sur le gouvernement par la menace de grèves, est le parti communiste. Il a, auprès d’une grande fraction de la classe ouvrière, le prestige du parti qui sait comment on fait une révolution pour l’avoir faite et réussie en Russie.
Il perd du terrain dans les villes où le sentiment national se révolte contre son allégeance à un pays étranger. (…)
Le parti socialiste est en porte à faux. Il est partagé entre deux soucis : garder ce qui lui reste de troupes ouvrières à gauche et garder, à droite, les demi-prolétaires en faux-col qu’il a enlevés au parti radical. D’où son attitude hésitante. (…)
Le MRP avait fait naître de grands espoirs et il a obtenu de grands succès. Il était dirigé par des hommes nouveaux ayant participé à la Résistance et il donnait l’impression d’apporter dans la vie publique une fraîcheur qui enchanta beaucoup de Français. Les femmes, sur lesquelles le clergé a plus d’influence que sur les hommes, allèrent en foule vers le parti nouveau. La deuxième Constituante lui fut funeste.Sa fraîcheur s’est fanée. Il est paru comme un parti opportuniste, plus roué que ceux d’avant-guerre. »
Paul Reynaud, « La situation politique en France » , La Revue de Paris, n° 11, novembre 1946.
L’année 1947
L’année 1947 : la naissance du R.P.F. le 7 avril 1947
» Une fois la victoire acquise et le pays consultés par la voie des élections, les partis sont apparus, impatients de leur avènement, et d’accord entre eux sur ce point seulement, que la voie leur fut laissée libre. Dans de telles conditions, et étant écartée par moi toute aventure plébiscitaire, dont je suis convaincu, que dans l’état de l’esprit public et dans la conjoncture internationale, elle aurait finalement abouti à des secousses désastreuses, il n’y avait pour l’homme qui vous parle, que deux solutions possibles ; ou bien entrer dans le jeu des partis, ce qui eût, je le crois, abaissé sans aucun profit cette sorte de capital national que les événements l’ont conduit à représenter, et en venir rapidement à transiger sur l’essentiel. Ou bien laisser les partis faire leur expérience, non sans avoir, auparavant, fait réserver au peuple lui-même la faculté de décider par la voie du référendum, du régime qui serait adopté. J’ai choisi cette deuxième solution. On sait ce qu’il est advenu. La condition, suivant laquelle tous les pouvoirs se trouvent procéder dans leur source et dépendent dans leur fonctionnement, d’une manière directe et exclusive, des partis et de leurs combinaisons, a été acceptée par 9 millions d’électeurs, refusée par 8 millions, ignorée par 8 millions Mais elle est entrée en vigueur. On peut constater aujourd’hui ce qu’elle donne.
Voilà, en vérité, où nous en sommes, et voilà ce que nous avons à faire. Si nous n’étions pas le peuple français, nous pourrions reculer devant la tâche et nous asseoir au bord de la route en nous livrant au destin. Mais nous sommes le peuple français. Alors que beaucoup nous tenaient pour perdus, ou tout au moins pour bien malades, nous avons su fournir l’effort héroïque et organiser la résistance nationale qui nous a permis de sortir, dans les rangs des vainqueurs, du plus grand drame de notre histoire. A l’heure qu’il est, nos soldats qui rétablissent la paix en Indochine font preuve d’autant de courage et d’autant de dévouement que jamais soldats n’en montrèrent. Nous ne sommes devenus ni bêtes, ni paresseux, ni corrompus. Malgré toutes ces pertes, notre race n’est nullement en voie de disparition et même les jeunes mamans de France ont mis au monde, l’année dernière, plus de bébés que nous n’en avions compté annuellement depuis cent ans. Si nous avons notre grande peine et notre lourd fardeau, toutes les nations ont les leurs et certaines d’entre elles s’en trouvent aussi éprouvées que nous.
Il est temps que les Français et les Françaises qui pensent et qui sentent ainsi, c’est-à-dire, j’en suis sûr, la masse immense de notre peuple, s’assemblent pour le prouver. Il est temps que se forme et s’organise le Rassemblement du Peuple français qui, dans le cadre des lois, va promouvoir et faire triompher pardessus les différences des opinions, le grand effort de salut commun et la réforme profonde de l’État. Ainsi, dans l’accord des actes et des volontés, la République française construira la France nouvelle.
J’invite à se joindre à moi dans le Rassemblement toutes les Françaises et tous les Français qui veulent s’unir pour le salut commun, comme ils l’ont fait hier pour la libération et la victoire de la France.
Vive la France. Vive la République. »
Ch. de Gaulle, Discours de Strasbourg, op cit.
La fin du tripartisme
« Ce qui s’est passé ce jour-là a été extrêmement simple et rapide. La séance du Conseil des ministres a été ouverte comme d’habitude. Paul Ramadier a fait un exposé sur la situation générale et ensuite il a consulté individuellement tous les ministres présents. D’abord, je crois qu’il a commencé par les socialistes, puis c’étaient les ministres M. R. P. Il y avait déjà, je crois, un ministre radical ; si je ne me trompe, c’était Yvon Delbos. Les uns et les autres se sont déclarés d’accord avec l’exposé du président du Conseil. Ensuite, Ramadier a interrogé les communistes : J’aimerais savoir ce que pensent nos collègues communistes du programme que je viens d’esquisser. » Et Maurice Thorez a répondu : » Nous soutiendrons les revendications de la classe ouvrière. » Les communistes défendaient à ce moment-là les revendications des travailleurs des usines Renault, où un conflit venait d’éclater. Au Conseil des ministres, Maurice Thorez estime qu’il est possible de leur donner satisfaction. Il rejette la théorie du » cycle infernal » entre les salaires et les prix invoquée par Ramadier. Sur quoi Ramadier a dit : » Je constate que nos collègues communistes ne sont pas d’accord avec le président du gouvernement ni avec la majorité du Conseil, et je demande quelles conséquences ils pensent en tirer. » Maurice Thorez a déclaré : » Je n’ai jamais démissionné de ma vie. » J’étais assis en face de lui et je me suis permis cette réflexion : » Eh bien ça promet pour le jour où tu seras président du Conseil ! » Là-dessus, Ramadier a sorti de son tiroir une petite brochure – c’était la Constitution – a invoqué je ne sais plus trop quel article de cette Constitution qui lui donnait le droit de retirer aux ministres communistes les délégations qu’il leur avait données, car quand on est ministre on ne l’est que par délégation, les ministres communistes se sont levés, sont sortis ; il n’y avait plus de ministres communistes. Voilà ! ça a été extrêmement rapide et absolument simple. »
extrait de Marcel-Edmond NAEGELEN, Mémoires de notre temps.
La France en 1947
» De ce conseil (1), je sors accablé et presque découragé. La séance a été terrible, non certes par le débat qui a été très élevé, mais par tout ce que nous avons appris. Tous les ministres font un louable effort et c’est avec une grande conscience qu’ils gèrent chacun leur département et ensemble les affaires de l’État. Mais les grèves des cheminots, les grèves qui s’allument un peu partout, dans les tramways, chez les mineurs, puis les difficultés créées par le plan Marshall et l’attitude de l’Union Soviétique, les complications qui ont suivi le discours de Truman, tout cela est exploité dans les usines et provoque à chaque instant des conflits sociaux. La conséquence en est une situation financière alarmante. Les gens apeurés retirent leurs fonds, les avances de la Banque de France qui menacent notre monnaie, la nécessité de mesures pour colmater les fuites monétaires et financières et, par là même, les répercussions sur le coût de la vie – tout cela crée une situation épouvantable et les communistes attisent le feu partout.
A côté de cela, des difficultés à Madagascar, dans les territoires de l’Union française – tout paraît se conjuguer contre nous alors que la France n’est pas encore sortie de l’abîme de ruines où elle se débat. Je me demande si nous parviendrons à vaincre ces difficultés.
Si le pays était uni, oui. Voici que, en face des communistes, de Gaulle s’agite à son tour. J’ai fait des approches pour lui demander de suspendre son activité hostile, mais il demeure muré dans son orgueil et il est seul. Qui l’emportera ? J’espère toujours que ce sera la République, je continue à lutter pour cela en donnant des conseils peut-être parfois avec un peu trop de vivacité, mais qu’importe ! La situation est telle que je ne veux rien négliger pour créer un climat nouveau. »
Vincent Auriol, Journal du septennat (édité en 1970).
Cité dans « Histoire Terminale« , collection Quétel, éditions Bordas, 1994, p. 38
(1) Il s’agit du Conseil des ministres du 11 juin 1947.
La crise de 1947
« D’après les rapports des préfets pour la période du 10 avril au 10 septembre, le scepticisme s’est transformé en profond découragement, et même en pessimisme noir. Manque de confiance de la population dans la volonté ou la capacité de redressement du gouvernement et dans l’avenir de la monnaie, Tout le monde est mécontent, ouvriers et fonctionnaires, qui ne disposent d’aucune ressource en réserve. Les revenus ne suivent que de très loin la hausse des prix, et les ouvriers (…) sont prêts à se jeter dans n’importe quelle aventure.
L’affolement n’est plus loin de la panique. Une sorte de psychose de hausse joue un rôle prépondérant, ainsi que la peur. Dans certains départements, des marchandises disparaissent des magasins et atteignent des prix exorbitants,
Le gouvernement ne paraît pas toujours armé pour faire respecter son autorité ; ainsi les manifestants qui se livrent à des injures a l’égard des contrôleurs économiques, ou ceux qui encouragent la foule à la violence, bénéficient de l’indulgence des tribunaux tandis que se manifeste un certain esprit d’indépendance jusque dans le corps de la gendarmerie. Les syndicats ont miné dangereusement l’esprit de discipline dans les services de police, dit par exemple le préfet de la Côte d’Or, et il conclut : » la manière dont le Parti communiste organise des mouvements de masse qui peuvent devenir d’un jour à l’autre très dangereux exige un pouvoir loyal qui ne cède à aucun prix à la menace, Tant que les notions de respect des règlements de discipline nationale ne peuvent prévaloir dans le pays, tant que l’autorité de l’État sera si ouvertement discutée et bafouée, il n’y aura pas d’autre facteur que la force publique et la vigueur du gouvernement et de ses représentants dans les départements pour maintenir l’ordre public. »
De tous les rapports, il résulte qu’il existe un divorce entre les pouvoirs publics et les masses, urbaines ou rurale. Ce regrettable état de fait peut s’assimiler beaucoup plus à une véritable crise de régime qu’à une crise d’impopularité passagère du gouvernement. »
V. Auriol, journal du septennat (1947-1954); 15 sept. 1947, A. Colin, 1970
Qu’est-ce que la Troisième force ?
« La situation est grave. La République est en danger, la République qui pour nous s’identifie avec la patrie. Les libertés civiques, la paix publique, la paix tout court sont menacées.
Le danger est double. D’une part, le communisme international a ouvertement déclaré la guerre à la démocratie française. D’autre part, il s’est constitué en France un parti dont l’objectif – et peut-être l’objectif unique – est de dessaisir la souveraineté nationale de ses droits fondamentaux.
Je suis ici pour sonner l’appel. Je suis ici pour tenter de rallier tous les républicains – tous ceux qui se refusent à subir la dictature impersonnelle non pas du prolétariat mais d’un parti politique – tous ceux qui se refusent à chercher un recours contre ce péril dans le pouvoir personnel d’un homme.
Ce qu’on a appelé la Troisième Force n’est pas autre chose que l’union des républicains pour la liberté, pour la justice sociale et pour la paix. »
Léon BLUM, discours d’investiture, 21 novembre 1947.
La grande peur de 1947
« Vendredi 28 novembre – Nous connaissons de nouveau une angoisse proche de celle des pires jours de l’occupation l’autre nuit ni mon père, ni Brisson n’ont couché chez eux – et nombreuses sont les personnes qui, s’attendant au pire, trouvent imprudent qu’ils y restent ces soirs-ci, Grèves des chemins de fer, des mines, des P.T.T. plus ou moins étendues, les syndicats commençant à réagir partiellement contre la politisation communiste, mais qui suffisent à paralyser le pays (…).
Samedi-dimanche – Débat de trente six heures consécutives à la Chambre en raison de l’obstruction communiste. Schuman arrive à faire passer sa loi (80000 réservistes mis à la disposition du ministre de l’Intérieur. Défense de la liberté du travail. Sanction contre les sabotages).
Lundi ler décembre – Premières pannes d’électricité. Paris plongé dans l’obscurité. Moins d’eau et de gaz. Plus de métro, (…) »
extrait de Claude MAURIAC, Un autre de Gaulle, Pans, Hachette, 1970.
La scission de la CGT 1947 (19 décembre)
« Pour nous, en effet, la situation est claire : nous sommes dans la place, et ceux qui ne sont plus d’accord avec nous s’en vont. Nous avions aperçu déjà le problème capital qu’est la dévolution des biens, lorsque nous avions étudié, il y a trois ans, les moyens les plus sûrs de réaliser un » carcan » dans lequel se trouveraient enserrés, bon gré mai gré, ceux qui pensaient secouer un jour notre autorité et jouer leur jeu. Il est certain que nous devons recourir, là aussi, à toutes les manoeuvres d’obstruction qui seront à notre disposition, et le service de la C.G.T. [juridique] doit être en liaison continuelle avec celui du Parti, pour tirer le maximum de ressources de l’arsenal réglementaire qui nous est offert par les statuts et par les dispositions générales régissant les syndicats.
Il faudra même que notre propagande ait recours aux précédents de la séparation des Églises et de l’État, et que, si des jugements viennent à nous frustrer d’une partie de ce qui, en fait, constitue notre arme décisive et aussi notre trésor de guerre, ce soit par la violence que nous répondions aux tentatives des matraqueurs.
Il faut préparer les esprits ouvriers à cette lutte, et il faut penser dès à présent à la faire coïncider avec les dernières batailles que nous aurons à livrer. Je le répète, tout est une question de doping, et nous ne devons ni perdre de temps, ni ménager nos effets en ce sens.
Sur le plan général, conclut Frachon, nous n’avons pas à faire de gros efforts pour aménager notre propagande. Notre lutte contre l’impérialisme américain doit suffire, dans sa forme actuelle, puisque aussi bien nous avons déjà commencé à présenter les efforts de division de la classe ouvrière comme une obéissance servile aux ordres de Washington et aux manoeuvres tortueuses des Brown et autres agents du capitalisme anglo-saxon, venus brouiller les cartes dans notre pays vendu par Bidault. Cette formule générale tient le plus large compte des nécessités et elle peut servir de fond sonore à la propagande particulière dont je viens de définir les grandes lignes.
Mais je pense pouvoir vous faire entrevoir les possibilités qui nous sont offertes de lier ce que nous dénonçons comme étant une manoeuvre de Wall Street et une tentative des forces républicaines et laïques qui est faite sous la bannière de la troisième force.
Nous ne devons pas oublier en effet que c’est la troisième force qui, prenant corps, a poussé les scissionnistes à se compter et à s’organiser. Il ne faut pas oublier que ce sont les éléments syndicalistes contrôlés par les socialistes et ceux qui dépendent de la » Confédération des curés » qui ont empêché notre action de se développer au cours des dernières semaines. Or, que risquons-nous ? C’est de voir les éléments de la C.G.T. prendre contact avec ceux de la C.F.T.C. par le truchement des syndicats autonomes, le tout étant supervisé par la troisième force qui y trouve son élément de liaison son principal apport de vitalité.
Quoique ce ne soit pas ma partie et que l’on passe rapidement du syndicalisme au politique, je tenais à conclure en vous faisant part de mes appréhensions à ce sujet.
Thorez prend alors la parole. Il remercie tout d’abord Frachon de la netteté et de l’intérêt de son exposé et il émet le désir que les responsables du parti sur le plan syndical puissent avoir à l’avenir la plus large part aux travaux du Bureau politique.
In Vincent Auriol, op.cil.
Le PCF sous surveillance 1947 (décembre)
Le S.D.E.C.E. me communique une note d’après laquelle les communistes prépareraient une action pour la prise du pouvoir, précédée d’une grève générale des transports entre le fer et le 15 décembre, en vertu d’une décision qui aurait été prise le 27 septembre. Il ajoute que le résultat des élections a pu modifier cette décision.
J’apprends également que Thorez et Dimitrov ont passé deux jours dans la villa de Staline, entrevue qui déconcerte l’ambassade des Soviets à Paris, qui déclare que Thorez et Dimitrov étaient partisans de l’assouplissement de la politique communiste en Europe. On se demande si cette entrevue ne va pas freiner l’action communiste actuelle. Je vais suivre les événements avec attention et j’en informe immédiatement le président du Conseil. [Il est vrai que l’U.R.S.S. ne compte plus sur la France et l’ambassade ne tient pas à ménager Bidault ou tout autre. Il faut suivre les événements avec attention ; il n’est pas douteux que cet ensemble de grèves et ces renseignements laissent attendre des événements auxquels il faudra faire face énergiquement.]
J’informe également Jules Moch et le Quai d’Orsay, car dans le flot des préoccupations quotidiennes, ils peuvent ne pas lire les documents qu’on leur transmet, d’autant plus que les services de police judiciaire des Renseignements généraux et du S.D.E.C.E. sont mal coordonnés et c’est à moi qu’il appartient de les ordonner et d’informer le gouvernement de tout ce que je connais. »
Vincent Auriol, op. cit.
Dans son Journal, V. Auriol fait souvent état de rapports du SDECE sur les délibérations du Bureau politique du P.C. Il est peu probable que le service de renseignements ait disposé d’un » agent » au sein de cet organisme de sorte qu’ il est vraisemblable que ces rapports étaient de seconde ou de troisième main et leur authenticité absolue ne peut être assurée.
L’agitation sociale, 1947-1948
Rapport du ministre de l’Industrie le socialiste Robert Lacoste, au président V. Auriol, 29 janvier 1949 :
« Vous savez qu’une certaine agitation a régné dans les mines depuis l’année 1947. Cette année, en effet, il y eut cinq jours de grève générale d’un jour le 19 juin, série de grèves tournantes aux mois d’août et septembre, et enfin, grève générale décrétée le 4 octobre. Cette grève se prolongea très longtemps puisque l’ordre de reprise ne fut lancé par la Fédération du sous-sol de la C.G.T . que pour le lundi 29 novembre. Il est vrai que la reprise, totale dans le bassin de Lorraine dès le début du mois de novembre, s’accentua pendant le cours du mois dans tous les bassins. Dès le 15 novembre, plus de 70 % de l’effectif normal était au travail.
Une grève aussi longue et aussi dure ne put se passer sans incidents multiples et quelquefois graves. Aussi un certain nombre de mineurs furent-ils emprisonnés et condamnés à des peines plus ou moins graves. Le 15 janvier 1949, 1430 mineurs (sur un effectif total dépassant 300’000) étaient passés en jugement, et les tribunaux avaient encore à examiner environ 400 cas. Les principaux motifs de condamnation furent les suivants : atteinte à la liberté du travail, incitation à la rébellion , violences, outrages, vols, agressions à main armée, sabotages et refus d’obéissance ( … ).
D’autre part, un certain nombre de licenciements ont été opérés sur les Houillères du Bassin. Ils portent d’ailleurs, en général, sur des ouvriers condamnés. Les licenciements pour l’ensemble du personnel des Houillères se sont élevés à 1 100 ( … )
Le ministre met en cause la C. G. T.
Ces délégués, qui remplissent d’ailleurs les fonctions de délégués du personnel, sont dans leur quasi-totalité des éléments syndicalistes de la C.G.T. Un grand nombre d’entre eux sont, au cours de la grève, sortis de leur rôle normal. Aussi les préfets ont-ils été amenés à prononcer des peines de suspension variant de un à trois mois et concernant environ 180 délégués sur les 600 existants pour l’ensemble des bassins. »
in Vincent Auriol, Journal du septennat, A. Colin éd., t.III, 1977, p. 472.
Un des responsables du parti communiste justifie les grèves d’octobre 1948
« A la rentrée d’octobre 1948 un grand mouvement de grèves déferla sur le pays en raison des hausses des prix qui annulaient les augmentations de salaires au fur et à mesure qu’elles étaient arrachées. Le 4 octobre, les mineurs se mirent en grève pour exiger l’abrogation des décrets relatifs au licenciement de 10 pour 100 du personnel des houillères nationalisées, l’échelle mobile des salaires, l’augmentation des retraites et diverses autres revendications.
La grève illimitée avait été déclenchée par les mineurs à la suite d’un référendum qui avait donné 218616 voix pour la grève contre 25086. Le gouvernement riposta en faisant occuper les cockeries par les C. R. S. et en réquisitionnant le personnel des cokeries dépendant des houillères.
Le 9 octobre, le président du Conseil estimait que les grèves avaient un caractère insurrectionnel et le lendemain le ministre de l’intérieur déclarait devant le Conseil national du parti socialiste que le Kominform aurait déclenché les grèves pour saboter l’aide américaine. Puis, tenant à montrer, en tant que chef de la police, qu’il était particulièrement bien informé, il donna une précision soit sortie de son imagination féconde, soit résultant d’une entreprise d’intoxication politique dont il était peut-être victime : » J’ai maintenant la certitude, déclara-t-il, que les agents communistes français ont reçu une somme de 100 millions pour mener leur campagne de désorganisation contre notre économie. »
Cette attaque calomnieuse visait sans aucun doute à préparer la répression contre notre parti, mais elle ne résolvait pas pour autant les problèmes sociaux posés devant le pays.
Le ministre de l’intérieur jouant au général en chef des forces de l’ordre fit décider par le gouvernement le rappel de 30000 hommes de la classe 1947, cependant que les C. R. S. étaient autorisés à tirer après les sommations réglementaires.
En somme, ce que n’aurait pas osé faire un ministre réactionnaire, un ministre socialiste l’avait fait sans se rendre compte, semblait-il, de ce qu’il y avait d’inadmissible dans un tel comportement. »
in Jacques DUCLOS, Mémoires, Fayard.
Contre Jules Moch
Jules Moch socialiste, est ministre de l’Intérieur en 1947 et 1948, au moment des grèves générales. En 1949, lorsqu’il est candidat à la présidence du Conseil, le communiste Jacques Duclos prononce le discours suivant.
« M. Jules Moch est une sorte de frénétique des mobilisations policières. Les ouvriers en grève, les anciens combattants et résistants, les mères de soldats tués au Viêt-nam et allant réclamer le corps de leurs enfants, tout cela est suspect pour M. Moch, pour qui la matraque est l’argument décisif.
Aux spécialistes de l’anticommunisme, de la division et de la discrimination entre Français, nous opposons, nous, la conception de l’union de tous les Français et de toutes les Françaises de bonne volonté. Aux spécialistes d’un gouvernement de police, de violation des droits de l’homme, de matraquage, de désordre et de misère, nous opposons le mot d’ordre d’union et d’action pour la formation d’un gouvernement d’union démocratique qui assurera du travail et du pain pour tous, qui fera respecter les libertés démocratiques, restaurera l’indépendance nationale et sauvegardera la paix.
Permettez-moi d’évoquer, avant de descendre de cette tribune, la mémoire d’honnêtes travailleurs qui ont été assassinés. Je pense à trois ouvriers de Valence, assassinés le 3 décembre 1947.
Je pense à Sylvain Bettini, rescapé du camp de Dachau, tué par les CRS le 8 décembre 1947 dans un piquet de grève. Je pense à l’ouvrier Bartel Jan Sek, mineur d’origine polonaise, assassiné à Merlebach le 8 octobre 1948, la tête fracassée à coups de crosse. Je pense à André Houiller, combattant des deux guerres, abattu par un policier à Saint Mandé, alors qu’il collait des affiches pour la paix. »
par Jacques Duclos, à l’Assemblée nationale, séance du 14 octobre 1949.
La loi Barangé
« Article 1. – Il est institué un compte spécial du Trésor chargé de mettre à la disposition de tout chef de famille ayant des enfants recevant l’enseignement du premier degré une allocation dont le montant est de 1000 francs par enfant et par trimestre de scolarité. Pour les enfants fréquentant un établissement public d’enseignement de premier degré, cette allocation est mandatée directement à la caisse départementale scolaire gérée par le conseil général. Les fonds de ces caisses seront employés à l’aménagement, à l’entretien et à l’équipement des bâtiments scolaires de l’enseignement public du premier degré. Le conseil général pourra déléguer aux oeuvres éducatives désignées par les chefs de famille intéressés une partie qui ne doit pas excéder 10 % des sommes attribuées à la caisse départementale. Pour les enfants fréquentant un établissement privé d’enseignement, cette allocation est mandatée directement à l’Association des parents d’élèves de l’établissement. L’application des dispositions du présent article est subordonnée à l’autorisation du chef de famille qui devra produire un certificat de scolarité.
Article 2 – Pour alimenter le compte spécial du Trésor prévu à l’article premier, il est institué, à compter du 1er octobre 1951, une cotisation additionnelle de 0,30 % aux tarifs de la taxe à la production prévus par les paragraphes 1 et 2 de l’article 256 du code général des impôts.
Article 5 – Les dispositions de la présente loi ne seront applicables qu’aux établissements légalement constitués à la date de sa promulgation et cesseront d’avoir effet à la date de la mise en vigueur des dispositions de la loi fixant le régime scolaire en conclusion des travaux de la commission d’étude pour l’ensemble des problèmes scolaires. »
Étudier à la Sorbonne à la fin des années 1940
LE BONHEUR DES ANNÉES ÉTUDIANTES
« Michel Rocard, qui a été ministre, Premier ministre, chef de parti, candidat à la présidence de la République, m’a dit : « La période de ma vie où j’ai été le plus heureux est celle où j’étais président des étudiants protestants à la Sorbonne. Pendant des soirées entières nous commentions la société et corrigions le monde. Le droit d’inventer et celui de juger étaient illimités. Le bonheur. »
Le statut d’étudiant, à l’époque, est celui d’enfant prolongé sans les contraintes de l’enfance. De chevalier errant à la conquête du monde, avec droit d’errer et de conquérir. Pas d’angoisse de l’emploi : les bacheliers sont moins de quarante mille par an, une élite. Les seuls concours de l’État, qu’on peut présenter tout en commençant par les plus difficiles, offrent une garantie de débouché. Dans cette période de reconstruction, il n’y a d’ailleurs pratiquement pas de chômeurs. Les bourses et les cantines assurent un minimum vital. J’ajoute un peu d’argent de poche en faisant l’enquêteur pour le premier institut de sondage qui tente sa chance en France. »
UN CANULAR ÉTUDIANT…
« La sociologie américaine se fonde sur le psychodrame, où chacun doit jouer son personnage et surtout sa fonction (…). Ainsi apparaissent sur scène les contradictions, caricatures et peuvent être dénoncés les stéréotypes (…) Robert [Badinter] décide d’organiser le premier sociodrame à l’américaine de l’Histoire, à la Sorbonne. En présence du professeur Gurvitch, et sous la présidence du doyen Davy, héritier spirituel de Durkheim (…). Dans notre groupe d’étudiants, il y a une jeune fille blonde dont nous sommes tous éperdument amoureux. Robert s’adresse à elle comme par hasard et lui demande de monter sur le podium pour une démonstration. (…)
– Mademoiselle, jouez votre vie, dit Robert.
– Ma vie ?
– Oui, imaginez où vous êtes, ce que vous faites normalement. (…)
– J’attends le retour de mon mari qui est encore au bureau.
– Passionnant, dit Robert. Vous avez le vivant exemple des structures matrimoniales stéréotypées dans une France restée rétrograde. Et que faites-vous, mademoiselle, en attendant votre mari ?
– Je m’occupe de mes enfants. (…)
Là, moment de flottement. Il n’y a pas d’enfant. Robert n’hésite pas.
– Il me faut deux volontaires.
Bien sûr avec un copain je lève le doigt et nous voilà sur le podium.
Badinter assume :
– Mademoiselle, continuez à jouer votre vie comme vous la voyez. Que faites-vous maintenant ?
– C’est l’heure pour les enfants d’aller se coucher. Je couche mes enfants.
Là, la sociologie américaine la plus moderne commence à déraper.
– Premier enfant : « Maman, je ne veux pas aller me coucher si tu ne m’embrasses pas. »
– Deuxième enfant : « Maman, je veux que tu me prennes sur tes genoux. »
Gurvitch pâlit, le doyen Davy s’agite, la Sorbonne s’inquiète, Badinter ne sait plus comment commenter, le public est ravi. Enfin quelque chose de nouveau. Ce sont des siècles de respectabilité qui s’effondrent.
– Premier enfant (hurlant) : « Maman, j’ai envie de faire pipi. »
– Deuxième enfant (hurlant plus fort) : « Maman… »
Dans le vacarme se confondent les protestations indignées, les applaudissements joyeux et les propos scatologiques les plus déplacés.
Le doyen Davy se lève, fait tomber ses cannes de fureur, s’écrie en sortant indigné : « Je savais que les Américains étaient des sauvages. Mais trop c’est trop. » On lui ramasse ses cannes. Gurvitch suspend la séance. »
Jean-François DENIAU, Mémoires de 7 vies. 1. Les temps aventureux. Paris, Plon, 1994, rééd. Pocket, 1996, 438 p., pp. 236-7, 269-72.
L’affaiblissement immédiat de l’exécutif par la double investiture
Entretien entre Vincent Auriol et Paul Ramadier
En janvier 1947, Paul Ramadier est désigné comme président du Conseil par le président de la République, puis investi par un vote de l’Assemblée nationale à la majorité absolue. Il accepte ensuite que le Parlement discute la composition de son gouvernement et sollicite un second vote. Cette initiative devient une habitude jusqu’en 1954.
Mécontent, Vincent Auriol intervient le 28 janvier auprès de Paul Ramadier…
« V. A. : Mais, c’est contraire à l’esprit de la Constitution. Autrefois, lorsque le gouvernement prenait contact avec la Chambre, celle-ci se prononçait à la fois sur le programme et sur la composition du gouvernement. Aujourd’hui, tu as la confiance de l’Assemblée pour l’exécution d’un programme et l’orientation d’une politique. C’est toi, et toi seul, qui as la responsabilité des actes de tes collaborateurs, donc de leur choix. Explique cela à l’Assemblée en refusant tout débat et tout vote – sauf plus tard sur la non conformité des actes du gouvernement à la déclaration ministérielle, c’est-à-dire sur sa politique. Ne recommençons pas les jeux de massacre. Ne sois pas un « vieux » de la 111 e.
P. R. : Mais, je suis plus jeune que toi ! En tout cas l’Assemblée est souveraine et c’est un principe de tout temps; je ne peux méconnaître cette souveraineté…
V. A. : Je ne l’ignore pas. Rappelle-lui seulement que, dans une démocratie, la souveraineté est définie et limitée par la Constitution. Demande le renvoi des interpellations sine die… »
in Vincent AURIOL, Mon Septennat, Paris, Gallimard, 1970. Dans La IV°République, D. P. n° 5-309, La Documentation Française.
L’élection du président R. Coty, 1953
» Arrive enfin le dixième tour. M. Bidault s’exclame dans les couloirs : » Nous sommes la risée de l’univers! » Il paraît que dans les bistrots on commençait à faire des paris et qu’effectivement cela devenait un spectacle un peu ridicule.
On convainc enfin M. Laniel de se retirer. Mais il fallait tout de même un candidat. Apparaît M. Jacquinot. M. Jacquinot n’est pas élu, pour une raison d’ailleurs je crois assez » automobile » : un autocar qui amenait des sénateurs était en panne sur l’autoroute de l’Ouest, et ceux-ci étaient arrivés trop tard pour voter.
En tout cas, il n’est pas élu et cri cherche un troisième homme, un troisième modéré : on trouve M. René Coty, personnage digne mais un peu obscur du Sénat, et qui n’avait contre lui rien. Il était sénateur, il avait été ministre de la Construction, il était bon bourgeois du Havre. Et on élit au treizième tour M. René Coty président de la République, parce qu’à ce moment-là d’abord on était un peu fatigué, ensuite parce que les gaullistes n’avaient rien contre M. Coty.
Le mot de la fin a été donné par M. Coty à moi-même, un jour où j’allais le voir à l’Élysée. Il m’a dit : » Je sais pourquoi je suis président de la République, c’est parce que j’ai été opéré de la prostate. »
Et comme je marquais un peu d’étonnement, il m’a dit :
» Oui, j’ai été opéré de la prostate au moment de la controverse sur l’armée européenne et je n’ai pas eu à me prononcer sur ce traité. Car si je n’avais pas été opéré, je me serais prononcé pour ce traité et je n’aurais pas été élu, même au treizième tour, président de la République française. A quoi tient une présidence ! »
Jacques Fauvet, in Mémoires de notre temps.
L’avènement des fonctionnaires
« La démoralisation d’un corps de fonctionnaires que l’Europe nous a envié durant plus d’un siècle est plutôt due aux conditions mêmes d’exercice de leurs fonctions qu’à leur appauvrissement. La carence du pouvoir politique en tant que source continue d’autorité les investit, malgré eux, de pouvoirs excessifs. Mais si, de ce fait, ils sont contraints de gérer le régime, ils ne peuvent ni l’estimer, ni le modifier profondément (…). Maires du palais d’un souverain impuissant, la tentation politique est, pour eux, celle de l’efficacité. À défaut de s’y engager eux-mêmes, ils cherchent à agir par personnes interposées ; autrefois, chaque ministrable avait son écurie de fonctionnaires ; aujourd’hui, pour donner vie à ses projets, chaque fonctionnaire veut posséder son écurie de ministres. »
in Réalités, septembre 1953.
Discours d’investiture d’Antoine Pinay à l’assemblée nationale le 6 mars 1952
» Nous sommes en présence d’un triple déficit : les devises, le Trésor, le budget… Ce qui provoque en ce moment l’avilissement du franc, c’est la réaction de défense des individus qui, ainsi, précipitent eux-mêmes sa chute, c’est la défiance de la Nation dans sa monnaie, dont l’effondrement marquerait la défiance du monde à l’égard de la France.
Comment un pays comme le nôtre en est-il arrivé là ? C’est que ce grand pays a subi de cruelles épreuves. Et notre génération a assumé de lourdes charges. En trente ans, par deux fois, la France a dû relever ses ruines et reconstituer ses richesses. Aujourd’hui encore, elle doit défendre la liberté en Asie et s’armer pour sa défense en Europe. Elle a le devoir de rattraper dans ses équipements fondamentaux le retard des années sombres de la guerre et de l’occupation. Elle tient à l’honneur d’avoir plus d’enfants et plus de vieillards. Mais c’est notre génération d’adultes qui supporte ces charges…
Les remèdes ne sont ni de droite ni de gauche. Ils n’ont pas d’étiquette parlementaire. Ce sont des mesures techniques à prendre dans un climat de trêve politique. Avant tout, l’État doit tenir ses engagements essentiels. Parce que l’État est le gardien de la monnaie au même titre que de l’ordre public, le gouvernement, face aux prix, a un devoir impérieux de vigilance… Si tous les partis ne sont pas d’accord pour que l’État administre, ils sont tous d’accord pour que l’État gouverne. Je suis en effet attaché au libéralisme, mais à un libéralisme loyal qui, dans un climat de concurrence saine, doit rechercher sans cesse le progrès technique et la paix sociale, non pas au libéralisme aveugle de la jungle ou au libéralisme égoïste des coalitions d’intérêts…
Après le combat contre l’inflation des prix, vient la lutte contre l’inflation budgétaire. Pour assurer l’équilibre du budget, il faut créer un double climat d’économie rigoureuse dans la dépense, de civisme intransigeant dans la recette. L’Etat doit donner l’exemple de la bonne gestion dans tous les domaines. Dans les administrations, il faut retrancher encore les dépenses inutiles ou différables. Il faut assurer le plein emploi du personnel et du matériel… L’esprit d’économie doit pénétrer, non seulement l’État mais la Nation. Il faut pénaliser le gaspillage comme la fraude dont il est souvent l’expression. Il faut dénoncer le luxe qui insulte à la misère. Il faut que la discipline sociale réduise volontairement la consommation du pays. Les Français doivent de nouveau, apprendre à éviter les dépenses inutiles ou à payer très cher le droit de jouir de biens ou de services que notre époque refuse à beaucoup d’entre eux. C’est pourquoi il faut rétablir le civisme devant l’impôt, la fraude doit être combattue avec la dernière rigueur. »
in Débats de l’Assemblée nationale, Journal Officiel, mars 1952.
L’expérience Pinay
« Si l’on veut juger M. Pinay sur les objectifs qu’il s’était donnés : prix, Trésor et budget, devises, sur le premier point son succès est indiscutable : il a rompu le rythme de la hausse après la période nerveuse du début de la guerre de Corée, en un moment où les 15 % de hausse des salaires de 1951 eussent pu continuer à produire des effets néfastes. La conjoncture aidant, cet arrêt sera durable. Si l’on ne définissait l’inflation que par la hausse des prix, M. Pinay l’eût arrêtée et c’est, en effet, la réputation qu’il a gardée.
Sur les autres objectifs, le succès est beaucoup plus discutable. Déficit record du budget et charge très lourde pour le Trésor. Celle-ci fut allégrement supportée grâce à l’emprunt indexé sur l’or, mais du point de vue budget et trésorerie, M. Pinay n’en a pas moins légué à ses successeurs un passif très lourd.
Pour les échanges extérieurs, troisième objectif et, avec les prix, thermomètre de l’inflation, la situation s’est aggravée.
Aux buts que s’étaient donnés M. Pinay, il faut ajouter deux autres critères : le progrès du niveau de vie et l’expansion. Du premier point de vue, l’arrêt de la hausse des prix, la politique de larges importations a été bénéfique. Pour la production, au contraire, l’année est décevante. Qu’elle le soit davantage encore pour l’investissement ne peut qu’être inquiétant.
M. Pinay a dressé, en arrivant, un bilan lucide. Puis il a su couper la fièvre : un bon médecin en use souvent ainsi pour pouvoir travailler dans le calme. Restait à établir un diagnostic exact et à agir en profondeur… Ce sera pour un autre ministère Pinay, six ans plus tard.
M. Pinay fut un président du Conseil énergique et, en politique, l’énergie paie. Mais sa formation économique acquise » sur le tas » était un peu élémentaire. Un grand pays ne se gère pas tout à fait comme une entreprise familiale. Les problèmes n’y sont pas seulement d’un autre ordre de grandeur, ils sont assez souvent radicalement différents, car rien dans une entreprise ne ressemble à ce qu’est l’un des problèmes essentiels d’un Etat, la gestion d’une monnaie. »
in Jean LECERF, La Percée de l’économie française, Arthaud
Le cas Antoine Pinay
« D’abord, les Français ont découvert l’existence d’un inconnu qui leur ressemble, en qui beaucoup se reconnaissent : Antoine Pinay. Ils se sont intéressés à lui parce qu’il a joué, avec beaucoup de talent, le grand rôle populaire du triomphe de la vertu. ( … ) Antoine Pinay, c’est Dupont appelé à résoudre la crise du franc et de la France. Il a une tête d’électeur beaucoup plus que d’élu. Il porte la décoration du soldat : la médaille militaire. il a des yeux clairs et un sourire avenant. Sa déclaration pour l’investiture à la tribune de l’Assemblée a été un chef-d’oeuvre de » malhabileté » politique. Et c’était la suprême habileté. Il aurait dû se mettre à dos à la fois libéraux et dirigistes. Et il les a mis d’accord. Comme il n’avait vraiment aucune chance, chacun a cru poli et sans danger de lui accorder un suffrage d’estime. Et, au total, ce fut une confortable majorité.
Vous êtes vraiment l’enfant du miracle, lui a dit le président Herriot, quand fut connu le résultat.
Le miracle, c’est que les paroles simples de cet homme simple étaient passées par-dessus la tête des députés et avaient volé de circonscription en circonscription. La fibre paysanne de l’Assemblée s’était réveillée d’un bord à l’autre. Et Antoine Pinay venait de réussir là où avaient échoué tous les Machiavels : il avait emporté, presque sans s’en apercevoir, un morceau de la citadelle gaulliste. Bâtie de marbre et de fer, inaccessible aux manoeuvres, elle venait de se faire tourner par le sentiment. On ne ferme jamais à clef la porte du bon sens. Antoine Pinay l’avait poussée comme par inadvertance. »
in Paris-Match, 8 mars 1952.
L’ANTICLÉRICALISME DU CANARD ENCHAÎNÉ
«Le Mouvement des Révérends Pères.
«Tout le monde ne peut pas être orpheline.»
C’est ce que, en cet an de grâce 1951, pourrait soupirer Poil de Calotte.
Autrement dit la France, fille aînée de l’Eglise.
Jamais on n’avait vu cette dernière entourer notre pays de tant de soins jaloux.
Jamais don Bazile n’avait à ce point veillé sur la vertu de Rosine.
Rosine-Marianne ne peut faire un pas sans rencontrer la noire soutane de son chaperon, ni accomplir un geste sans mendier son assentiment : « J’y va-t-y, j’y Vatican ? »
Et c’est ainsi que L’Osservatore Romano indique aux catholiques français le parti auquel ils doivent apporter leurs voix.
«Votez M.R.P.», leur dit le journal du Pape.
Sa Sainteté entend faire nos élections comme elle a fait celles de la République de M. de Gasperi et de la Belgique démo-chrétienne.
Pourquoi se teitgênerait-elle ?
Le temps n’est plus où l’ingérence du Vatican dans nos affaires – à propos de la visite du président Loubet au roi d’Italie – soulevait un tel tollé à la Chambre que le gouvernement devait rappeler dans l’heure notre ambassadeur auprès du Saint-Siège.
Aujourd’hui, personne n’oserait, vous pensez ! Personne n’oserait dire à M. Pie :«Occupez-vous de vos saints oignons !»
On irait plutôt le trouver pour lui demander un petit coup de main. C’est bien d’ailleurs ce qu’a probablement fait ce bon M. Robert Schuman, dont on n’a pas oublié le pèlerinage à Rome, à l’occasion de l’Année sainte.
Il ne s’est pas contenté comme tous les pèlerins d’aller sucer le gros orteil de Saint Pierre en la basilique. Il y a accroché en ex-voto le bonnet de Marianne, dans l’espoir que ce geste lui ferait retrouver son siège de député et conserver son maroquin.
Entre deux baise-mules, notre podo-suceur a manigancé avec le Pape cette intercession en faveur de son parti :
«Nous seuls, Saint Père, sommes capables d’étrangler cette gueuse d’école laïque.
– Amen !» a dit le Saint Père en lui donnant sa bénédiction.
On n’a jamais vu un ministre de la République baisser son froc avec une aussi tranquille impudeur. On n’en avait jamais vu aucun, il est vrai, qui fût enfroqué à ce point !
Allons bon ! va-t-on nous dire ! Voilà que vous piquez une crise d’anticléricalisme ! Fi ! le vilain Canard qui n’a pas peur du ridicule.
Chacun sait en effet que l’anticléricalisme ça fait vieux jeu.
Par contre, le chapeau noir de Bazile est tout ce qu’il y a de plus new look.
L’anticléricalisme est démodé.
Mais le Saint-Office et son Index ne le sont pas, ni la censure cinématographique des dames patronnesses instituée par le R.P. Teitgen.
On rira de vous si vous allez fleurir la statue du chevalier de la Barre. Mais on vous trouvera de votre époque si, comme Louis Jouvet, vous embrassez à genoux l’anneau de Mgr Feltin. (…)
L’anticléricalisme est passé de mode. Pour être de ce siècle, il faut applaudir le régime de M. de Gasperi qui frappe d’une amende les amoureux surpris dans la rue en train de se bécoter, fait mesurer sur les plages la hauteur des maillots de bain et oblige les Italiennes à monter en amazone sur les motos de peur qu’on ne voie leurs cuisses.
Il est certain que nous retardons en nous montrant pointilleux sur la question de l’école laïque.
Par contre le Canada catholique est à l’avant-garde du progrès et du libéralisme en mettant Balzac et Flaubert à l’Index ; et l’Irlande en taxant M. François Mauriac (voui ! M. François Mauriac !) de libertin.
Il faut vivre avec son temps. Quand on pense que la France n’a pas encore supprimé le divorce, on se dit que décidément nous sommes un peuple bien rétrograde !
Il faut être de son siècle…
C’est ce qu’a très bien compris l’Eglise elle-même.
Avant la guerre, la droite, en France, était cléricale, la gauche plutôt le contraire.
Les électeurs en arrivaient ainsi à fourrer dans le même sac le hobereau et M. le Curé.
Aujourd’hui l’Eglise est beaucoup plus fortiche. Elle a mis du gros rouge dans son vin de messe.
C’est ainsi qu’est né le M.R.P.
Ça ne suffit d’ailleurs pas à l’Eglise d’avoir maintenant son parti.
Pour prouver qu’elle n’est pas sectaire, elle a truffé tous les autres de ses curetons, elle a pondu ses oeufs de coucou dans tous les nids.
Vous pouviez, pendant la guerre, être collabo avec la bénédiction de Mgr Suhard, L.V.F. avec celle de Mgr Mayol de Luppé, résistant avec celle de Mgr Saliège.
Vous pouvez aujourd’hui être communiste avec l’oint de l’abbé Boulier ; cégétiste avec le curé de choc présenté au dernier congrès de la C.G.T. par M. Benoît Frachon, chouan avec Mgr Cazaux. Et même objecteur de conscience avec l’abbé Pierre. (…)
Tous les chemins ramènent à Rome.
Encore une fois il faut être vraiment sectaire pour prendre ombrage de notre sainte mère.
Et pour refuser que dans les écoles l’instituteur soit remplacé par le curé.
Nous ne sommes plus, Dieu merci, au siècle de Voltaire.
Mais en celui de M. Paul Claudel.
C’est ce qu’ont bien compris ceux qui, ces jours derniers, ont joué L’Annonce faite aux mairies.
En s’apparentant avec les bons partis. (…)
Nous sommes au siècle de la sainte faille nombreuse.
«Croassez et multipliez !» Tel est le mot d’ordre, encore que Mgr Dupanloup ne soit plus là pour montrer le chemin.
Arrière les sectaires ! Vive l’esprit nouveau !… comme on disait déjà en 1892.
Le cléricalisme, voilà l’ami ! (…)»
Robert TRENO, Le Canard enchaîné, 6 juin 1951.
Cité par René REMOND, L’anticléricalisme en France de 1815 à nos jours, Fayard, 1976.
LA FIN DES PRETRES OUVRIERS
« Les prêtres-ouvriers sont en ceci exemplaires qu’ils ne se sont pas dérobés devant [les] risques. Je dirai, en y insistant, que je suis très frappé par l’unanimité dont fait foi leur dernier communiqué collectif du début de février ; même si les termes pour le moins insuffisants de ce texte nous heurtent et nous déconcertent, il apparaît que l’expérience sacerdotale de la mission ouvrière a mené tous ceux qui y ont participé aux mêmes conclusions pratiques et doctrinales. Leur «naturalisation» en milieu ouvrier a été effective, sans réserve, totalement généreuse. Elle ne saurait, en effet, être abolie, et pas davantage cet assentiment que, du dehors, nous avons tous donné à la spiritualité implicite de cet apostolat. J’oserai dire que je ne puis concevoir son désaveu, que je me sens humainement lié à ces prêtres désormais, quelle que soit leur option dans la conjoncture présente. Qu’ils se soumettent parce qu’ils savent mieux que personne le sens de l’universalité et de l’unité de l’Eglise, ce sera dans la droite ligne de tout ce qu’ils ont entrepris et que l’on méconnaît maintenant. Et si quelques-uns d’entre eux estiment que l’obéissance est impossible, ce ne peut être à nous de leur en faire reproche. Leur déchirement nous impose ce silence et nous persuade qu’ils auront agi par fidélité à ce déchirement même.
Personne, il y dix ans, ne pouvait prévoir l’issue actuelle, ni davantage les développements qui l’ont précédée. La signification de ce qu’ont tenté les prêtres-ouvriers échappe encore en partie, je ne dis pas seulement à notre conscience d’amis du dehors, je ne dis pas à la capacité des bureaux romains, je dis à la conscience des missionnaires eux-mêmes. Ils ont inscrit une expérience sacerdotale dans le corps d’une humanité en gestation de ses formes et de ses institutions futures. Ces formes seront ce qu’elles sont, humaines, imparfaites, sûrement meilleures que nos structures chancelantes ou pétrifiées. Peu importe, elles seront. Elles naissent peu à peu, désirées, appelées, imaginées par d’innombrables vivants qui y situent tous leurs espoirs. Nous ne pouvons consentir d’avance à ce que le message chrétien, les sacrements, la parole, en soient exclus, pour avoir été refusés à l’heure des naissances et négligés au temps de l’oppression. Une Eglise sera nécessaire à la civilisation encore inconnue qui se dégage peu à peu de la crise : une Eglise gardant intact le dépôt surnaturel mais capable de le faire vivre dans des structures temporelles renouvelées qui, sans en être bien entendu la condition préalable, recevront le message inaltérable et lui donneront des inflexions particulières. Ce sera la même Eglise éternelle, dans une incarnation neuve qu’appelle dès maintenant une large part de l’humanité souffrante et espérante. Peut-être comprenons-nous très mal encore la leçon des prêtres-ouvriers, qui ont osé admettre que, dans le monde tel qu’il est, en pleine transformation politique et sociale, en pleine décomposition des structures anciennes, le destin des pauvres, et même le mystère de la Pauvreté sont de quelque façon liés à une métamorphose sans autre alternative, à vues humaines, que le chaos, l’injustice prolongée, la mort des cités de la terre et du même coup l’abdication du christianisme dans le monde temporel.»
Albert BEGUIN, « Les prêtres-ouvriers et l’espérance des pauvres », in Esprit, 212, mars 1954, pp.241-243.
POUR UN NOUVEAU CONCORDAT
« On eût bien étonné des hommes politiques de la fin du siècle dernier en leur prédisant qu’un jour l’opinion française serait bouleversée par le déplacement, sur ordre de Rome, de quelques religieux français. Il est vrai que cette mesure se trouve liée à celle qui vient d’interrompre un apostolat ouvrier dont la fécondité apparaît mieux aujourd’hui : il aura fallu cet arrachement pour que nous découvrions à quelle profondeur avaient pénétré les racines. Ce qu’était devenu le grain de sénevé enfoui par le cardinal Suhard dans le terreau de chez nous, jugez-en d’après ce grand arbre abattu au bord de la route, qui perd sa sève comme du sang, et où les oiseaux du ciel ne nicheront plus.
Dieu sait que je n’ai aucun goût pour jouer «les cardinaux verts» comme en d’autres temps on appelait les académiciens qui se mêlaient des affaires de l’Eglise. Mais se taire est un devoir sans risque. Depuis quarante-huit heures les lettres, les appels me sont venus de partout : «Nous ne pouvons crier que par votre bouche». Cri de douleur, non de révolte. Ce que ces prêtres, ces laïcs intellectuels, ces étudiants redoutent, c’est que leur silence induise le Saint-Siège en erreur et lui fasse croire qu’ils n’ont pas ressenti le coup au plus intime de l’être. Toute l’aile marchande de l’Eglise de France est atteinte affreusement, il faut que les Congrégations romaines le sachent.
Déjà elles ne pouvaient plus ignorer que les prêtres ouvriers étaient devenus partie intégrante du prolétariat français, qu’ils y étaient incorporés en tant que prêtres, en tant que témoins du Christ et de l’Eglise. Il faut aujourd’hui révéler au Nonce une autre vérité : que le jeune laïcat, qui a été une grande pensée de Pie XI, a été formé pour une grande part en France par l’ordre de Saint Dominique : Sept et Temps présent autrefois, aujourd’hui La Vie intellectuelle , Les Editions du Cerf constituent une source vive où toute une génération est venue nourrir sa foi. Qu’il y ait eu des imprudences, des positions aventurées, nous l’admettons. Certains aspects de l’apostolat dominicain ont pu irriter. «Le dominicain de choc», nous en avons tous médit. Mais aujourd’hui qu’ils sont atteints dans leurs théologiens les plus éminents, nous voyons mieux ce que l’Ordre incarne au milieu de nous : l’esprit dominicain, c’est l’esprit de liberté au sein même de l’Eglise, en étroite union avec le Siège de Pierre.
On frémit d’apprendre que le Saint-Office a été au moment de frapper l’Ordre, chez nous, à sa racine même, en s’attaquant au noviciat du Saulchoir. Toucher en France aux fils du Père Lacordaire, les atteindre mortellement, équivaudrait à dynamiter une de nos cathédrales. Ici se délimitent mal les droits imprescriptibles de l’Eglise, et ceux, non moins imprescriptibles, de la nation. Et certes il serait injuste d’imputer à Rome l’erreur faite par les hommes politiques de la IIIème République. La dénonciation du Concordat n’est pas de son fait. Si désormais le Nonce apostolique à Paris n’est pas un agent diplomatique comme les autres, s’il détient en terre française un pouvoir réel plus étendu qu’aucun des membres du gouvernement, nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes ou plutôt qu’à Emile Combes qui déposa, il y aura cinquante ans au mois de novembre, le projet de loi sur la séparation des Eglises et de l’Etat.
Mais c’est dans la mesure où les catholiques de France sont des catholiques de tout repos, dans la mesure où ils se trouvent liés de toute leur foi et de tout leur amour au Siège de Pierre, dans la mesure où enfin le risque de schisme, en ce qui les concerne, n’est pas imaginable, qu’ils se sentent pressés de trouver un recours. Leurs prêtres, leurs religieux ne peuvent demeurer plus longtemps à la merci de dénonciations qui hélas ! (et Rome aurait beau jeu à nous le rappeler) viennent presque toutes de France même. «Cherchez parmi vous ceux qui vous accusent», me disait récemment un Romain.
Ce Concordat que la IIIème République a détruit, la IVème République, dans l’intérêt de l’Eglise et de la France, n’aurait-elle pas raison de le rétablir en l’adaptant aux exigences de notre époque ? Je pose la question. Mais ce dont je suis assuré, c’est que si l’offensive en cours se poursuivait, sans égard pour ce qui est dû à cette très Sainte Eglise de France, institutrice et modèle de toutes les autres dans la philosophie, dans la théologie comme dans l’apostolat missionnaire, la nation entière se sentirait atteinte en la personne de ses meilleurs fils. Ce serait, me semble-t-il, l’intérêt de l’Eglise, dans un débat de cet ordre, qu’elle trouvât un jour en face d’elle un interlocuteur qui détienne un autre droit que celui de se taire. J’en suggère l’idée à l’éloquent Maurice Schumann, qui se souvient peut-être d’avoir fait ses premières armes à mes côtés, sous la bannière de saint Dominique.»
François MAURIAC, Le Figaro, 16 février 1954.
LA DÉCLARATION D’INVESTITURE DE PIERRE MENDÈS FRANCE LE 17 JUIN 1954 (EXTRAITS)
Une négociation est engagée à Genève, en liaison avec nos alliés et les États associés (…). Nous sommes aujourd’hui le 17 juin. Je me présenterai devant vous avant le 20 juillet et je vous rendrai compte des résultats obtenus. Si aucune solution satisfaisante n’a pu aboutir à cette date, vous serez libérés du contrat qui nous aura liés et mon gouvernement remettra sa démission à M. le président de la République. Mon objectif est donc la paix. Mesdames, Messieurs, c’est dans cette perspective, ce but une fois atteint dans le délai prévu, que je me place maintenant afin de vous indiquer succinctement les étapes suivantes que mon gouvernement fixera pour son action.
Action sur l’économie d’abord. Le 20 juillet au plus tard, je vous soumettrai un programme cohérent de redressement et d’expansion destiné à assurer progressivement le relèvement des conditions de vie et l’indépendance économique du pays, le développement de notre agriculture par une politique coordonnée de la production et des débouchés, un effort accru et dynamique dans l’ordre du logement et des habitations à loyer modéré.
La France devra se prononcer avec clarté sur la politique qu’elle entend suivre à l’égard d’un problème capital et longtemps différé : celui de l’Europe. Vis-à-vis de ses amis comme vis-à-vis d’elle-même, la France ne peut plus prolonger une équivoque qui porte atteinte à l’alliance occidentale. (…) La Communauté européenne de défense nous met en présence d’un des plus graves cas de conscience qui ait jamais troublé le pays.
(…) L’une de ces données est la nécessité d’un réarmement occidental imposé par la situation internationale et qui a conduit à envisager – perspective cruelle pour les Français – les conditions de la participation de l’Allemagne à une organisation commune de défense… (…) Je m’adresse aux adversaires comme aux partisans de la Communauté européenne de défense, pour qu’ils renoncent aux intransigeances.
L’accomplissement des tâches qui viennent d’être énumérées doit aller de pair avec le rétablissement de la concorde et de la sécurité dans ces deux pays d’Afrique du Nord qu’endeuillent, en ce moment même, le fanatisme et le terrorisme. Le Maroc et la Tunisie auxquels la France a ouvert les voies du progrès économique, social et politique, ne doivent pas devenir sur les flancs de nos départements algériens, des foyers d’insécurité et d’agitation; cela, je ne l’admettrai jamais. Mais j’ajoute avec la même netteté que je ne tolérerai pas non plus d’hésitation ou de réticences dans la réalisation des promesses que nous avons faites à des populations qui ont eu foi en nous.
Il n’y aura pas de ces négociations interminables que nous avons connues ; je n’admettrai ni exigences ni vetos. Le choix des ministres, en vertu de la constitution, appartient au président du Conseil investi, et à lui seul. Je ne suis pas disposé à transiger sur les droits que vous m’auriez donnés par votre vote d’investiture (…). »
UN GAULLISTE DANS LE GOUVERNEMENT MENDÈS FRANCE
« J’étais entré au gouvernement parce que la personnalité de Pierre Mendès France avait transformé le jeu politique. Sa démarche d’esprit, son approche des problèmes, ses relations avec les partis, en un mot son style étaient différents de ce qu’avait jusqu’alors connu le régime… C’en était fait de ces négociations, de ces conciliabules, de ces compromis et compromissions qui compliquaient à l’envi la constitution des ministères ; Pierre Mendès France refusa tout contact avec les états-majors politiques, y compris le sien*. Il s’entretint seulement avec ceux qu’il entendait appeler auprès de lui – radicaux, UDSR, indépendants et URAS** Pour ma part, je, fus réveillé à quatre heures du matin par un messager casqué et botté. Le télégramme était concis: » Désirant vous participiez au gouvernement, vous attendrai onze heures mon cabinet présidence commission des Finances « … J’assumai donc une charge ministérielle pour la première fois… J’avais en charge, avec les Travaux Publics, l’ensemble des Transports et Communications, vaste domaine dont Pierre Mendès France qui savait déléguer pouvoirs et responsabilités, me demanda de ne lui parler que pour des questions de principe… Dès notre conversation initiale, j’avais souligné ma position à l’égard de la CED… en lui précisant que je quitterais le gouvernement… si venait devant l’Assemblée Nationale le projet de loi portant ratification du traité. »
* Parti radical.
** Les Républicains-sociaux
in J. CHABAN-DELMAS, L’ardeur, Paris, Stock 1975.
Apostrophe de Pierre Poujade au Président du Conseil
« Aujourd’hui la France bouge, car elle ne veut plus de ta politique de trahison. Elle ne veut plus de cette lutte fratricide en Afrique du Nord et ne te confiera pas ses enfants pour un nouveau Dien Bien Phu. (…)
Aujourd’hui, Faure, tu t’inscris dans l’histoire comme l’un des hommes les plus néfastes à la patrie.
Aujourd’hui, Faure, je te dis : fous le camp, toi et les tiens, car demain il sera peut-être trop tard.
Et vous, parlementaires, qui, à la lecture de cet éditorial, allez peut-être ricaner, il y en a en général autant à votre service. Le peuple de France en a assez des compromissions, des scandales, des trahisons et des abandons. Il en a assez de voir danser le rigodon sur son ventre par une maffia apatride de trafiquants ou de pédérastes.
Retenez bien ce que je vous dis, tout ce qui devra être dit le sera en temps utile. Personne ne m’empêchera de gueuler la vérité et, le jour du grand règlement de comptes, il y en aura pour tous. »
in Éditorial de Fraternité française, 10 septembre 1955.
Qu’est-ce que le poujadisme ?
« Le poujadisme est » contre « . Il est contre tout, contre le fisc d’abord, mais aussi contre le Prisunic, contre la Sécurité sociale, les fonctionnaires, les inspecteurs des Finances, les puissances d’argent (…). Si le mouvement, en fin de compte, doit se classer à droite, c’est dans une droite plébiscitaire, antiparlementaire et, en prenant le mot dans son sens vague, fasciste. Il faut cependant l’associer, du moins dans son origine, à une classe sociale, celle des artisans, du petit et moyen commerce (…). C’est une France de tradition artisanale et individualiste se dressant contre une marée de machinisme collectif qui menace de la submerger. Il s’agit d’un combat d’arrière-garde, celle d’une France préindustrielle, se réclamant de mythes où se mêlent une gauche d’hier et une droite d’aujourd’hui : défense du paysan contre la domination urbaine, de la petite ville contre la grande, de la province contre Paris, du travailleur indépendant contre l’usine, des régions en déclin contre les concentrations industrielles, de l’individu contre l’État socialiste envahissant, d’une sorte de » France éternelle « , instinctivement hostile aussi bien au moralisme anglo-saxon qu’au communisme russe. S’inscrivant dans une vieille tradition, le poujadisme sera donc logiquement antiparlementaire, antisémite, xénophobe, patriotard, démagogue en même temps que conservateur. »
in André SIEGFRIED, De la III° à la IV° République, Grasset, 1956.
La violence du mouvement Poujade
Rapidement devenu un populisme d’extrême droite, le mouvement Poujade met le régime en accusation.
« Liste d’union et de fraternité française (…).
Contre les trusts apatrides qui vous ruinent et vous asservissent ;
Les trusts électoraux qui escroquent vos suffrages.
Contre le gang des exploiteurs qui vivent de votre travail et de votre épargne ; le gang des charognards qui s’engraissent du sang de vos morts.
Révoltez-vous
Ouvriers et employés aux salaires de famine ; Commerçants et artisans écrasés par le fisc;
Producteurs de la ville et de la terre ; Hommes et femmes des professions libérales ;
Fonctionnaires, vieillards abandonnés par la société ;
Jeunes inquiets de votre avenir.
Comme vous, nous voulons la justice. Justice fiscale pour les contribuables;
Justice sociale pour les travailleurs. Et pour les traîtres, justice militaire. Sortez les sortants. »
Affiche électorale, janvier 1956, in S. Hoffmann. Le Mouvement Poujade, Armand Colin, 1956.
UNE AFFICHE ÉLECTORALE POUJADISTE (1956)
« Si vous êtes satisfait de vos élus ; si vous vous résignez à la décadence, à la ruine et à la servitude, restez chez vous. Mais si vous n’acceptez pas que la France devienne le pays des immatriculés, si vous vous révoltez contre la tyrannie des irresponsables, contre l’étranglement fiscal, contre l’exploitation de l’homme par l’homme.
RÉVEILLEZ-VOUS
CONTRE les trusts apatrides qui vous ruinent et vous asservissent ; les trusts électoraux qui escroquent vos suffrages. CONTRE le gang des exploiteurs qui vivent de votre travail et de votre épargne ; le gang des charognards qui s’engraissent du sang de vos morts.
RÉVOLTEZ-VOUS. Vous savez que nous vomissons la politique et ses professionnels. Confiez-nous la mission d’imposer LA RÉUNION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
Ouvrières et employés aux salaires de famine ; commerçants et artisans écrasés par le fisc ; producteurs de la ville et de la terre ; hommes et femmes des professions libérales ; fonctionnaires, vieillards abandonnés par la société ; jeunes inquiets de votre avenir.
Comme vous, nous voulons la justice : justice fiscale pour les contribuables ; justice sociale pour les travailleurs ET POUR LES TRAÎTRES, JUSTICE MILITAIRE
SORTEZ LES SORTANTS »
Un programme minimum d’action immédiate
« Il faut que, très vite, le groupe socialiste et le Front républicain proposent des méthodes nouvelles, un projet de réforme des méthodes de travail à l’Assemblée. Il faut s’associer à tout ce qui pourra être présenté de sérieux quant à une réforme de la Constitution.
Objectif n° 1 : La paix en Algérie
En fait, l’homme politique qui prétendrait aujourd’hui, qu’il apporte un plan tout prêt pour régler le problème algérien serait un menteur ou un fou. (…)
Or il y a en Algérie deux fausses conceptions à éliminer l’une et l’autre. Celle qui consisterait à dire (hélas! celle qui a consisté à dire jusqu’à maintenant): » Seuls comptent, là-bas, les intérêts – je n’ose pas dire de la France -, des Français, des Européens de là-bas « .
Mais serait folle et condamnable, de la même façon, une politique qui consisterait à dire: « Doivent être intégralement négligés les intérêts du million d’Européens ou de Français blancs qui vivent là-bas. » Ce qu’il nous faut dire solennellement aux Algériens, c’est que leur sort définitif ne sera pas fixé par nous seuls, mais dans une libre discussion entre eux et nous. »
in Guy Mollet, discours au congrès national extraordinaire de la SFIO, 15 janvier 1956.
LES ELECTIONS DE 1956 ET LE CHOIX DE GUY MOLLET
« Aux élections de janvier 1956, le Front Républicain l’emporta de justesse. Dès le lendemain, bon nombre d’élus de l’autre bord s’empressèrent de venir grossir ses rangs, n’ayant à franchir qu’une frontière illusoire.
Pierre Mendès France avait gagné les élections, menant la campagne avec son énergie et sa sobriété habituelles. Ce fut Guy Mollet que le Président Coty appela pour être Président du Conseil. Il s’en expliqua devant moi en disant que les qualités mêmes de Pierre Mendès France, la force de sa personnalité, la rigueur de son action le desservaient dans le moment. L’hostilité à laquelle il était en butte chez les radicaux et ailleurs risquait de déclencher contre son gouvernement des menées plus ou moins souterraines, qui auraient tôt fait de le détruire. La situation était trop tendue pour qu’on pût prendre un pareil risque. L’affaire d’Algérie, qui avait débuté par la Toussaint sanglante de 1954, s’annonçait redoutable. Dans l’état d’instabilité constitutionnelle où se trouvait la France, il fallait prévenir tout à-coup. Et les hommes devaient d’autant plus s’effacer devant l’intérêt public qu’ils en étaient les meilleurs serviteurs. »
in J. CHABAN DELMAS, L’ardeur, op. cit.
Les réflexions d’un homme politique à la veille du 13 mai
« Les figurants se succèdent au fond du théâtre à un rythme sans cesse accru ; le devant de la scène apparaît de plus en plus vide (…) Le régime se survit encore, mais ses infrastructures se corrodent rapidement sous l’acide de la haine et du mépris public. Son effondrement est proche… ou plutôt son effacement progressif, mais qui va bénéficier de sa disparition ? La France est-elle prête à subir la dictature d’une junte militaire ? Tout mon être se révulse à la seule évocation de cette idée et pourtant j’ai bien eu l’impression, ces jours derniers, que des secteurs entiers du pays salueraient avec enthousiasme une telle issue et que peu nombreux seraient les Français qui s’y opposeraient activement. Deux voies seulement me semblent ouvertes : ou bien, et rapidement, obtenir la formation d’un gouvernement franchement républicain, décidé à préconiser une solution libérale en Algérie. Alors l’épreuve de force s’engagera entre activistes et démocrates-décolonisateurs. Si le leader désigné se montre ferme, nous pourrons peut-être la gagner et conforter ensuite le régime (…). Ou bien rechercher une formule qui concilie la réforme des institutions et la poursuite d’une solution libérale en Algérie. Sans doute alors, quoique je n’arrive guère à m’en persuader, est-ce vers le général de Gaulle qu’il faut porter le regard. »
in R. BURON, Les dernières années de la IV° République, Carnets politiques, à la date du 12 février 1958, Plon, 1968.
Le changement de régime à travers les déclarations
Dans la nuit du 13 au 14 mai 1958, à Alger, où l’armée a imposé un comité de salut public, le général Massu lance un appel.
« Le comité de salut public supplie le général de Gaulle de bien vouloir rompre le silence en vue de la constitution d’un gouvernement de salut public qui seul peut sauver l’Algérie de l’abandon. »
Le 15 mai, le général de Gaulle répond par un communiqué.
« La dégradation de l’État entraîne infailliblement l’éloignement des peuples associés, le trouble de l’armée au combat, la dislocation nationale, la perte de l’indépendance. Depuis douze ans, la France, aux prises avec des problèmes trop rudes pour le régime des partis, est engagée dans ce processus désastreux. Naguère, le pays m’a fait confiance pour le conduire tout entier vers son salut. Aujourd’hui, devant les épreuves qui montent à nouveau vers lui, qu’il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. »
Le 16 mai, le Journal communiste L’Humanité appelle à la résistance.
« De Gaulle jette le masque. Le chef des généraux factieux revendique le pouvoir personnel. À bas la dictature militaire! Travailleurs, républicains de toutes tendances, unissez-vous, agissez, organisez-vous pour briser toute tentative de coup d’État! Vive la République! »
Le 29 mai, le président Coty demande à De Gaulle de former un gouvernement.
« Dans le péril de la patrie et de la République, je me suis tourné vers le plus illustre des Français, vers celui qui, .aux années les plus sombres de notre histoire, fut notre chef pour la reconquête de la liberté et qui, ayant ainsi réalisé autour de lui l’unanimité nationale, refusa la dictature pour rétablir la République. À quelles conditions accepterait-il d’assumer la charge accablante du pouvoir ? »
Le 1° juin, Charles de Gaulle demande aux députés de l’investir comme président du Conseil.
« Le gouvernement vous demandera les pleins pouvoirs afin d’être en mesure d’agir dans les conditions d’efficacité, de rapidité, de responsabilité que les circonstances exigent. (…)
Mais ce ne serait rien que de remédier provisoirement à un état de choses désastreux si nous ne nous décidions pas à en finir avec la cause profonde de nos épreuves. Le gouvernement que je vais former vous saisira sans délai d’un projet de réforme de la Constitution, de telle sorte que l’Assemblée nationale donne mandat au gouvernement d’élaborer, puis de proposer au pays par la voie du référendum, les changements indispensables. »
Pierre Mendès France lui répond.
« Quoi qu’il en coûte aux sentiments que j’éprouve pour la personne et pour le passé du général de Gaulle, je ne voterai pas en faveur de son investiture. je ne puis admettre de donner un vote contraint par l’insurrection et la menace d’un coup de force militaire. Car la décision que l’Assemblée va prendre – chacun le sait ici n’est pas une décision libre, le consentement que l’on va donner est vicié. »
De Gaulle rompt le silence
» La dégradation de l’État entraîne infailliblement l’éloignement des peuples associés, le trouble de l’armée au combat, la dislocation nationale, la perte de l’indépendance. Depuis douze ans, la France, aux prises avec des problèmes trop rudes pour le régime des partis, est engagée dans ce processus désastreux.
Naguère, le pays, dans ses profondeurs, m’a fait confiance pour le conduire tout entier jusqu’à son salut.
Aujourd’hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu’il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République.
Déclaration du 15 mai 1958
Ch. de Gaulle, Conférence de presse, tenue au Palais d’Orsay, 19 mai 1958.
« Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole, et dans la métropole par rapport à l’Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi, ce peut être le début d’une sorte de résurrection. Voila pourquoi le moment m’a semblé venu où il pourrait m’être possible d’être utile encore une fois directement à la France. L’armée a jugé de son devoir d’empêcher que le désordre s’établisse. Elle l’a fait et elle a bien fait. (…) Ce qu’il y a de mieux à faire et même la seule chose à faire, c’est ce qui doit empêcher que l’Algérie s’écarte de la France, ce qu’elle ne veut pas et la France non plus. Quant à l’armée, qui est normalement l’instrument de l’État, il convient qu’elle le demeure. Mais encore faut-il qu’il y ait un État. »
Communiqué du Général de Gaulle le 27 mai 1958
« J’ai entamé hier le processus régulier nécessaire à l’établissement d’un gouvernement républicain capable d’assurer l’unité et l’indépendance du pays. Je compte que ce processus va se poursuivre et que le pays fera voir, par son calme et sa dignité, qu’il souhaite le voir aboutir.
Dans ces conditions, toute action, de quelque côté qu’elle vienne, qui met en cause l’ordre public, risque d’avoir de graves conséquences. Tout en faisant la part des circonstances, je ne saurais l’approuver.
J’attends des forces terrestres, navales et aériennes, présentes en Algérie, qu’elles demeurent exemplaires sous les ordres de leurs chefs. A ces chefs, j’exprime ma confiance. »
De Gaulle et la crise de mai 1958
Le 11 mai 1958, soit un dimanche matin, l’édition dominicale de L’Echo d’Alger, Dimanche-Matin, publie un éditorial de son rédacteur en chef, Alain de Sérigny.
« A cor et à cri l’Algérie tout entière, privée de sa représentation légale à l’Assemblée nationale, supplie en vain le Parlement de faire taire ses querelles intestines pour la formation d’un gouvernement de salut public, seul capable de sauver dix millions de Français qui, aux yeux de certains, commettent sans doute un crime en voulant rester français. Je n’ignore pas, mon Général, qu’à plusieurs de vos amis, qui s’étonnaient de votre silence, vous avez répondu fort à propos : « A quoi bon parler si l’on ne peut agir ! » Aujourd’hui, me tournant vers vous, je m’écrie : « Je vous en conjure, parlez, parlez vite, mon Général, vos paroles seront une action. »
Le 14 mai, Georges Bidault adresse une lettre au général de Gaulle.
« Mon Général,
Je me crois permis et je crois de mon devoir de me tourner vers vous dans cette heure où, comme il n’est plus possible d’en douter encore, l’aggravation du péril couru par la nation ne peut plus être endigué que par vous.
Je n’ai pas assiégé votre porte et si je me tourne aujourd’hui vers vous, ce n’est à aucun titre de gouvernement ou de parti. C’est parce que j’ai été au temps de la douleur et du combat, quand vous étiez le Chef de la France libre, votre compagnon de lutte et d’espérance. C’est le deuxième et dernier président du Conseil national de la Résistance qui vous adjure de jeter dans la balance, à l’heure et sous la forme que vous jugerez les meilleures le poids de votre nom et de votre parole pour le salut de la patrie en péril.
Il est bien tard. Je crois qu’il n’est pas trop tard. Il faut empêcher que le dernier espoir s’efface. Vous seul en avez le pouvoir si vous en prenez la décision. »
Le 15 mai, en fin d’après-midi, l’AFP diffuse un communiqué du général de Gaulle qui l’avait rédigé la veille :
« La dégradation de l’Etat entraîne infailliblement l’éloignement des peuples associés, le trouble de l’armée au combat, la dislocation nationale, la perte de l’indépendance. Depuis douze ans, la France, aux prises avec des problèmes trop rudes pour le régime des partis, est engagée dans ce processus désastreux.
Naguère, le pays, dans ses profondeurs, m’a fait confiance pour le conduire tout entier jusqu’à son salut.
Aujourd’hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu’il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. »
Le lundi 19 mai, en début d’après-midi, au Palais d’Orsay, de Gaulle tient une conférence de presse. C’est la première fois qu’il prend la parole en public depuis trois ans. Voici la déclaration liminaire de cette conférence de presse.
« Mesdames, Messieurs,
Il y aura bientôt trois années que j’ai eu le plaisir de vous voir. Lors de notre dernière rencontre, je vous avais fait part de mes prévisions et de mes inquiétudes quant au cours des événements et de ma résolution de garder le silence jusqu’au moment où, en le rompant, je pourrais servir le pays.
Depuis lors, en effet, les événements ont été de plus en plus lourds. Ce qui se passait en Afrique du Nord, depuis quatre ans, était une très dure épreuve. Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l’Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi, ce peut être le début d’une sorte de résurrection. Voilà pourquoi le moment m’a semblé venu où il pourrait m’être possible d’être utile encore une fois directement à la France.
Utile, pourquoi ? Parce que, naguère, certaines choses ont été accomplies, que les Français le savent bien, que les peuples qui sont associés au nôtre ne l’ont pas oublié et que l’étranger s’en souvient. Devant les difficultés qui nous assaillent et les malheurs qui nous menacent peut-être ce capital moral pourrait-il avoir son poids dans la politique, dans un moment de dangereuse confusion.
Utile, aussi, parce que c’est un fait que le régime exclusif des partis n’a pas résolu, ne résout pas, ne résoudra pas, les énormes problèmes avec lesquels nous sommes confrontés, notamment celui de l’association de la France avec les peuples d’Afrique, celui aussi de la vie en commun des diverses communautés en Algérie et, même, celui de la concorde à l’intérieur de chacune de ces communautés. Les combats qui se livrent en Algérie et la fièvre qui y bouillonne ne sont que les conséquences de cette carence. Si les choses continuent de la façon dont elles sont engagées, nous savons tous que le régime, tel qu’il est, pourra faire des programmes, manifester des intentions, exercer des efforts en sens divers, mais qui n’ira pas à des aboutissements. Nous risquerons que ces aboutissements ne soient un jour imposés du dehors ce qui serait sans aucun doute la solution le plus désastreuse possible.
Utile, enfin, parce que je suis un homme seul, que je ne me confonds avec aucun parti, avec aucune organisation, que depuis cinq ans je n’exerce aucune action politique, que depuis trois ans je ne fais aucune déclaration, que je suis un homme qui n’appartient à personne et qui appartient à tout le monde.
Utile ? comment ? Eh bien ! si le peuple le veut, comme dans la précédente crise nationale, à la tête du gouvernement de la République française. »
Le 20 mai, le général Salan, adresse ces mots à la foule assemblée sous le balcon du bâtiment dans lequel siège le comité de salut public :
« Algériennes, Algériens,
Au cours de ces journées, de ce Forum devenu le haut lieu de la résistance à l’abandon, a jailli une intense clameur vers Paris. Dans un élan unanime de ferveur patriotique vous avez crié votre volonté farouche de construire une Algérie française nouvelle et fraternelle marquée par la vie en commun des diverses communautés.
Hier soir, de Paris, du coeur même de l’Ile-de-France, une voix sereine s’est fait entendre, le général de Gaulle s’est écrié : « C’est peut-être le début d’une sorte de résurrection. Il faut en prendre acte. Hâtez-vous, les choses et les esprits vont vite.
Ainsi celui qui, en d’autres heures cruciales pour la patrie, a su montrer la voie du salut, a affirmé publiquement avec force et sans ambiguïté qu’il comprenait vos angoisses et vos élans.
Alger, Oran, Constantine, les habitants des cités et des douars, ceux des plaines et des plateaux, les montagnards des djebels les plus reculés, les nomades du Sahara, tous se rassemblent pour affirmer leur fierté et leur volonté d’être Français et pour dire leur certitude de notre victoire.
De toute l’Algérie française jaillit un immense cri de patriotisme et de foi. Dix millions de Français décidés à rester Français, indissolublement liés à l’armée et à la République, vous disent, mon Général, que vos paroles ont fait naître dans leur coeur une espérance de grandeur et d’unité nationale. »
Ce même 20 mai, dans l’après-midi, Pierre Mendès France dit à l’Assemblée nationale son attachement et son inquiétude face à de Gaulle.
« Je suis de ceux qui, dans cette Assemblée, ont suivi le général de Gaulle pendant la guerre et qui en conservent, je m’excuse de le dire, quelque fierté.
Je suis de ceux, même s’ils n’ont pas toujours approuvé telles de ses positions politiques, qui pensaient que le général de Gaulle pouvait peut-être, un jour prochain, mettre au service de la patrie divisée et déchirée, l’immense capital de prestige, de gloire et de confiance dont il dispose non seulement dans la métropole, non seulement à l’étranger, mais surtout parmi les populations autochtones dans tous les pays d’outre-mer qui constituent cette Union française aujourd’hui menacée.
Aux yeux de beaucoup de Français, de Gaulle pouvait être l’artisan le meilleur de la réconciliation nationale. Nombreux sont ceux qui, depuis des années, se sont tournés vers le libérateur de la patrie et lui ont demandé avec insistance, avec anxiété, de s’expliquer sur le drame national qui nous accable et d’aider le pays à sortir de la crise douloureuse dans laquelle il se débat.
A ces appels, le général de Gaulle n’a jamais répondu. Mais voici qu’une sédition a éclaté à Alger, que des hommes, civils ou militaires, ont pris les graves décisions que vous savez en invoquant le nom du général de Gaulle. Et voici qu’aussitôt ils ont obtenu ce que tant d’autres avaient attendu en vain si longtemps : la voix du 18 juin s’est élevée de nouveau, mais, hélas ! – et c’est la première phrase de sa déclaration de la semaine dernière reprise et développée hier – pour justifier ou pour excuser leur comportement, pour condamner les partis (…) ; pour relancer, qu’il le veuille ou non, un mouvement qui s’affaiblissait avant qu’il n’ait parlé et pour rendre courage à des hommes au moment où ils prenaient conscience de la folie antinationale de leur entreprise. »
Sur fond de tension croissante, les tractations se poursuivent, ponctuées de rencontres, d’échanges de messages, de déclarations. De Gaulle suit la situation, rencontre lui aussi plusieurs acteurs politiques de la crise. La menace d’une opération militaire en métropole augmente encore l’impression de déréliction du régime. C’est dans cette atmosphère que de Gaulle rencontre le président du Conseil , Pierre Pflimlin, dans la nuit du 26 au 27 mai. Il donne de cette entrevue sa version dans ses Mémoires d’espoir :
« Je trouve Pierre Pflimlin calme et digne. Il me fait le tableau de la situation, celle d’un pilote aux mains de qui ne répondent plus les leviers de commande. Je lui déclare que son devoir est d’en tirer les conséquences et de ne pas demeurer dans une fonction qu’en somme il n’exerce pas, étant entendu que je suis prêt à faire ensuite le nécessaire. Sans se prononcer explicitement sur cette perspective, le président du Conseil me fait sentir qu’il ne l’exclut pas. Cependant, il me prie d’user tout de suite de mon prestige pour ramener à la discipline le Commandement en Algérie, ce quoi lui-même reconnaît être impuissant. « Rien ne montre, lui dis-je, mieux que votre demande, quelle solution s’impose à la République. » Nous nous séparons cordialement et, à l’aurore, je rentre chez moi convaincu que Pierre Pflimlin prendra bientôt la détermination que je lui ai tracée cette nuit-là. »
La situation, le 27 mai, semble complètement dans l’impasse lorsque tombe une nouvelle déclaration du général de Gaulle :
« J’ai entamé hier le processus régulier nécessaire à l’établissement d’un gouvernement républicain capable d’assurer l’unité et l’indépendance du pays. Je compte que ce processus va se poursuivre et que le pays fera voir, par son calme et sa dignité, qu’il souhaite le voir aboutir.
Dans ces conditions toute action, de quelque côté qu’elle vienne, qui met en cause l’ordre public risque d’avoir de graves conséquences. Tout en faisant la part des circonstances je ne saurais l’approuver.
J’attends des forces terrestres, navales et aériennes présentes en Algérie qu’elles demeurent exemplaires sous les ordres de leurs chefs : le général Salan, l’amiral Auboyneau, le général Jouhaud. A ces chefs j’exprime ma confiance et mon intention de prendre incessamment de prendre contact avec eux. »
Le 29 mai, alors qu’un coup de force militaire semble de plus en plus probable, le général de Gaulle écrit à son fils :
« D’après mes informations, l’action serait imminente du sud vers le nord. J’ai reçu, hier, Le Troquer et Monnerville, que m’envoyait le président Coty, pour voir avec moi à quelles conditions je pourrais former le gouvernement dans l’actuel régime. J’ai précisé mes conditions [délégation de pleins pouvoirs pour un an, recours au référendum pour modifier la Constitution]. Mais il est infiniment probable que rien ne se fera plus dans le régime qui ne peut même plus vouloir quoi que ce soit. »
Le 29 mai, de Gaulle rencontre le président de la République, René Coty, à l’Elysée puis fait diffuser le communiqué suivant à la presse :
« J’ai eu l’honneur de m’entretenir avec M. René Coty. A la demande du président de la République je lui ai indiqué dans quelles conditions je pourrais assumer la charge du gouvernement en ce moment décisif pour le destin du pays.
Le gouvernement, une fois investi par l’Assemblée nationale, recevrait pour une durée déterminée les pleins pouvoirs nécessaires pour agit dans la très grave situation actuelle.
D’autre part mandat serait donné au gouvernement, suivant une procédure prévue par l’actuelle Constitution, de préparer et de soumettre au pays, par voie de référendum, les changements qui doivent y être apportés, notamment en ce qui concerne la séparation et l’équilibre des pouvoirs, ainsi que les rapports de la République française avec les peuples qui lui sont associés.
Je ne saurais entreprendre la tâche de conduire l’Etat et la nation que si ces conditions indispensables m’étaient consenties avec la grande et large confiance qu’exige le salut de la France, de l’Etat et de la République.
Pour m’acquitter d’une telle mission nationale, je pourrai compter, j’en suis sûr, sur le concours ardent et résolu du peuple français tout entier.
Les événements qui nous pressent peuvent, d’un jour à l’autre, devenir tragiques.
Il est d’une urgence extrême de refaire l’unité nationale, de rétablir l’ordre dans l’Etat et de mettre les pouvoirs publics à la hauteur de leurs devoirs. »
Pierre Mendès France contre l’investiture du général de Gaulle le 1° juin 1958
« La IV° République périt de ses propres fautes. Ce régime disparaît parce qu’il n’a pas su résoudre les problèmes auxquels il était confronté. (…) Le » système » que le général de Gaulle a si souvent critiqué et qui méritait, en effet, bien des critiques, a échoué. Mais ce n’est pas la République, ce n’est même pas le système parlementaire qui méritent d’être condamnés. Seul, le mauvais usage qui en a été fait nous a réduits à l’impuissance et nous a conduits à tant de déconvenues. (…) Quoiqu’il en coûte aux sentiments que j’éprouve pour la personne et pour le passé du général de Gaulle, je ne voterai pas en faveur de son investiture ; et il n’en sera ni surpris, ni offensé. Tout d’abord, je ne puis admettre de donner un vote contraint par l’insurrection et la menace d’un coup de force militaire. (…) Car enfin, ce gouvernement, qui nous l’impose ? Hélas ! ce sont les mêmes hommes qui, dans le passé, ont fait échouer toutes les tentatives de règlement raisonnable et humain en Afrique du Nord, qui ont rendu la guerre inévitable, l’ont orientée vers la répression sans issue politique, ont joué sur les nerfs d’une population européenne affolée, et exultent en ce moment parce qu’ils se flattent d’avoir porté le général de Gaulle au pouvoir. Ah ! Puissent-ils être déçus ! je veux l’espérer pour la France et pour la gloire du général de Gaulle lui-même. Certes, il n’a rien révélé des solutions qu’il envisage pour mettre fin à la guerre d’Algérie. (…) Mais on connaît assez son intelligence des grands courants de l’Histoire pour être confiant qu’il voudra les orienter dans les voies de la liberté et de l’association. Seulement, ceux qui l’ont conduit au pouvoir le lui permettront-ils ? Puisse l’Histoire dire un jour que de Gaulle a éliminé le péril fasciste, qu’il a maintenu et restauré les libertés, qu’il a rétabli la discipline dans l’administration et dans l’armée, en un mot qu’il a consolidé et assaini la République. Alors, mais alors seulement, le général de Gaulle incarnera la légitimité. »
in Journal officiel des débats de l’assemblée nationale.
L’indifférence
« Réduire la rébellion de l’armée, la chute de la IVe République et l’avènement du général de Gaulle à l’ambition et aux intrigues du chef de la France libre serait donner à d’aussi grands changements une explication mesquine et fausse. Un peuple tout entier ne bouge pas en ses profondeurs par la chiquenaude d’un commando.
Le mûrissement des révoltes a besoin d’autres soleils que la gloire en veilleuse d’un héros. Ce n’est pas fantaisie du hasard si rarement régime disparut avec autant de discrétion que celui que la quasi-unanimité des Français porta joyeusement en terre en 1958. Pas de morts sur les barricades, pas de président en exil, pas de leader politique en prison, pas de coups de fusil tirés en l’air, pas de paroles historiques. Non (…), rien qu’un président du Conseil tombé de bonne grâce dans le trou du souffleur. La IVe mourut comme elle avait vécu : d’indifférence. (…)
Nos jeunes officiers désespérés au spectacle de leurs propres échecs (…) crurent qu’en favorisant l’émeute ils débarrasseraient la France d’un mal pernicieux symbolisé par le mendésisme. Et cependant, à qui, mieux informés, auraient-ils dû s’en prendre sinon aux exploiteurs de la défaite, aux malins de l’immobilisme, aux Ponce Pilate des guerres coloniales ? A qui, sinon aux théoriciens de Dien Bien Phu, aux ratisseurs du cap Bon, aux fier-à-bras de Rabat, dont la rare sottise avait accumulé les désastres ? (…)
Intoxiqués, ils se rangèrent dans le camp qui n’était pas le leur, se mêlèrent aux conspirations qui visaient à s’emparer de l’État plus qu’à restaurer la grandeur de la France et servirent des desseins dont ils devaient apprendre un jour et à leurs dépens l’étonnante duplicité. Là, de Gaulle les attendait. »
in F. MITTERRAND, Le Coup d’État permanent, Plon, 1965.
L’autorité
« A partir du moment où l’armée passionnément acclamée par une nombreuse population locale, et approuvée dans la métropole par beaucoup de gens écoeurés, se dressait à l’encontre de l’appareil officiel, où celui-ci ne faisait qu’étaler son désarroi et son impuissance, où, dans la masse, aucun mouvement d’adhésion et de confiance ne soutenait les gens en place, il était clair qu’on allait directement vers la subversion, l’arrivée soudaine à Paris d’une avant-garde aéroportée, l’établissement d’une dictature militaire fondée sur un état de siège analogue à celui d’Alger, ce qui ne manquerait pas de provoquer, à l’opposé, des grèves de plus en plus étendues, une obstruction peu à peu généralisée, des résistances actives grandissantes. Bref, ce serait l’aventure, débouchant sur la guerre civile, en la présence et, bientôt. avec la participation en sens divers des étrangers. A moins qu’une autorité nationale, extérieure et supérieure au régime politique du moment aussi bien qu’à l’entreprise qui s’apprêtait à le renverser, rassemblât soudain l’opinion, prît le pouvoir et redressât l’État. Or, cette autorité-là ne pouvait être que la mienne. »
in Ch. de GAULLE, Mémoires d’espoir, Plon, 1970.
Le ralliement de François Mauriac
« Face au pronunciamiento, il faut que la gauche française ressuscite : nous ne devons pas avoir d’autre pensée politique (…). Il faut que le ministère revivifié gouverne, appuyé sur toute la gauche, sans rien concéder aux factieux. Nous espérons toujours en de Gaulle, mais non en un de Gaulle qui répondrait à l’appel d’un Massu. La grandeur de de Gaulle, c’est d’appartenir à la nation tout entière. Puisse-t-il ne pas dire un mot, ne pas faire un geste qui le lierait à des généraux de coup d’État. »
Nuit du 13 au 14 mai 1958.
« Si les Français et le peuple algérien se réconcilient sous l’égide (du général de Gaulle), dans une Algérie autonome où les deux drapeaux flotteront et ne seront plus jamais séparés, eh bien, je me consolerai de voir la République devenir autoritaire, j’accepterai que Marianne ait tout à coup cette grande gueule, ce grand style, cette puissance d’orgueil, d’indifférence et de mépris, dont on peut s’offenser… mais quoi ! Quand le général de Gaulle parlera en Europe au nom de la France, ce sera fini pour elle d’être humiliée. Quel soulagement ! Nous n’en pouvons plus, ne le voyez-vous pas ? »
19 mai 1958.
in Le Nouveau Bloc-notes, 1958-1960, Flammarion, 1961 (recueil des articles parus dans L’Express).
Appel du Comité Central du Parti communiste français contre de Gaulle.
« Travailleurs et républicains,
Français et Française,
L’Assemblée nationale vient d’être mise en demeure par le président de la République d’avoir à désigner le général de Gaulle comme chef du gouvernement. Cette sommation intolérable intervient au moment où la majorité républicaine a manifesté par des votes massifs et répétés son refus de précipiter le pays dans des aventures et la guerre civile et où, à travers toute la France s’affirme avec une puissance imposante la volonté de défense républicaine.
Au même instant, à Alger, le général factieux Massu, au nom des rebelles que de Gaulle n’a cessé de couvrir et d’encourager, se déclare prêt à porter celui-ci au pouvoir par la force armée sur une décision de sa part.
Ni le Parlement, ni le pays n’acceptent ce double défi.
Le pays veut que soient respectées la loi et les institutions et que soit formé sans délai un gouvernement s’appuyant sur la majorité républicaine de l’Assemblée.
Le Comité Central du Parti Communiste Français appelle solennellement tous les travailleurs, tous les démocrates, tous les patriotes à se tenir en permanence en état d’alerte, à riposter énergiquement à toute tentative fasciste, à multiplier les comités de défense républicaine, à manifester sous toutes les formes leur résolution d’épargner à la France les hontes et les malheurs d’une dictature militaire et fasciste.
Le Comité central lance un pressant appel à la jeunesse, aux jeunes travailleurs ouvriers et paysans ainsi qu’aux étudiants. Il s’adresse aux soldats, aviateurs et marins pour qu’ils accomplissent fidèlement leur devoir civique et qu’ils agissent partout aux côtes du peuple contre les hommes de la guerre et du fascisme, pour la défense de la République.
Par son unité, par sa détermination, le peuple de France brisera le complot des généraux factieux et des hommes de la guerre civile.
Vive la République,
Vive la France.
Le comité central de Parti Communiste Français »
in L’Humanité du 30 mai 1958.
L’inaptitude à vivre
« Pour galvaniser les forces du régime, pour entraîner l’opinion, pour gagner la bataille ou la perdre en forçant l’admiration, il eût fallu que M. Pflimlin eût le terrible courage de dénoncer les mensonges passés, d’en finir avec toutes les équivoques et tous les faux-semblants, d’appeler par son nom l’insurrection d’Alger, tout en découvrant ses véritables causes : un complot préparé de longue main et l’exaspération naturelle d’une armée livrée à elle-même, investie en fait de tous les pouvoirs par la démission progressive des autorités civiles, chargée des tâches les plus hétéroclites, tenue pour responsable de toutes les fautes et de tous les échecs. Il eût fallu aussi ne pas ignorer le prodigieux désintéressement de tout un peuple, l’arracher à cette indifférence, à ce mépris tranquille plus grave que la colère. (…) La IVe République meurt beaucoup moins des coups qui lui sont portés que de son inaptitude à vivre.
« SIRIUS » (H. BEUVE-MÉRY), « L’amère vérité », in Le Monde du 29 mai 1958.
» TROUBLÉE MAIS NON STÉRILE… »
« En dépit des guerres menées au-dehors – Indochine, puis Afrique du Nord – en dépit des alternances d’inflation et de stabilisation que les gouvernements auraient pu aisément prévenir, l’après-guerre, autrement dit la courte durée de la IVe République, a été, au point de vue économique et social, une phase de redressement d’abord, de modernisation ensuite. De 1949 à 1957, le produit national brut a progressé de 46 %, la population de 4 à 13 ans de 37 %, la production agricole de 24 %, la production des industries chimiques de 132 %, le parc des voitures particulières a doublé, le volume d’investissements pour le logement a progressé de 142 %, la production des voitures particulières de 285 %. Ce bilan n’est pas supérieur à celui d’autres pays d’Europe, il est inférieur à celui de la République fédérale à certains égards, mais il démontre, s’il en était besoin, la vitalité de la France d’après-guerre.
La IVe République a vécu une existence troublée mais non stérile. Elle a échoué outre-mer, mais non dans la métropole. Avec des erreurs et des lacunes, non sans désordre, elle a engagé le pays dans la voie de la civilisation moderne. (…)
La France se trouvait dans une situation unique parce qu’elle conservait les intérêts et les obligations d’une grande puissance sans en avoir les moyens. (…) La crise du régime a surgi en 1958, au cours du procès de » décolonisation « , à un moment où la France était incapable d’atteindre aucun des objectifs qu’elle s’obstinait à viser simultanément : pacification en Algérie et Marché commun. (…) Quand les hommes ne choisissent pas, les événements choisissent pour eux.
R. ARON, Immuable et changeante, de la lVe à la Ve République, Calmann-Lévy, 1959.





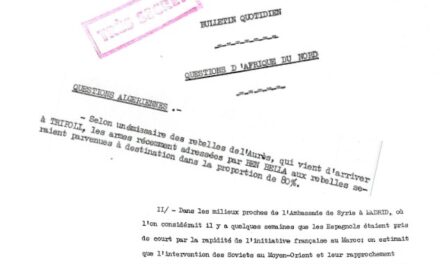








Trackbacks / Pingbacks