Le soviétique Viktor Kravchenko (1905-1966) est passé à la postérité grâce à la publication de son autobiographie intitulée : « J’ai choisi la liberté ! La vie publique et privée d’un haut fonctionnaire soviétique ». Édité aux États-Unis en 1946 où son auteur avait trouvé refuge trois ans plus tôt, le livre sort dans sa version française en 1947 et devient vite un succès de librairie. Il est aussi en 1949 à l’origine d’un procès retentissant, opposant Viktor Kravchenko à deux journalistes membres du PCF qui avaient accusé son auteur d’être un affabulateur et un imposteur, à la solde des Américains.
Dans son livre, Kravchenko retrace sa vie de militant communiste « modèle » dans l’URSS de Staline. Né et vivant en Ukraine, il fait partie des brigades spéciales envoyées par le pouvoir soviétique dans les campagnes « pour veiller à la sauvegarde de la nouvelle récolte » , c’est à dire à contraindre par la force les paysans ukrainiens à livrer leurs grains. Kravchenko est donc le témoin direct de la famine provoquée par la politique soviétique et qui ravage l’Ukraine en 1932 et 1933. C’est cette expérience terrible qui instille en lui les premiers doutes sur la justesse de la cause communiste et sur le bien-fondé de la politique stalinienne de planification et de collectivisation menée à marches forcées.
Les quatre extraits choisis relatent le séjour de Kravchenko dans les campagnes au printemps 1933, au plus fort de la famine en Ukraine. L’auteur n’est ni le premier à dénoncer la tragédie ukrainienne qui était connue dès 1933, ni le seul à dénoncer les crimes du stalinisme en France. Mais le contexte des débuts de la guerre froide contribue puissamment au succès de son pamphlet « j’ai choisi la liberté ».
La terreur au village
Extrait n°1
L’entreprise de collectivisation du pays, pour premiers dividendes, donna de nombreux morts. Les journaux ne soufflaient mot de l’horrible famine qui ravageait la Russie du Sud et l’Asie Centrale, mais cela n’empêchait nullement que tout le monde en fût informé. Nous baptisions « rumeurs antisoviétiques » des bruits que nous savions au fond de nous-mêmes parfaitement exacts.
Malgré les mesures énergiques prises par la police pour que les victimes de la famine ne quittent pas leurs campagnes, Dniepropetrovsk fut bientôt envahi par des hordes de paysans affamés. Beaucoup d’entre eux, n’ayant même plus la force de mendier, hantaient passivement les abords des gares. Les enfants de ces malheureux n’étaient plus que de petits squelettes au ventre gonflé… Jadis, amis et parents de la campagne envoyaient des colis de vivres aux gens de la ville ; maintenant, c’était l’inverse qui aurait dû se produire, mais nos rations alimentaires de citadins étaient déjà si restreintes et si irrégulièrement distribuées que nous n’osions guère nous en priver.
La famine se trouva coïncider avec l’achèvement triomphal, en quatre ans seulement, du premier Piatiletka [1], ce qui permit à la Presse de publier sans arrêt des articles hyperboliques à la louange de « nos réussites ». Cette propagande assourdissante, néanmoins, ne parvenait pas à étouffer complètement les gémissements des mourants et, pour quelques-uns d’entre nous, le tapage incessant quel’on faisait autour de la nouvelle « vie heureuse » était plus effrayant encore que la famine elle-même.
Tout dépendait de la prochaine récolte. Or, on pouvait se demander si la paysannerie affamée trouverait encore la force et le courage de moissonner et de battre le grain malgré les ravages ininterrompus que la mort faisait dans ses rangs. Aussi, pour s’assurer que les récoltes seraient dûment moissonnées, pour empêcher les fermiers désespérés de manger leur blé en vert, pour que les kolkhozes ne sombrent pas sous une mauvaise gestion, et pour lutter contre les ennemis de la collectivisation, des sections politiques spéciales furent créées dans les villages et placées sous l’autorité d’hommes de confiance du Parti : membres de l’Armée et des professions libérales, fonctionnaires, étudiants ou membres du N.K.V.D. Le Comité Central du Parti réunit ainsi une véritable armée de plus de cent mille hommes décidés qu’elle répandit dans les territoires soumis au collectivisme pour veiller à la sauvegarde de la nouvelle récolte. – J’étais parmi ces soldats d’un nouveau genre. […]
Extrait n°2
[…] Armé d’un mandat du Comité Régional, on m’expédia dans la région de Piatikhatski, en compagnie d’un camarade d’école qui était aussi un ami, Iuri. À notre arrivée, nous constatâmes que les fonctionnaires locaux, anéantis par leurs vicissitudes successives, avaient perdu tout ressort. C’est en vain que nous les interrogeâmes sur la nouvelle récolte : ils ne savaient plus parler que de famine, de typhus épidermique et d’actes de cannibalisme. […]
Vers le soir de notre première journée, nous arrivâmes à Petrovo, un village important que nous trouvâmes plongé dans un silence anormal.
— On a mangé tous les chiens, voilà pourquoi il y a si peu de bruit, nous expliqua le paysan qui nous conduisait à la Section Politique. Si vous ne voyez personne dans les rues, c’est que les gens ne marchent guère : ils n’ont plus la force, vous comprenez…
Nous nous présentâmes au chef de la Section Politique, qui nous fit conduire à une cabane de paysan pour y passer la nuit. Un pauvre lumignon fumeux éclairait l’habitation. Notre hôtesse, une jeune paysanne, avait un visage dépourvu de toute expression ; la tristesse ou la peur ne se lisaient même plus sur ce visage émacié dont la famine avait fait une véritable tête de mort. Dans un coin, sur un lit étroit, gisaient deux enfants, si parfaitement immobiles qu’on les aurait crus privés de vie.
— Nous nous excusons de vous déranger, dit Iuri ; nous ne resterons d’ailleurs pas longtemps. Demain matin, nous serons partis.
Malgré lui, mon camarade s’exprimait d’une voix basse et contenue, comme dans une église ou un cimetière.
— Vous êtes les bienvenus, dit la jeune femme ; je regrette seulement de ne rien pouvoir vous offrir. Il y a des semaines que nous n’avons pas vu la couleur d’un morceau de pain… Il me reste bien quelques pommes de terre, mais nous ne voudrions pas les manger trop vite…
Elle fondit en larmes et reprit :
— Toutes ces misères finiront-elles jamais, ou bien faut-il que mes enfants et moi, nous mourions comme tant d’autres ?
— Où est ton mari ? lui demandai-je.
— Je ne sais pas. On l’a arrêté et il a sans doute été déporté. Mon père et mon frère l’ont été aussi. Si l’on nous a laissés ici, moi et les enfants, c’est sûrement pour nous faire mourir de faim.
Iuri déclara qu’il voulait fumer une cigarette et sortit précipitamment ; je compris qu’il avait peur de fondre en larmes devant cette malheureuse.
— Ne t’abandonne pas au désespoir, ma pauvre femme, dis-je à la paysanne. Je sais combien c’est dur, mais si tu aimes tes enfants, tu ne dois pas abandonner la lutte. Installe tes petits à table ; mon camarade et moi, nous avons apporté un peu de nourriture de la ville. Vous allez tous dîner avec nous.
Quand Iuri fut revenu, nous déballâmes nos provisions et nous eûmes soin de manger frugalement tous deux pour que les autres pussent satisfaire leur faim. Les enfants couvraient d’un regard incrédule le poisson fumé, le lard, le thé et le sucre que nous avions déposés devant eux. Bientôt, ils se mirent à manger voracement, précipitamment, comme s’ils eussent craint de voir toutes ces bonnes choses disparaître aussi miraculeusement qu’elles étaient venues.
Lorsqu’elle eut couché ses enfants, notre hôtesse nous fit quelques confidences.
— Je ne vous parlerai pas des morts, nous dit-elle, car je suis sûre que vous en savez aussi long que moi là-dessus. Mais ceux qui sont à moitié morts, ceux qui sont presque morts sont plus à plaindre encore. Il y a, à Petrovo, des centaines de malheureux torturés par la faim et il en meurt chaque jour je ne sais combien. Beaucoup sont si faibles qu’ils ne peuvent même plus sortir de chez eux… De temps à autre, une voiture parcourt le village et ramasse les cadavres… Nous avons dévoré tout ce qui nous tombait sous la main : des chats, des chiens, des mulots, des oiseaux. Demain matin, quand il fera jour, vous pourrez voir que les arbres n’ont plus d’écorce : on l’a mangée aussi. On a dévoré jusqu’au fumier des chevaux…
Sans doute devais-je avoir l’air incrédule, car elle reprit aussitôt :
— Parfaitement, le fumier des chevaux ! On s’est même battu pour l’avoir. Vous comprenez, il reste parfois des grains entiers, dedans.
C’était la première fois que Iuri venait dans les campagnes. J’eus peur que ce premier contact, avec son cortège d’horreurs, fût trop pénible pour lui et j’interrompis la jeune femme en lui disant qu’il fallait que nous allions nous coucher. Mais nous ne dormîmes guère cette nuit-là, Iuri et moi, et c’est avec plaisir que nous saluâmes le jour. […]
Extrait n° 3
[…] Tandis que nous reprenions notre marche à travers le village, Iuri et moi, l’extraordinaire silence qui l’enveloppait nous frappa de nouveau. Nous venions de déboucher sur un vaste espace découvert qui avait dû être naguère la place du marché, quand Iuri me prit le bras et me serra au point de me faire mal : devant nous, sur le sol, gisaient des cadavres d’hommes, de femmes et d’enfants, à peine recouverts d’une légère couche de menue paille. J’en comptai dix sept… Sur ces entrefaites, une voiture arriva, dans laquelle deux hommes se mirent à entasser les cadavres comme ils l’eussent fait pour des bûches.
Pendant que Iuri se rendait à la Ferme d’État où il se procurerait un moyen de transport pour nous conduire à notre destination, je retournai à la Section Politique pour m’entretenir avec Gromov. Il se montra extrêmement heureux de me voir et m’emmena à la Ferme d’État qui offrait le type même de l’entreprise gouvernementale, appartenant à l’État et entièrement dirigée par lui ; les fermiers qui y étaient employés percevaient des gages, ce qui les différenciait de leurs collègues des kolkhozes, ou fermes collectives dirigées par des comités paysans.
— Iasha, lui dis-je tandis que nous parcourions les champs où mûrissaient l’orge et l’avoine, j’ai traversé tout à l’heure la place du Marché et…
— Oui, Vitia, interrompit-il, je sais. Combien y avait-il de morts, aujourd’hui ? – Dix-sept seulement ? Certains jours, il y en a bien davantage… Et que pouvons-nous faire, sinon ramasser les corps et les enterrer ? Le Gouvernement, vois-tu, leur a arraché tout ce qui
leur restait de grain, le trimestre dernier, et il y a belle lurette qu’ils ont dévoré le peu qu’ils avaient touché pour leur travail ou les quelques bribes qu’ils avaient réussi à cacher. Tout cela est triste, tout cela est horrible, je le sais bien, mais qu’y faire ? […]
Extrait n°4
[…] Cette nuit-là, dans mon lit, je songeai longtemps à la nouvelle catégorie de privilégiés qu’abritait le village : ces fonctionnaires du Parti et du Soviet local qui touchaient du lait et du beurre, ainsi que des provisions diverses fournies par la Coopérative, alors que tout le reste de la population mourait de faim. Ils obéissaient aveuglément, comme des esclaves, aux ordres qui leur venaient du pouvoir central et ne se préoccupaient en aucune façon des souffrances du menu peuple. La corruption de l’esprit, chez ces privilégiés, avait atteint un degré incroyable ces gens qui, quelques années plus tôt, n’étaient eux-mêmes que de pauvres paysans, avaient déjà perdu tout souvenir de leur condition d’origine. Ils formaient maintenant une caste à part, une clique nettement scindée du reste de la population où chacun s’épaulait l’un l’autre ; pratiquement, ils formaient une véritable bande de complices, ligués contre la communauté. […]
Victor Kravchenko, J’ai choisi la liberté, Éditions Self, Paris 1947, Pages 159 et suivantes.

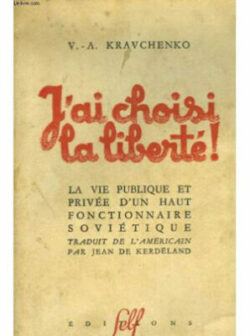
![Image illustrant l'article Plan_du_cimetiere_des_Sts_[...]Bernier_Claude-Louis_btv1b10302883v de Clio Texte](https://clio-texte.clionautes.org/wp-content/uploads/cliotexte/2023/08/plan-du-cimetiere-des-sts--bernier-claude-louis-btv1b10302883v-440x264.jpeg)











Trackbacks / Pingbacks