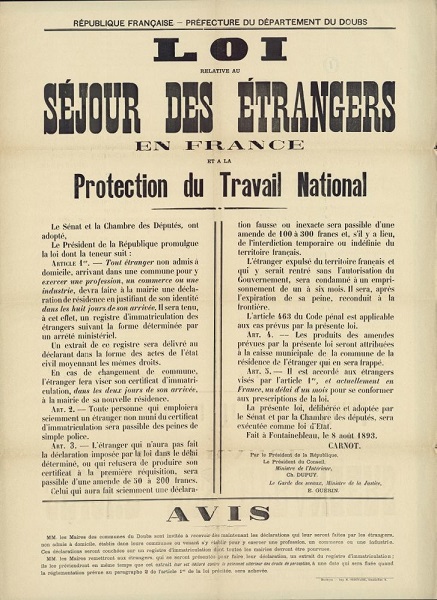La France est depuis le milieu du 19ème siècle un grand pays d’immigration, dont les flux et les apports successifs ont contribué à la formation du peuple français, tel qu’il est aujourd’hui. Compte tenu de son importance démographique, économique, sociale et culturelle, il est logique que la question de l’immigration se soit invitée, de façon récurrente, dans les débats politiques de la nation.
Ce fut le cas sous la troisième République, au milieu des années 1880, comme le texte présenté ici en témoigne. Cet article a été publié en première page du quotidien Le Temps, dans son édition du 27 janvier 1886. Fondé en 1861, Le Temps est un quotidien national qui s’est imposé parmi les élites françaises comme un journal sérieux et de qualité. Ses colonnes accordent une importance particulière à la politique étrangère et à la politique nationale. En 1886, sa ligne politique peut être définie comme républicaine et conservatrice.
L’article non signé évoque le débat qui a eu lieu la veille à la Chambre des Députés à propos « la concurrence que les ouvriers étrangers qui viennent en France font à nos nationaux », question qui « préoccupe assez vivement l’opinion publique ». Ce débat doit être replacé dans le contexte économique et sociale d’une France qui, comme les autres pays d’Europe, connaît depuis 1873 une longue période de difficultés économiques (une phase B d’un cycle de Kondratieff) qui pèsent sur l’emploi et les salaires.
L’intérêt de l’article, c’est que le rédacteur ne se contente pas de relater la teneur du débat parlementaire de la veille mais développe un véritable argumentaire sur le sujet. L’auteur y défend la liberté du travail des étrangers, conformément aux principes libéraux de la science économique classique. On peut y lire en creux les arguments de ceux qui sont favorables à une réglementation du marché du travail : socialistes à gauche, nationalistes à droite.
Mais l’auteur ne se contente pas de la dimension économique de la question et défend aussi une intégration des travailleurs étrangers par la naturalisation et assume une conception de la nation ouverte et… républicaine.
Dans la courte séance que la Chambre a tenue hier est revenue devant elle une question qui depuis quelques mois préoccupe assez vivement l’opinion publique dans le monde des travailleurs, des commerçants et des industriels. C’est la question de la concurrence que les ouvriers étrangers qui viennent en France font à nos nationaux. Ces ouvriers, dit-on, travaillent à meilleur marché que les nôtres et par conséquent font baisser les salaires. De là à l’idée très naturelle de vouloir protéger le travail national par des mesures prohibitives, le passage est facile. On en a proposé plusieurs. Les uns, comme M. Pally, demandent qu’une loi interdise l’emploi d’ouvriers autres que des Français dans les travaux publics exécutés pour l’Etat, les départements ou les communes. D’autres, comme M. Thiessé, se contenteraient d’une taxe imposée aux ouvriers étrangers, qui serait une compensation aux charges plus lourdes supportées par les nôtres et rétablirait entre eux une sorte d’égalité. Dans un cas comme dans l’autre, c’est le système protectionniste appliqué au travail et aux salaires, comme on l’a demandé pour l’agriculture et pour l’industrie.
La facilité et la simplicité de ces remèdes doivent mettre les esprits qui réfléchissent en défiance de leur efficacité. Il est rare que les mesures de protection et de prohibition n’aient pas des effets contradictoires et ne fassent pas perdre d’un côté autant et plus qu’elles semblent faire gagner de l’autre. Il est bien clair, par exemple, que la hausse factice et momentanée des salaires ainsi obtenue augmenterait le prix des travaux publics et finirait par retomber à la charge des contribuables. D’autre part, on sait que l’unique cause des difficultés de notre industrie à lutter sur les marchés étrangers et même sur le marché national contre les industries des peuples voisins, c’est que celles-ci travaillent à meilleur compte et vendent leurs produits à plus bas prix. Toute mesure prohibitive en fait de main-d’œuvre aura pour conséquence inévitable d’accroître encore cette différence et de rendre notre défaite industrielle plus certaine. Pour fournir du travail même à nos ouvriers, l’industrie doit recevoir des commandes, c’est-à-dire compter sur la consommation. Que celle-ci s’alimente ailleurs, et nos ouvriers pâtiront encore plus du chômage ou de la restriction des affaires que de la médiocrité des salaires actuels. Cette manière de venir en aide au travail national est celle de l’avare à courte vue qui tue la poule aux œufs d’or.Notez que déjà, par suite du bien-être général dont en France on a pris l’habitude, il est des genres de travaux particulièrement pénibles, rebutants ou peu rémunérateurs que les ouvriers français ou ne veulent pas faire ou ne peuvent faire au bas prix qui seul les rend possibles. Pour ces travaux, il a fallu faire appel aux étrangers qui sont moins difficiles ou moins exigeants. Ecartez-les du même coup il faudra abandonner ces travaux, ce qui sera un appauvrissement, ou bien, s’ils sont indispensables, les faire exécuter à un taux excessif, ce qui sera pour le Trésor public une lourde charge de plus. On voit que ces questions économiques, dans un temps comme le nôtre, sont éminemment complexes; qu’il faut en faire le tour, les considérer par les deux bouts, si nous pouvons ainsi parler, avant de les résoudre. L’esprit simpliste qui les tranche en suivant la première apparence court au-devant des plus amères déceptions. Il s’agit au fond de se demander si les ouvriers étrangers qui nous apportent leurs bras et leurs outils ne sont pas un des facteurs de notre force et de notre richesse, et, dès lors, si nous priver de cet élément dans la concurrence internationale à laquelle aucun peuple ne peut se dérober, ce n’est pas en réalité nous diminuer
et nous affaiblir.Sans doute on peut citer des pays voisins où les étrangers sont soumis à des taxes de séjour et plus ou moins écartés des entreprises industrielles ou autres. Mais, si nous avons le même droit, il n’est pas sûr que nous y ayons le même intérêt. Les pays dont on parle sont ceux où il y a une population ouvrière débordante et où, par cela même, la main-d’œuvre est à plus bas prix que partout ailleurs. Même avec cette protection, elle est très loin d’atteindre le niveau qu’elle a chez nous, c’est même précisément de ces pays-là que nous vient la plus forte immigration des ouvriers étrangers. Ils ne perdent donc rien à se protéger. Mais sommes-nous dans la même situation ? Avons-nous un trop grand excédent de population? Et notre intérêt général n’est-il pas de profiter de tout ce qui peut sous ce rapport atténuer la différence des charges de notre production comparées aux charges de la production étrangère ?
Après notre intérêt, il faut bien consulter aussi notre honneur et nos traditions. M. Martin Nadaud, qui ne saurait être suspect de rester indifférent au sort de nos ouvriers, a vivement protesté hier contre les mesures proposées, au nom des principes de la Révolution française. Il faut prendre garde, nous le savons, d’abuser de ces principes et de ces évocations généreuses. La politique ne se fait pas avec des sentiments il faut tenir compte des réalités. Mais il n’en demeure pas moins vrai que la Révolution a proclamé la liberté du travail et qu’une fois cette liberté violée dans les étrangers rien ne nous dit qu’on ne la violera pas en France même au profit de telle ou telle classe de travailleurs qui se plaindront de l’abaissement ou de l’insuffisance de leurs salaires. De même que la liberté a sa logique, le protectionnisme a la sienne, et sur cette pente on peut aller plus loin qu’on ne croit.
D’autres part, nous avons dans le monde une réputation d’hospitalité généreuse qui mérite bien quelques ménagements, car c’est un des éléments de la puissance d’attraction de notre génie national. Après avoir obéi à nos instincts d’expansion et de sociabilité jusqu’à l’excès, allons-nous pratiquer la politique du colimaçon barricadé dans sa coquille?
L’immigration des étrangers dans notre pays est certainement une question qui mérite toutes nos sollicitudes. Mais la solution n’est point où on la cherche. Notre pensée ne doit pas être d’exclure ces éléments, mais de nous les assimiler. Ne chassons point les ouvriers étrangers, visons plutôt à en faire des ouvriers français. Ils deviendront ainsi une force et une richesse. A cet égard, il faudrait réviser nos lois et notre procédure sur la naturalisation. Etre citoyen français est sans doute un titre de noblesse, mais pourquoi en rendre l’obtention si longue et si onéreuse? Non seulement il faudrait y mettre plus de largeur, mais encore il ne nous déplairait pas qu’au bout d’un certain temps et dans certaines conditions la loi devint quelque peu impérative. Nous ne pouvons pas avoir la peur que des éléments
étrangers viennent altérer la pureté de notre sang. Nous en avons reçu déjà dans nos veines de toute provenance. Nous ne sommes pas une race, nous sommes une nation qui s’est formée depuis dix-huit siècles par les alluvions successives que cent peuples divers ont laissées sur notre sol. C’est là notre originalité et notre force. L’unité de la patrie française est une grande idée morale. Laissons-la rayonner librement. Nous nous sommes assimilé dans le passé des éléments autrement résistants que les milliers de Belges, d’Allemands, de Suisses ou d’Italiens qui viennent chercher chez nous un travail plus rémunérateur et une vie plus facile. Pourquoi notre génie n’aurait-il pas aujourd’hui la même vertu? C’est peut-être la seule chance qui nous reste de compenser en quelque mesure l’infériorité où nous place physiquement l’excès de population qui fait la force de nos voisins.Le Temps, 27 janvier 1886, page 1