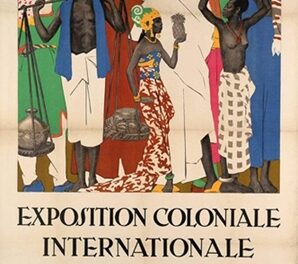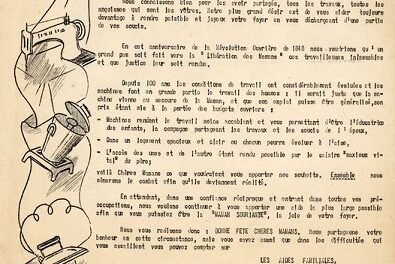Si l‘école obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 à 13 ans fut une grande avancée démocratique et républicaine, celle-ci n’a cependant jamais fait l’unanimité. Abel Bonnard, l’auteur du texte, représente un beau spécimen de ces contempteurs de l’enseignement pour tous.
Abel Bonnard [1883-1968] est un personnage un peu oublié de nos jours. Il fut pourtant un écrivain prolifique. Il fut aussi entre les deux guerres l’une des figures de proue de la vie mondaine parisienne. Tout ceci lui permit d’entrer à l’Académie française en 1932, avant d’en être exclu à la Libération. Homme de droite, il évolue dans les années 1930 vers l’extrême droite, comme d’autres intellectuels français à la même époque. Il devint sous le régime de Vichy un fervent admirateur du nazisme et un des plus ardents collaborationnistes. Ce qui lui valut le surnom peu amène de « gestapette ».
Le texte ci-dessous est extrait d’un ouvrage édité en 1936 et intitulé « Eloge de l’ignorance ». Comme le titre l’indique, Abel Bonnard s’attache à démontrer, non pas seulement l’inutilité de l’enseignement pour tous, mais son effet destructeur. Abel Bonnard considère que l’enseignement primaire, forcément limité, priverait le brave paysan et le bon artisan de ce qui fait la force de la nation : le bon sens, venu des profondeurs de la race ; le savoir véritable ne pouvant être l’apanage que d’une mince élite, triée sur le volet. On perçoit mieux dès lors l’attraction de Bonnard pour l’idéologie hitlérienne…
Abel Bonnard consacre toute une partie (la troisième), à l’ignorance des femmes, qu’il faut évidemment préserver. L’auteur, non sans talent, empile tous les clichés sur la prétendue infériorité intellectuelle des femmes. Cela pourrait faire sourire, si Abel Bonnard n’avait pas été ministre de l’Éducation nationale nommé par le maréchal Pétain, entre février 1942 et août 1944. Ce texte, parmi d’autres, nous offre donc indirectement un éclairage intéressant sur les conceptions de l’enseignement et du rôle de l’école sous le régime de Vichy.
PARLONS de l’ignorance par rapport aux femmes. Le sujet est fort délicat. Dès qu’une société a été organisée, il y a toujours eu des femmes pour vouloir être savantes. Cela se comprend. C’est une coquetterie naturelle, d’avoir la plus jolie robe. C’en est une autre, moins fraîche et plus âpre, de vouloir emprunter aux choses de l’esprit une parure supplémentaire. Dans le combat où chaque femme est engagée avec ses rivales, les connaissances qu’elle a acquises doivent jouer le rôle de ces troupes inattendues qu’un général habile amène à la fin d’une bataille, et qui décident de la victoire en sa faveur. C’est souvent au moment même où elles croient se mettre au-dessus de leur sexe que les femmes nous montrent combien elles lui sont inféodées, et la façon dont certaines sont attirées par le vocabulaire des sciences ne laisse pas de rappeler l’avidité avec laquelle les filles des tribus sauvages se jettent sur la pacotille qu’un marchand étranger déballe sous leurs yeux. Pour juger combien l’idée de rivalité demeure puissante dans leur esprit, il suffit de voir l’impatience et la colère de l’une d’entre elles, quand elle apprend qu’une autre se permet d’étudier les sujets qu’elle croyait s’être réservés. Cependant ce sentiment n’est pas le seul qui les pousse. Elles peuvent éprouver plus vivement même que le commun des hommes le désir d’apprendre, puisque en toute chose, c’est leur nature, et je dirai presque leur état, que d’être tentées. Mais alors même qu’il est intense, ce désir reste presque toujours superficiel. Elles ne consentent pas à l’austérité de l’étude, à ces efforts prolongés, où, bien loin de voir notre travail se marquer par un progrès glorieux, nous semblons n’avoir quitté la rive des affirmations faciles que pour acquérir à grands frais une pénible incertitude. La plupart des femmes n’étudient qu’à condition d’y gagner tout de suite. Elles sont moins avides d’apprendre que de savoir. Le jargon de l’école exerce sur elles un tel attrait, que cela même les empêche d’aller jusqu’aux choses qu’il recouvre. Elles s’arrêtent au plaisir enfantin de le parler, elles modifient et dévient leur phrase, pour la faire passer par un mot savant dont elles ne possèdent pas toujours le sens. Même dans l’étude, elles n’échappent pas à leurs nerfs. Il leur faut des coups de théâtre, des vertiges, des pâmoisons. La précision les ennuie : ce sont les Bacchantes de la connaissance. Tout les attire, rien ne les retient. Passant d’une matière à une autre, traversant au galop des livres qui n’ont de sens que s’ils sont lus pas à pas, il ne peut leur rester dans l’esprit qu’un grand vacarme de mots, et, dans l’âme, cette sourde déconvenue, cette fatigue sinistre qui suit les efforts sans discipline. Tristes, lasses, incertaines et bavardes encore, c’est alors qu’elles peuvent servir d’enseigne à l’immense confusion de leur temps, et malgré l’extrême différence des conditions, des apparences, elles ne laissent pas de rappeler le pauvre ouvrier, liseur désordonné, dont je parlais tout à l’heure.
Ici, cependant, il faut distinguer. Naguère encore, quand la société était partagée en compartiments, quand la vie mondaine avait plus d’exigences et plus de rigueurs, il n’était guère possible aux femmes qui menaient cette vie de s’instruire régulièrement des choses qui les attiraient. Dans ces dernières années, cela a changé. En même temps que la société se défaisait, les filles commençaient d’être instruites comme les garçons. Moins blasées qu’eux, apportant à des études nouvelles la curiosité et même la crédulité de tout un sexe qui en avait été longtemps privé, elles ont souvent paru de meilleures élèves. Mais il ne s’agit guère que d’une apparence, moins due à la vigueur de leur esprit qu’au zèle de leurs intentions. Ainsi le bas-bleu se voit remplacé par l’écolière. Ces deux types extrêmes, entre lesquels il faut placer tous ceux où ils se mélangent, s’opposent presque absolument. Les anciennes savantes dédaignaient le rudiment, les nouvelles s’y arrêtent. Les premières étaient avides d’affirmations absolues, de conclusions immédiates ; elles ne se contentaient pas à moins. Il leur fallait l’air des cimes, pour récompenser leur premier pas. Les secondes n’entendent pas sans scandales les bourdes hardies de leurs aînées. Celles-là faisaient volontiers parade de leur savoir : celles-ci, souvent, sont modestes. Mais, pour les choses mêmes qu’elles ont étudiées, il est rare qu’elles les possèdent et qu’elles ne se bornent pas à réciter les mots qui sont les signes de cette instruction. On est touché de leur application, mais on reste comme désappointé de voir la femme dépérir en elles, à mesure qu’elles étudient davantage. On se demande si elles n’ont pas déserté le terrain de leur véritable mérite. Elles peinent comme des apprentis. Ah! qu’il serait mieux d’être des femmes ! On ne saurait dire en deux mots à quoi tient le charme des femmes, mais il n’est pas douteux qu’une certaine oisiveté y entre pour beaucoup. Elles sont à nos yeux comme les lis des champs, qui ne travaillent ni ne filent, Lilia non laborant neque nent. L’essence de leur nature n’est pas de connaître, mais de sentir. Ce qui les distingue, c’est d’avoir gardé de l’instinct. De là vient que certaines ignorantes sont délicieuses et vraiment divines, parce que l’âme du monde emplit encore ces magiciennes involontaires. Elles sont les miroirs du ciel, les sœurs des nuées. On regarde dans leurs yeux le temps qu’il va faire, et, quand elles étendent le bras pour reprendre leur manteau, il semble que leur geste va ramener tout le paysage. Il y a beau temps, au contraire, que, dans leur immense majorité, les hommes sont séparés de l’univers. Chacun ne vaut plus que par son cerveau, et leur intelligence, à mesure qu’elle se développe, vit en eux d’une vie à part, comme une usine qui ne touche pas à la mai-son du directeur. Ils peuvent même avoir une érudition distincte de leur intelligence et où nous sommes bien aises d’aller nous fournir, comme on fait ses emplettes dans un magasin, sans regarder la figure du vendeur. Une femme, au contraire, est bien plus un être. Quoi qu’elle dise, elle s’avoue, ses pensées mêmes ne nous intéressent que comme les gages de ses sentiments, et nous cherchons sa sensibilité à travers toutes ses paroles, comme l’oreille guette et retient les sons d’une cloche d’argent, au fond des bruits d’une ville. On goûte toujours le même plaisir à voir une femme qui, sur des sujets indifférents, n’avait que des propos ordinaires, montrer soudain l’intelligence la plus fine lorsqu’il s’agit d’un objet qui intéresse sa sympathie, et quand son esprit est mis en train par son cœur. […]
Abel Bonnard, Éloge de l’ignorance, 1926, édition Hachette, partie III